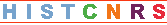En cas d'usage de ces textes en vue de citations,
merci de bien vouloir mentionner leur source (site histcnrs), ses auteurs et leurs dates de réalisation
Entretien avec Louis Néel
J.-F. Picard & E. Pradoura, 4 juin 1986 à Meudon (source : https://www.histcnrs.fr/temoignages.html)

DR
Voir aussi : D. Pestre, 'Louis Néel, le magnétisme et Grenoble' (Cahiers pour l'histoire du CNRS, 1990 - 8)
Quels furent vos premiers contacts avec le CNRS, monsieur Néel ?
En
1939, j'ai été un des premiers chargés de missions du CNRS. Son
directeur, Henri Longchambon m'avait convoqué en septembre pour me
charger des missions les plus diverses. Pour réaliser la mobilisation
de la recherche, il avait envoyé des avis de réquisitions absolument
magnifiques à tout le monde, sans se préoccuper d'aucune hiérarchie,
sans s'occuper de l'avis des doyens des facultés des Sciences, ce qui
avait donné lieu à des frictions considérable. Par exemple il m'avait
expédié à Strasbourg sans en référer à André Danjon, le doyen de la
faculté des sciences dont je dépendais alors. Ni le recteur de
Strasbourg replié à Clermont-Ferrand, ni Danjon n'avaient été prévenus,
moyennant quoi nous - i.e. le CNRS - avons étés accusés de cambriolage.
Tout cela est remonté jusqu'au ministère ! Dans mes papiers, j'ai gardé
ce document, je lis : 'ordre de mission du 20 octobre 1939. Monsieur
Néel se rendra à Strasbourg pour procéder à l'évacuation du matériel
scientifique. Les autorisées civiles et militaires sont priées de lui
faciliter sa mission en particulier en lui assurant la liaison
téléphonique avec le ministère de l'Education nationale'. Tout cela
était parfaitement réglementaire, le CNRS avait des PRDI (Personnel
requis disponible immédiatement) et des PRD (Personnel requis différé).
Le tout inscrit dans la loi du 11 juillet 1938 sur la mobilisation
scientifique en temps de guerre.
Il s'agissait d'une évacuation suscitée par la mobilisation scientifique ?
Exactement.
On a évacué ce matériel à Meudon Bellevue. J'ai ramené trois wagons de
marchandise,entre autres des électro-aimants de plusieurs tonnes. On
avait forcé les bureaux des professeurs pour ramener tout ce qui était
dans les armoires. Vous imaginez le pataquès. Longchambon avait
pratiqué l'année précédente une grande enquête dans les laboratoires
universitaires de province. Un rapport avait été publié et il l'avait
utilisé pour pêcher dedans le nom des professeurs ou des chercheurs qui
lui semblaient les plus valables et ils les avaient nommés 'chargés de
mission'. A l'époque, je me souviens d'avoir lu ce fameux rapport.
C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai découvert qu'il y avait des
choses très intéressantes à Grenoble, par exemple sur la métallurgie du
magnésium, ce qui m'a donné l'idée plus tard de m'y installer plutôt
que de revenir à Strasbourg.
Pourriez vous parler de vos débuts à la faculté des sciences de Strasbourg ?
En
1932, j'ai commencé comme assistant de Pierre Weiss à Strasbourg avec
un traitement misérable. A l'époque, il n'y avait pas d'assistants
agrégés, les agrégés étaient payés comme les autres et j'ai soutenu ma
thèse alors que j'étais en sixième classe d'assistant. Pierre Weiss
était déjà très connu à l'étranger, ce qui était exceptionnel à cette
époque où les universités françaises n'avaient quasiment pas de
relations avec leurs homologues étrangères. C'était un spécialiste du
ferromagnétisme qui avait une connaissance approfondie du milieu des
physiciens allemands, A. Einstein, W. Pauli, etc. et il avait été
professeur au Polytechnikum et directeur de laboratoire à Zurich. Je
l'ai souvent accompagné à l'étranger. On allait faire des conférences
en Suisse et ailleurs, en fait ce genre de pratique n'était pas
courante à l'époque. Le premier congrès réellement international pour
lequel on avait réuni les meilleurs magnéticiens d'Europe et même des
Etats-Unis, s'est tenu à Strasbourg en 1940. C'est une triste histoire.
Tous les comptes-rendus ont été perdus pendant l'exode du CNRS, sauf le
mien. Après la guerre, on a eu deux congrès internationaux à Strasbourg
en 1950 (ferromagnétisme et antiferromagnétisme) et en 1955. Celui-là a
été très intéressant parce qu'il y avait alors une quinzaine d'années
de recherches qui n'étaient pas connues, donc des communications
extrêmement denses. Aujourd'hui, on fait des congrès tout les trois
mois, çà n'a plus aucun sens.
Pierre Weiss avait d'étroites relations avec Jean Perrin
Il
était effectivement très lié à Jean Perrin et c'est la Caisse nationale
des sciences dont ils s'occupaient qui m'a fait avoir une bourse en
1931 ou en 1932. Il était aussi très 'Front populaire' et il avait
défilé à Paris le poing levé. Or, c'était très mal vu à Strasbourg où
la population était plutôt très conservatrice. Je me souviens que
lorsque j'ai du évacuer les appareils de la faculté des Sciences, des
appareils qui pèsent deux ou trois tonnes, j'avais pris contact avec
les ateliers de la Société alsacienne de construction mécanique à
Graffenstaden. Je voulais leur demander du personnel de manutention,
mais je me suis fait gentiment éconduire : "le laboratoire de Pierre
Weiss ? Le Front populaire ! ? Pas question" et ils m'ont envoyé
balader. L'atmosphère à Strasbourg dans l'immédiat avant-guerre était
très différente de celle de Paris. On pressentait l'imminence de la
guerre et on était inquiet. Dans les milieux parisiens, au contraire,
c'était l'insouciance, on ne pensait pas que l'Allemagne hitlérienne
présentait un réel danger. J'ajoute que si Strasbourg avait une
excellente université scientifique, les Strasbourgeois s'y
intéressaient beaucoup moins qu'à la fac de Lettres, les études
germaniques, théologiques, etc. Pendant les dix années que j'ai passé
dans la capitale alsacienne, je n'ai jamais rencontré ni le maire, ni
un député ou un conseiller général. Rien à voir avec l'ambiance de
Grenoble que j'ai connu quelques années plus tard. Là bas, au bout de
quinze jours, je connaissais tous les hommes politiques de la région et
puis il y avait le doyen René Gosse, très lié à J. Perrin lui aussi,
Longchambon, le lyonnais, etc.
Quelle était l'ambiance dans ce CNRS en pleine mobilisation ?
Vous savez qu'il avait deux directeurs, Henri Laugier
et Henri Longchambon. Ce duo était très amusant par ce qu'ils avaient
tous deux des caractères complètement différents. Autant
Longchambon était dynamique et fonçait au risque de provoquer des
réactions parfois violentes, autant Laugier était un homme politique
qui essayait toujours d'arranger les choses. Au début, Longchambon m'a
chargé d'une mission de relations entre le CNRS et les services de
propagande de Jean Giraudoux au Majestic. Ca n'avait aucun intérêt pour
un scientifique et je lui ai demandé de faire autre chose. Il m'a donc
proposé de recevoir les inventeurs, une vingtaine par jour qui
faisaient la queue pour proposer au CNRS les trucs les plus farfelus.
Finalement je lui ai demandé de trouver quelqu'un d'autre pour ce job
et il a l'a confié à Jean Wyart. C'est alors
que j'ai été appelé à travailler pour la Marine. Un autre requis de
l'université de Strasbourg, l'astronome André Lallemand, avait des
idées sur l'emploi des cellules photos électriques et l'imagerie
infrarouge, susceptibles d'intéresser la Marine. On a convaincu
Longchambon qu'il serait intéressant de fabriquer des cellules
infrarouges au CNRS et on a créé un laboratoire à trois, Lallemand,
Soleillet et moi sur le site de Bellevue. On a mis notre affaire sur
pieds en trois mois on a démarré une fabrication, avec prise de
brevets, vers le mois de mars 1940.
L'affaire des mines magnétiques allemandes
C'est
alors que la Marine a pensé à moi pour un autre type de problèmes.
Pendant l'hiver 1939-40, les Allemands ont commencé à mouiller des
mines magnétiques dans la Manche et la mer du Nord, ce qui a pris les
Alliés au dépourvu. La Marine a alors demandé au CNRS s'il disposait
d'un spécialiste pour s'occuper du problème. Bref, un jour Longchambon
me demande de m'occuper de cette affaire. Venant d'un laboratoire où
j'avais fait ma thèse sur le magnétisme, cela m'intéressait évidemment.
Au début, il était prévu que je ne travaillerais qu'un ou deux jours
par semaine chez les marins au titre de conseiller. Puis ça s'est
développé et à partir de janvier 1940, j'ai passé presque tout mon
temps à la Marine. Les marins m'ont collé un grade et un jour
Longchambon m'a accueilli d'un ton goguenard : "Ah! vous êtes capitaine
de corvette maintenant". En fait, j'ai assez rapidement trouvé un truc
pour protéger les bateaux contre les mines magnétiques. J'ai compté, à
l'époque, j'ai fait 25.000 kilomètres sur les routes ou en chemin de
fer pour aller de Toulon à Dunkerque, à Lorient, à Brest ou à Cherbourg
pour installer des stations de protection contre les mines magnétiques.
Un dispositif de démagnétisation qui s'est révélé très efficace puisque
la Marine n'a perdu aucun bateau à cause ce ces mines.
Vous avez participé aux opérations militaires ?
Le
10 mai 1940, au moment de l'attaque allemande, j'étais à Dunkerque. On
a subi un bombardement terrible qui a duré toute la nuit. Le matin, je
suis descendu à l'Amirauté et j' ai demandé ce qui se passait. C'était
le début de l'attaque allemande et l'Armée a reçu l'ordre de pénétrer
en Belgique. L'etat-major voulait organiser une expédition pour
débarquer à Flessingue sur la côte hollandaise. Or, les passes pour
sortir de Dunkerque suivent un chenal parallèle à la côte dans lequel
on savait que les Allemands avaient posé des mines magnétiques. La
veille du bombardement de la Luftwaffe, on y avait vu sauter un
magnifique cargo. L'amiral Abrial me convoque : "il faut que vous
désaimantiez les bateaux, fissa.
- Ca va être difficile amiral,
l'installation de démagnétisation est à peine terminée et nous n'avons
aucun appareil de mesure
- Je ne veux pas le savoir, débrouillez-vous
- Mais on ne pourra pas compenser les compas, il faudrait faire une nouvelle compensation
- Je prends çà sur moi, désaimantez les bateaux". Ce que l'on a fait au
pifomètre, puis ils ont embarqué les troupes et je les ai vu sortir du
port et défiler le long de la côte. On se demandait : sautera, sautera
pas ? Finalement, ils n'ont pas sautés. Ils sont allés pour faire ce
débarquement sur la côte hollandaise qui a d'ailleurs complètement
foiré et ils sont revenus au bout de deux jours. Puis ça a été le début
de l'encerclement de Dunkerque. J'étais revenu sur place à la demande
de la Marine, mais Longchambon me pressait de regagner Paris. Il avait
des informations du ministère de la guerre lui disant que l'affaire
commençait à mal tourner. Ce retour a été toute une histoire, un
périple à travers les lignes, huit jours à dormir la nuit dans des
poulaillers et j'arrive un matin, pas rasé, dans le petit bistro de la
mère Deville, rue de l'Université, où les autorités du CNRS avaient
l'habitude de déjeuner. Je leur raconte mes aventures, la déroute
militaire, etc. Puis ça à été l'évacuation de Paris. Longchambon qui
n'était pas un homme optimiste était complètement à plat. Je
m'efforçais de le remonter : "Allez ! Gardez le moral. Vous savez, avec
le temps tout finit par s'arranger.
- Bon, mais ce n'est pas tout ça, vous même, où faut-il que vous alliez maintenant ?
- Vous pourriez me donner trois ordres de mission, lui dis je, l'un
pour Brest, l'autre pour Bordeaux et enfin un Toulon". C'est ce qu'il a
fait. Finalement, je suis arrivé à Toulon au Centre de recherche de la
marine. Au moment de l'armistice, celui ci a été déménagé à Oran où
l'on est arrivé là au moment de l'affaire de Mers el-Kébir. L'attaque
de la Royal Navy a durement secoué les marins. Ensuite, on a passé un
mois en Algérie, installé dans un lycée de jeunes filles situé dans les
hauts d'Alger où j'ai rédigé un mémoire sur la protection contre les
mines magnétiques, mémoire qui n'a jamais été publié et dont je
conserve d'ailleurs le seul exemplaire.
Vous avez gardé beaucoup d'archives personnelles
On
a toujours intérêt à garder ses papiers. Je vous en donne un autre
exemple. En 1941, la Marine m'a envoyé en mission pour enquêter sur des
mines que les Allemands avaient déposées au large de Bizerte. Or, à la
Libération, il y a eu une élection pour le docanat de la faculté de
Grenoble. Il y avait un candidat, un professeur de l'université de
Tunis, israélite, qui était professeur là-bas, mais qui avait été
révoqué pour ces raisons. Je n'ai pas voté pour lui ce qui l'a rendu
furieux. Ayant découvert que j'avais été envoyé à Bizerte pendant la
guerre, il a prétendu que c'était pour aider à l'effort de guerre de
l'ennemi. A l'époque, tout le monde dénonçait tout le monde. Fort
heureusement, j'avais conservé les papiers qui prouvaient que ma
mission en Tunisie était de désamorcer des mines allemandes.
Ce service de recherche de la Marine est passé au CNRS
Exactement,
j'ai d'ailleurs protesté contre la suppression du centre de recherche
de la Marine. Tout le personnel est passé au CNRS qui en a fait le
laboratoire de Marseille dirigé par François Canac. J'estime que l'on a
fait là une erreur, la Marine aurait du le conserver.
C'est alors que vous revenez en France métropolitaine
On
est alors fin juillet, début août 1940. J'ai reçu une lettre de mon
doyen replié à Clermont Ferrand me disant : "Vous êtes mobilisé, mais
ce n'est pas tout çà. Il y a des baccalauréats à faire passer". Je
n'étais pas très chaud, mais c'était un ordre et je suis venu à
Clermont. C'était dégoûtant. Il régnait un pagaille invraisemblable. Je
me suis dit : ce n'est pas possible, on ne peut pas rester là, on ne
pourra rien faire. Sur les conseils de mon ami Félix Esclangon qui
avait été envoyé à Oran par le doyen Gosse, j'ai décidé d'aller à
Grenoble où il m'avait dit il y avait là un bâtiment entièrement vide
susceptible d'abriter un laboratoire. J'ai donc décidé de foncer…
Une installation à Grenoble
Certains
de mes collègues Strasbourgeois disaient : "la guerre ne va pas durer,
dans six mois nous serons de retour. Inutile de démarrer un service de
recherche…". Je n'étais pas convaincu. Mais, fait intéressant, ni le
doyen de Strasbourg, ni celui de Clermont-Ferrand, ni le ministre
d'ailleurs, n'étaient chauds pour me voir quitter le lieu officiel de
replis de la fac de Strasbourg. Le ministre était Emile Mireaux,
l'ancien directeur du journal 'Le Temps'. Il m'a convoqué. Il était
installé dans la loge du concierge d'un centre technique
d'apprentissage à Clermont-Ferrand. Je lui ai exposé mon cas,
c'est-à-dire les conditions pour lesquelles j'aimerais bien travailler
à Grenoble. "Bon. Combien y a t il d'habitants dans cette ville ? me
demande t il
- 90.000 lui dis-je.
- Et à Clermont-Ferrand ?
- 100.000.
- Donc Grenoble est plus petit que Clermont-Ferrand ?
- Oui, monsieur le Ministre.
- Dans ces conditions je vous autorise à vous y installer". En fait je
n'ai jamais compris le fond du raisonnement ministériel. Longchambon
était vexé que j'ai obtenu l'accord de Mireaux. Il m'a morigéné : "je
vous autorise à aller à Grenoble, mais je vous défend de faire des
cours à l'université". C'est comme cela que j'ai été détaché à
Grenoble, payé comme professeur d'université, mais avec interdiction
d'enseigner.
Vous n'avez jamais envisagé de revenir à Paris ?
Lorsque
j'ai décidé d'aller à Grenoble, j'ai dit que je refuserais par principe
une nomination à Paris. Et pourtant, en 1940, mon arrêté de nomination
comme maître de conférence à l'ENS était sorti, il ne lui manquait plus
que la signature du directeur de l'Ecole. Finalement, c'est Alfred Kastler
qui a été nommé, ce que je n'ai pas regretté car j'aimais beaucoup
mieux être professeur à Grenoble qu'à la Sorbonne. J'ai d'ailleurs
donné l'exemple d'une carrière entièrement provinciale. Normalement
dans toutes les facultés de province, après avoir fait trois ou quatre
ans, les gars se font nommer à Paris. Or, pendant quinze ans, il n'y a
pas eu de nominations de grenoblois à Paris. Tous les profs préféraient
rester sur place. Le seul à s'être fait nommer à Paris a été Félix
Esclangon. Le pauvre, cela ne lui a pas porté bonheur puisqu'il s'est
électrocuté dans son cours au PCB. En réalité, à Paris, les collègues
passaient leur temps à se bouffer le nez, ce qui n'était pas le cas en
province.
Le CNRS de Charles Jacob
J'ai
donc commencé à travailler pendant l'occupation, grâce à des crédits
octroyés par Charles Jacob, le directeur du CNRS qui avait succédé à
Longchambon. Le Ministre de l'Education nationale, Jacques Chevalier,
lui avait demandé une enquête sur le CNRS. Celle-la lui a pris tout
l'été et il a rendu un rapport concluant qu'il fallait maintenir le
centre. A la Libération, on lui a fait des histoires parce qu'il avait
soi-disant collaboré, ce qui était totalement infondé. Donc, Jacob nous
a donné quelques crédits, pas très élevés, mais suffisants pour
commencer à démarrer quelque chose. En plus, on a été aidé par les
marins qui nous ont donné du matériel. Et puis, on a eu une aide
modeste de la faculté de Grenoble. J'ai gardé toute ma comptabilité. A
l'époque, les directeurs de laboratoires CNRS étaient à la fois les
comptables, trésoriers, responsables scientifiques, etc... J'avais
l'impression d'avoir choisi la bonne voie. C'était formidable d'avoir
tout son temps libre pour faire de la recherche. Lorsque j'étais
professeur à Strasbourg non seulement je faisais les cours réguliers
mais aussi des tas de cours supplémentaires non payés sur la physique
moderne... Donc, à Grenoble j'avais du temps. Il n'y avait plus aucun
congrès, plus de relations internationales. On ne pouvait pas aller à
Paris à cause de la ligne de démarcation. On avait tout le temps de
réfléchir à nos problèmes. C'est ainsi que pendant quatre ans j'ai pu
établir un programme de recherche qui a est resté viable pendant une
quinzaine d'années.
Recherche fondamentale et recherches appliquées
Avant
la guerre, dans le laboratoire de Pierre Weiss à Strasbourg, on était
totalement isolé du milieu industriel. On ne s'intéressait pas du tout
aux applications du magnétisme. A l'époque, je faisais beaucoup de
bibliographie, parce que j'avais été chargé de rédiger les tables
internationales de constantes pour la partie magnétisme. Aux Etats-Unis
ou en Allemagne, on voyait se développer une industrie des alliages
très perméables ou des choses comme çà et nous, nous restions
totalement en dehors du coup. Ca m'écœurait un peu de voir qu'on ne
s'intéressait qu'à des questions de recherche fondamentale, aux
propriétés atomiques des alliages magnétiques, etc., que l'on ne
comprenait d'ailleurs pas. Ce qui n'est guère étonnant, étant donné que
l'on a mis pratiquement un demi siècle à comprendre, et encore... En
revanche, avec les marin, le travail était passionnant. Par exemple,
lorsque on évaluait le moment magnétique d'un croiseur de 30 ou 40.000
tonnes, retrouver l'hystérésis que nous avions décelé sur un
échantillon d'un gramme, voilà le genre de chose qui me frappait et qui
m'ont fait prendre conscience de l'intérêt des applications. C'est ce
qui a orienté mes premières recherches à Grenoble, faire la théorie des
propriétés du fer dans des champs faibles, cela n'avait jamais était
faite jusque-là.
Votre installation à Grenoble était donc aussi motivée par la tradition industrielle de cette ville
Bien
sur, cette tradition remontait d'ailleurs fort loin. Le premier comité
d'accueil pour les étudiants étrangers avait été fondé dès 1895 par des
industriels grenoblois. C'était également eux qui avaient cédés le
terrain pour construire l'Institut Polytechnique. Leurs mobiles
n'étaient d'ailleurs pas désintéressés. Au début du (vingtième) siècle,
au moment de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, Casimir
Brunil qui avait récupéré des terrains qui appartenaient à un séminaire
l'a cédé à l'Etat pour y construire l'Institut. Il y avait également la
firme Merlin Gérin créée en 1920. Paul Louis Merlin était un
'gad'zarts' très sympathique, il a présidé l'association des amis de
l'université. C'est à lui que l'on doit la construction de la cité
universitaire. On sait que c'est à Grenoble qu'a été créée la première
école d'électricité à la suite du développement de la houille blanche.
L'initiateur en fut Paul Janet qui avait fondé l'Institut
électrotechnique de Grenoble avant de faire l'Ecole supérieure
d'électricité de Paris (Sup'Elec). C'est l'hydro-électricité qui a
assuré le développement d'industries comme la papeterie, grosse
consommatrice d'énergie, ou l'électrochimie avec Ugine, une firme
dirigée par des gens comme Georges Painvin, un type brillant qui avait
d'excellentes relations avec l'université. Il y avait aussi des
universitaires comme Louis Barbillon, professeur à la fac et promoteur
des grandes écoles d'ingénieurs grenobloises. Je ne connais pas
beaucoup d'autres endroits en France où il y ait eu ce même type de
relations entre l'université et l'industrie. Toulouse bien sur, avec la
chimie et l'industrie aéronautique. Mais il ne s'agit pas d'une
éclosion locale comme à Grenoble puisqu'elle résulte de la volonté
décentralisatrice de l'Etat.
Une association pour le développement de la recherche à l'université
Nous
avons donc fondé à Grenoble la première association pour le
développement de la recherche à l'université. Cet organisme nous a
permis de court-circuiter les agents comptables de l'université
prisonniers des règles de la comptabilité publique. Le système était
tellement rigide qu'on ne pouvait rien payer, pas créer de postes, etc.
Notre affaire a si bien marché qu'on a pu multiplier son chiffre
d'affaires de vingt ou trente fois en l'espace d'une dizaine d'années.
Nous avions pris toutes les précautions nécessaires nous permettant de
parer à tout détournement de fonds. On sait qu'il y a eu quelques abus
dans certaines facs de province, ce genre d'association étant
simplement le moyen de s'octroyer des suppléments de traitement. A
Grenoble on avait fait en sorte que les dirigeant soient des
industriels et pas des universitaires et Paul Louis Merlin est resté
longtemps notre premier président.
Le laboratoire d'électrostatique et de physique du métal (LEPM)
C'est
comme cela que j'ai pu créer l'un des premiers laboratoires propres du
CNRS, le laboratoire d'électrostatique et de physique du métal (LEPM),
le nom sous lequel il a été officialisé en 1945 par Joliot. On lui a
donné ce nom pour la raison suivante. Au CNRS en 1940, le physicien
Charles Guillaud qui avait commencé une thèse à Strasbourg et été
mobilisé pendant la guerre, a fini par s'installer à Meudon Bellevue.
Or, il se trouvait qu'il a trouvé là tout le matériel que j'avais
ramené de Strasbourg sur instructions du CNRS. Guillaud a mis la main
dessus pour installer son laboratoire de magnétisme. Evidemment,
j'étais assez mécontent. Guillaud était un tout jeune chercheur à
l'époque, et l'affaire m'avait semblée un petit peu curieuse. Quoiqu'il
en soit, je ne voulais pas faire d'histoire et comme il avait intitulé
son laboratoire du magnétisme à Bellevue, j'ai décidé de faire le mien
à Grenoble en prenant un autre titre.
Vous aviez un autre concurrent à Bellevue, le labo Aimé Cotton
Industriellement, ils ne sont jamais arrivés à fabriquer un seul truc. C'était semelles de plombs ce laboratoire...
Les développements du LEPM
Sous
l'occupation, il s'est produit un évènement extrêmement favorable pour
la recherche - si je puis dire - en l'occurrence les lois raciales de
Vichy qui ont mis à la porte tous les Israélites, notamment mon
excellent assistant Louis Weil qui m'avait suivi de Strasbourg. Je me
suis dis que si je voulais le garder, il fallait que je lui trouve de
quoi se nourrir. J'étais en train d'étudier les grains fins avec
lesquels je savais qu'on pourrait fabriquer de bons aimants. J'ai donc
décidé d'aller voir le directeur des aciéries d'Ugine pour lui demander
un contrat d'étude. C'est ainsi qu'on a eu nos premiers contrats avec
l'industrie. Ugine nous a payé deux où trois collaborateurs et nous a
fourni tous les crédits de recherche que nous voulions ce qui nous a
permis de mettre au point un procédé de fabrications d'aimants, puis de
prendre des brevets secrets en 1942. On a démarré la fabrication en
essayant de ne pas trop attirer l'attention des Allemands. En effet,
nos aimants qui avaient par ailleurs des propriétés absolument
semblables aux aimants courants, ne contenaient ni cobalt ni nickel,
des matériaux stratégiques à l'époque. Notre matière première étaient
les riblons métalliques de l'usine Raymond de Grenoble qui fabriquait
des boutons pressions. Ces chutes de métal ne coûtaient rien puisqu'on
les mettait à la décharge publique. C'est ainsi qu'Ugine a installé une
première usine pilote de fabrication d'aimants dans la région de
Grenoble destinée en particulier à la fabrication des petites dynamos
pour l'éclairage des vélos. C'est comme cela que la recherche a
contribué à développer le poids industriel de Grenoble.
La Société anonyme des machines électrostatiques (SAMES)
Cette affaire a été montée à la suite d'une demande Frédéric Joliot
qui avait besoin de développer les générateur de courant continu à
haute tension nécessaires pour accélérer les particules sub atomiques.
J'étais en très bons termes avec lui. Je le connaissais depuis que nous
l'avions fait venir à Strasbourg en 1940 pour donner l'une des
premières conférences publiques sur la réaction en chaîne. On avait
trouvé çà passionnant, il s'avait très bien exposer ces choses. Par la
suite, j'ai fait partie du comité de direction de son laboratoire de
synthèse atomique à Ivry.
Comme vous, Frédéric Joliot était partisan de relations étroites entre la recherche et l'industrie
Bien
sur, il s'est bien mieux intégré au C.E.A. qu'il ne l'a jamais été à
l'université où il n'était d'ailleurs pas bien vu. Quand j'étais à
l'Ecole normale supérieure en 1924-1928, je me souviens qu'on nous
déconseillait de fréquenter le laboratoire Joliot ou celui de madame
Curie. J'ignore si c'était pour des raisons politiques ou autres. Donc
au lendemain de la guerre, le CNRS et l'EDF nous ont donné les crédits
nécessaires pour fabriquer et exploiter ces générateurs statiques, une
machine mise au point par Noël Felici. A la suite d'un accord passé
avec l'université de Grenoble et d'une prise de brevet (1947), Felici
et moi avons créé la S.A.M.E.S, une affaire absolument magnifique pour
le LEPM, surtout qu'après s'est développé le Centre d'étude nucléaire
de Grenoble (CEN-G) pour lequel elle a construit beaucoup de
générateurs électrostatiques. Elle a aussi développé des techniques de
poudrage pour l'agriculture (Truffaut) ou des peintures
électrostatiques.
Yves Rocard était l'autre physicien qui prônait ces relations recherche - industrie
Certes,
mais il était d'une autre coloration politique que Joliot. Peut être
savez vous qu'il a été candidat à sa succession au Commissariat quand
Joliot a été remercié en 1950. Il n'a pas été pris et il en a été très
vexé, mais il a eu un rôle capital dans les programmes du CEA. Rocard
était un excellent physicien, intéressé par les applications de la
recherche. Je trouve scandaleux que ses histoires de radiesthésie aient
incité certains de ses collègues, bien moins valables que lui, à
refuser son élection à l'Académie des sciences. Je pense d'ailleurs
qu'en reprenant son travail sur les ondes de manière scientifique, on
aurait pu obtenir des résultats extrêmement intéressants, en biologie
par exemple.
Autre entreprise grenobloise, les très basses températures
Le
Centre de recherche sur les très basses températures (C.R.T.B.T.) est
une autre de nos réalisations avec l'industrie. Les basses températures
sont devenues une spécialité grenobloise grâce à Louis Weil et un chef
de travaux grenoblois (Forer). Après sa thèse sur le magnétisme, Weil
s'est orienté vers les très basses températures et il a conçu un
liquéfacteur mixtes hélium hydrogène. C'était un homme d'affaire né et
nous avons créé une affaire qui a si bien marché que cela a fini par
inquiéter la société l'Air liquide. Moyennant quoi, celle ci a fini par
nous racheter en payant nos actions quatre fois leur prix d'émission. Nous
prenions aussi des brevets soit par l'entremise du CNRS, pour
l'électrostatique par exemple, soit via l'industrie pour les aimants
permanents avec Ugine. Le service des brevets d'Ugine, grâce aux
conseils de René Perrin qui était un métallurgiste éminent, était bien
meilleur que celui du CNRS. La preuve les brevets pris pour la
S.A.M.E.S. par le CNRS nous ont valu pas mal de procès avec les
Américains et la perte d'une centaine de millions.
La physique de l'état solide n'a donc que des relations indirectes avec la physique nucléaire et des particules
Je
trouve qu'on dépensait beaucoup trop d'argent pour la physique
nucléaire. Là, il me semblait que les choses étaient moins pressées. La
recherche de la grande unification est certes extrêmement intéressante,
mais qu'on la découvre aujourd'hui ou dans vingt cinq ans, au fond ça
ne change rien.
Le Centre d'études nucléaire de Grenoble (CEN-G)
J'ai
joué un rôle primordial dans cette création. Au début des années 1950,
nous ne faisions que du ferromagnétisme. Or dans le ferromagnétisme à
basse température les moments magnétiques de tous les atomes de fer
sont parallèles les uns aux autres. Il n'y a pas de problèmes. Mais il
existe des corps dont on ne comprenait pas le magnétisme. En 1947, j'ai
développé une théorie du ferrimagnétisme - avec un i - et que j'ai pu
expliquer quantitativement les propriétés de la magnétique. Le point
intéressant était que dans ce corps, tous les atomes de fer ont des
moments magnétiques, mais non parallèles, les uns dans un sens, les
autres dans l'autre. Nous avons alors envisager les moyens de
déterminer la maille cristallographique magnétique, c'est-à-dire de
pouvoir déterminer le moment magnétique des atomes en fonction de leur
position dans un réseau cristallin. C'est le genre de manips que l'on
ne peut faire qu'en diffractant des neutrons, parce que les neutrons
possèdent un moment magnétique alors que les photons n'en ont pas. Je
me suis dit : il me faut une source de neutrons, c'est-à-dire un
réacteur nucléaire. C'est l'époque où l'on commençait à parler de
réacteurs universitaires dédiés à la recherche et en 1953-54, j'ai
entrepris des démarches auprès du Commissariat à l'énergie atomique
afin qu'il nous aide à en fabriquer un, ce qui a donné la pile
'Mélusine'.
Vos relations avec le CEA
Il
est clair qu'on ne pouvait réaliser une telle opération dans un cadre
purement universitaire. Fort opportunément, c'était le moment ou le
Commissariat avait plus ou moins ouvertement décidé de faire de l'atome
militaire et de créer le département une Direction des applications
militaires (D.A.M.). Pour ce faire, le CEA avait créé un laboratoire
dans la région parisienne à Limeil-Brévannes. Or, une commission
chargée de l'aménagement du territoire trouvait que le CEA avait déjà
suffisamment de centres dans la région parisienne, Saclay,
Fontenay-aux-Roses, maintenant Limeil, et l'incitait donc à s'installer
en province. Dès que j'ai eu écho de cela, je me suis dit qu'il y avait
là les moyens de concilier les deux demandes. Il y avait d'ailleurs
d'autres candidats à la décentralisation des installations du CEA en
province, comme Toulouse, Lyon où le centre de recherche nucléaire ne
marchait pas très bien, voire Strasbourg. Mais dans cette dernière
ville le Centre de recherche de Kronenbourg avait eu de gros problèmes
de gestion, des arrangements douteux de l'un des directeurs [Cüer] avec
ses collègues allemands. Pour défendre Grenoble, j'ai fait valoir nos
avantages : l'importance qu'avait prise notre université, les stations
de ski toutes proches, les industries qui intéressaient directement le
Commissariat, Merlin-Gérin, l'hydraulique, etc. De plus, nous avions la
proximité de centres comme Cadarache et Marcoule. Finalement Pierre
Guillaumat et Francis Perrin les patrons du CEA ont choisi Grenoble.
C'est ainsi que je suis devenu le directeur du Centre d'études
nucléaires.
La construction du CEN-G
Au
commencement l'ambition était modeste. Guillaumat m'a demandé de
trouver une dizaine d'hectares pour installer un centre de recherches
d'environ deux cents personnes. Finalement je lui ai trouvé cent
hectares pour le prix dérisoire de cent millions d'anciens francs. Il
s'agissait d'un terrain militaire situé en bordure de la ville, que la
municipalité cherchait à reprendre, sans succès, et que j'ai réussi à
récupérer parce que j'avais fait valoir à la Défense qu'il ne
s'agissait pas d'y fabriquer des bombes atomiques. Cinq ans plus tard,
nous avions trente mille mètres carrés de surface couverte et nous
avions huit cents personnes. C'est moi qui ai conçu le plan masse. On
me reprochait de l'avoir dessiné de manière trop géométrique, pas assez
esthétique. En fait, le centre s'est développé d'un facteur dix et ce
plan est resté valable. De plus j'ai eu la satisfaction d'avoir fait
planter cinq ou six cents arbres qui sont devenus de grands beaux
arbres.
Un organisme mixte, CEA - CNRS
J'ai
profité du fait qu'étant à la fois directeur du CNRS et directeur du
Centre d'étude nucléaire de Grenoble du CEA, donc dépendant de deux
ministères, pour obliger les gens à travailler ensemble. C'était une
grande première. Le laboratoire d'électrostatique logé jusque là dans
les locaux de l'université s'était beaucoup développé et j'ai obtenu du
CEA qu'il cède une partie du terrain du polygone au CNRS afin d'y
installer le nouveau bâtiment qui lui était destiné. Puis nous avons
constitué un conseil scientifique mixte où le CNRS et le CEA étaient
représentés à parité. Ca a été une période passionnante. L'ambiance du
CEA était tout à fait différente de celle du CNRS. Il y avait
évidemment beaucoup plus de moyens, mais aussi beaucoup plus de liberté
et en même temps beaucoup plus d'autorité. Quand on décidait quelque
chose au Commissariat, les gens suivaient. Au CNRS, c'était une autre
histoire. Je me souviens par exemple d'avoir eu les syndicats à mes
trousses pour que je leur construise une cantine. «Il n'en est pas
question, vous irez manger à la cantine du Commissariat où vous pourrez
rencontrer vos collègues». En plus, il était plus facile d'organiser
une cantine pour mille personnes que pour cent. On a pu fonctionner
comme çà jusqu'à mon départ en 1970 dans une coopération très étroite
entre l'Université, le CNRS et l'Institut Polytechnique de Grenoble
dont j'étais aussi le directeur. C'était des charges assez lourdes,
mais j'avais de bonnes secrétaires de direction.
L'Institut Laüe - Langevin (I.L.L.)
L'installation
de l'I.L.L. s'est passée de la manière suivante. Au CEN-G, on avait
commencé par une première pile 'Mélusine' qui avait une puissance
thermique de un mégawatt (MW). Une machine d'ailleurs si bien
construite qu'elle fonctionne depuis trente ans à huit mégawatt,
c'est-à-dire à une puissance presque dix fois supérieure à celle pour
laquelle elle avait été conçue. Mélusine s'étant révélée insuffisante,
il a fallu prévoir une deuxième pile piscine, 'Siloé', conçue par Guy
Daniélou, un ancien de la Marine, ingénieur CEA, devenu ensuite
président de l'université de Compiègne. Construite pour 6 MW, 'Siloé' a
débité jusqu'à 45 MW. En fait, l'appétit vient en mangeant et on s'est
aperçu qu'on avait pas assez de neutrons, qu'il y avait des choses
beaucoup plus passionnantes à faire si on en avait dix fois plus et
l'idée du réacteur à haut flux nous est venue ainsi qu'à E. F.
Lewy-Bertaut, un cristallographe du CNRS, dynamique membre de
l'Institut. On a fait une première étude et on a vu que çà coûtait très
cher et que çà ne pouvait entrer dans les possibilités du CNRS. J'en ai
parlé à H. Mayer-Leibnitz un physicien allemand qui disposait d'une
grande influence dans les organismes de recherche allemands. L'idée de
faire un truc franco-allemand l'intéressait beaucoup, de là la création
de l'Institut Laue-Langevin dont il a été le premier directeur, celle
ci étant ensuite passée à ensuite à R. L. Mössbauer.
En tant que directeur du CEN-G, j'ai dit que je pouvais offrir 20
hectares de terrain. On a continué de bénéficier de l'excellent
environnement local en particulier du soutien du maire de Grenoble,
Hubert Dudebout, un ancien sous-marinier, directeur des relations
extérieures du CEA que j'avais fait venir au CEN-G. Il s'est préoccupé
des problèmes d'adduction d'eau à Grenoble, ce qui l'a mené à la
carrière politique que l'on sait.
Est-ce l'exemple d'une coopération internationale réussie ?
En
matière purement scientifique, on connaît les vertus d'une coopération
internationale, non exempte par ailleurs d'un fort esprit de
compétition. Mais les choses se compliquent dès qu'il est question de
développements industriels. Du point de vue du scientifique, c'est
toute la différence qui peut exister entre une publication et une prise
de brevets. Si vous prenez le cas du CERN de Genève, par exemple, son
grand développement me semble surtout dû au fait qu'il n'y avait aucun
enjeu en termes d'applications industrielles.
Finalement que tirez-vous d'une comparaison entre les modes de fonctionnement du CNRS et ceux du CEA ?
Je
ne peux pas dire que j'ai eu d'excellentes relations avec le CNRS. Je
trouve assez scandaleux de n'avoir pu obtenir de crédits d'équipement
avant la fin des années 1950. En fait, le CNRS a commencé à me donner
ces crédits au moment ou déjà j'avais fait vingt ans de recherche dans
le magnétisme derrière moi, donc quand je n'avais, au fond, plus grand
chose à raconter. Pareil en ce qui concerne ma présente dans son
conseil d'administration. Comme toutes les instances de ce genre il ne
sert à rien, sinon à entériner des décisions prises ailleurs. Je ne
parle même pas des derniers auxquels j'ai assisté et dans lesquels les
syndicats avaient pris un pouvoir outrancier. Cela m'a d'ailleurs
frappé si l'on compare le C.E.A. et le CNRS. Il y a des syndicats au
Commissariat qui sont très actifs, mais qui restent dans les limites de
leurs compétences, i.e. la défense du personnel. A l'inverse, au sein
du conseil du CNRS, les syndicats ont tendance à ne s'occuper que des
questions scientifiques, c'est absurde. Bref, j'ai préféré les modes de
fonctionnement du CEA. C'est un organisme structuré où les gens ont
l'habitude de commander et d'obéir. Tous les chefs de service que j'ai
embauchés au CEN-G venaient d'ailleurs de la Marine où ceci fait partie
de l'ordre naturel des choses. Quand on commande un bateau il faut se
faire obéir. Finalement, dans un grand centre de recherches comme le
notre, l'atmosphère était très bonne. On prenait une décision et
celle-ci était exécutée. A l'inverse dans les conseils de laboratoires
CNRS, on recommençait 'n' fois la discussion sur des problèmes aussi
idiots que celle de savoir s'il fallait fermer à clef, ou nom, le
laboratoire le samedi ! Au fond, quand j'étais dans la Marine pendant
la guerre sous les ordres de l'amiral Raymond Fénard qui était chargé
de la recherche, j'étais heureux. J'avais l'impression d'être sous les
ordres d'un gars qui était à sa place, qui savait faire avancer les
choses. Plus tard, avec des doyens d'université un peu apathiques et
parfois incompétents, évidemment c'était différent.