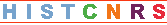En cas d'usage de ces textes en vue de citations,
merci de bien vouloir mentionner leur source (site histcnrs), ses auteurs et leurs dates de réalisation
Entretien avec Pierre Naville
Elisabeth Pradoura le 18 février 1987 (source : https://www.histcnrs.fr/temoignages.html)

DR
Pourriez-vous nous raconter votre entrée au CNRS ?
Je me suis toujours intéressé à la philosophie scientifique, à
l'épistémologie. Jusqu'à la guerre, j'ai mené une vie politique
militante, j'ai participé au mouvement surréaliste ; je suis entré au
Parti Communiste français durant la première guerre du Maroc contre Abd
El-Krim en 1925, alors j'étais soldat. À Moscou en 1927, pour le 10ème
anniversaire de la Révolution, j'ai soutenu les positions de Trotsky
(voir Trostky vivant).
Exclu du PCF en 1928, j'ai été l'organisateur du mouvement trotskyste
en France. Puis j'ai fait la guerre. Prisonnier, j'ai été libéré par
suite de maladie.
Pendant la guerre, j'ai passé le diplôme de
l'INOP sur des travaux liés à la psychologie de l'apprentissage. En
1943-1944, à Agen, j'ai été directeur du Centre d'Orientation
Professionnelle que j'ai fondé. J'ai repris, de ce fait, des études de
psychologie de l'enfant, étant en relation avec les écoles primaires
dans tout le Lot-et-Garonne.
Lors de mon retour à Paris en septembre 1944, j'ai repris contact avec
des maîtres en psychologie que j'avais connus personnellement durant la
guerre : Piéron et Wallon. J'avais alors publié un livre sur Watson.
Ils m'ont dit que j'étais fait pour la recherche, pour laquelle le CNRS
allait être recréé.
Plusieurs sections ont été créées, dont une commune de
sociologie-psychologie. Wallon, qui en était le président, m'avait dit
de déposer rapidement une demande avec un projet. J'ai été pris à
l'époque comme boursier, le grade d'attaché de recherche ayant été créé
un peu plus tard.
Les travaux de recherche sur la psychologie de l'enfant n'étant pas en
concordance avec l'action politique et avec l'action au sens large,
j'ai décidé qu'il fallait faire de la sociologie. J'ai donc fais de la
sociologie du travail à partir de 1949.
J'ai été membre de la commission de psychologie-sociologie qui s'est
scindée vers les années 1955, je crois. De jeunes sociologues très
ambitieux ne voulaient pas qu'on fasse de psychosociologie. L'offensive
psychanalytique amenait beaucoup de troubles. Les psychologues disaient
: "Il faut faire de la psychologie expérimentale, la sociologie c'est
autre chose".
J'ai fait comme tout le monde : j'ai cherché des crédits pour faire des recherches, au CNRS et ailleurs.
Je suis entré au directoire où je suis resté 12 ans. J'ai rencontré là
des hommes de toutes les sciences : c'est une expérience très
intéressante d'entendre des physiciens et des biologistes, par exemple,
discuter entre eux. Puis j'ai été élu membre du Conseil
d'Administration, comme représentant des sciences humaines. Le Conseil
d'Administration désignait un conseil restreint, dont j'ai fait partie,
qui n'avait pas d'existence officielle, mais qui prenait des décisions.
J'ai ainsi fait un certain nombre de missions : le directeur général
disait : "Allez donc voir ce qui se passe à Grenoble ou ailleurs, même
à l'étranger". Je suis ainsi allé à Berne : les Suisses nageaient dans
leurs cantons pour organiser leur recherche et demandaient au CNRS de
les conseiller.
Il y avait une tâche effroyable : l'examen des dossiers des
chercheurs. On m'en collait beaucoup et si on veut le faire
sérieusement, cela prend du temps ! Je n'ai jamais voulu faire de la
politique dans le CNRS. La recherche scientifique sérieuse n'est pas
une administration comme une autre ni un "truc" qui fabrique des
produits de consommation comme un autre. Je fais de la politique en
dehors. C'est pourquoi j'ai eu des conflits avec les syndicats, sur des
dossiers de candidature. Tous les syndicats en fait ont eu une
incidence sur la recherche, même s'ils s'en défendaient.
J'ai rendu service à beaucoup de gens, c'est inévitable (mais toujours, je suis revenu...).
Pourriez-vous me retracer l'histoire du Centre d'Études Sociologiques ?
Au bout de deux ans, Gurvitch en a eu assez ; puis ce fut le tour de
Friedmann. Sorre était un excellent type, mais déjà à la retraite et ne
voulant s'occuper de rien. Il a demandé un successeur : ce fut
Stoetzel. Celui-ci s'en remettait beaucoup à moi du fait de mes
fonctions dans le CNRS.
En 1968, il y eut la crise que d'ailleurs j'ai ouverte. Le soir même où
l'on a fermé la Sorbonne, j'étais à une conférence à l'INOP à propos de
la revue d'orientation professionnelle. Le directeur de l'époque, un
ancien collègue, avait ensuite rendez-vous à la Sorbonne. On l'appelle
au téléphone, il revient : "On m'a dit : ne venez pas, la police a
bouclé la Sorbonne et il y a une manifestation d'étudiants autour". Je
lui ai répondu : "Une situation de ce genre, on n'a jamais vu ça !". Je
téléphone à deux collaborateurs et le lendemain matin nous allons
proclamer la grève par solidarité avec les étudiants de la Sorbonne.
Puis, il y eut le mois de juin... Tout cela me gênait beaucoup pour mon
travail. J'ai profité de cette occasion pour démissionner de toutes les
fonctions que j'avais au CNRS, en août. J'ai remis tous mes mandats. Je
redevenais directeur de recherche "individuel", avec des
collaborateurs. Cela m'a permis de me reconcentrer sur mon travail
personnel.
Comment concevez-vous les rapports entre l'enseignement et la recherche ?
On m'a proposé plusieurs fois de devenir professeur à l'Université, à
la Sorbonne quand Aron est passé au Collège de France et quand Gurvitch
est mort. J'ai toujours dit : "Je ne veux pas". Je n'aime pas le côté
"ron-ron" de l'enseignement. J'ai fait des séminaires, j'ai remplacé
Friedmann trois mois aux Hautes Études... Je crois que j'ai bien fait :
l'enseignement absorbe énormément. J'ai vu tellement de chercheurs
virés à l'enseignement, donner des cours qui les prenaient
considérablement. Mon sort n'est pas très représentatif de la carrière
CNRS !
Ceux qui entraient à 25 ans avaient une perspective et une façon de
travailler différentes. Le rapport enseignement-recherche était celui
du passage de la recherche à l'enseignement.
La recherche, c'est fait dans la majorité des cas pour des jeunes.
Parce qu'ils sont jeunes, il faut qu'ils trouvent quelque chose de
nouveau. Vers 40-50 ans, son propre passé vient empêcher. On radote, on
devient sceptique. Si à 35 ans un type n'a pas montré qu'il est fait
pour ça, il n'a qu'à aller faire de l'enseignement ! Il faut forcer les
jeunes à travailler au maximum.
J'aime mieux penser le passage de la recherche à l'enseignement que le
détachement de l'enseignement pour faire une recherche... Quelqu'un qui
a enseigné pendant quinze ans croit souvent qu'il va se reposer !
Les universitaires, dès le départ, considéraient le CNRS comme un rival
: "Au CNRS, ils ne foutent rien, nous on a des horaires".
La disparité enseignement-recherche est très différente dans les
sciences naturelles classiques et dans les sciences humaines. Un
biologiste, ou même Piéron qui enseignait la psychologie au Collège de
France, faisaient de la recherche par nature dans leur enseignement.
Pour enseigner les sciences, il faut être au courant de ce qui se fait
comme recherche. Mais dans les sciences humaines, il n'y a pas le même
rapport enseignement-recherche. Par exemple, Balandier a choisi, aidé
par le CNRS au départ, l'enseignement, mais il a continué à faire de la
recherche. Friedmann a préféré le Conservatoire National des Arts et
Métiers, mais en tant que membre de la commission, il s'occupait des
recrutements de chercheurs.
De là où vous étiez au CNRS, comment avez-vous vu évoluer le Centre ?
Ce que j'ai vu changer, ce sont les rapports entre les organes et les
sections de base du Comité National. J'ai été longtemps partisan de ce
qu'on essaye de faire maintenant. Il faut qu'il y ait des centres ou
des laboratoires avec un statut et des programmes qui permettent le
contrôle. Au début, c'est très flou : les individus étaient sur leur
projet.
Stoetzel a justement demandé des locaux. Il a dit : je n'accepte ce
poste que si on me donne des moyens. Gurvitch avait loué deux pièces
près de Denfert-Rochereau, dans lesquelles il avait installé une
bibliothèque. C'était de l'individualisme.
Quand Pompidou était Premier ministre, le directeur général avait
proposé au Conseil d'Administration un budget dans lequel il n'y avait
aucun postes pour les sciences humaines dans les créations.
Naturellement, je ne pouvais m'en satisfaire. Le directeur général m'a
expliqué qu'il y avait été obligé par le ministère des Finances. Je lui
ai alors posé la question : "Est-ce que cela ne demande pas un recours
au Conseil Constitutionnel ?". Cela a fait du bruit, notamment auprès
des représentants et de Lejeune, alors directeur général adjoint pour
les sciences humaines. Le directeur général, Jacquinot, a retiré le
budget. J'ai fait un texte pour le directoire et les sections et on est
allé voir Pompidou en délégation. Pompidou a dit franchement le fond de
sa pensée : le CNRS n'est pas fait pour les sciences humaines, il faut
les renvoyer aux Universités. Les historiens ne font pas de recherches,
les philosophes non plus ! C'est lui qui avait dit au ministre des
Finances de couper.
Quelle image les "dirigeants" du CNRS se faisaient-ils des sciences humaines ?
Les gens des sciences humaines ne savaient pas se faire accepter convenablement.
La psychanalyse était détestée par tout le directoire : ce sont de
vieux positivistes sérieux. Une fois, il y avait là une thèse publiée
avec des illustrations de femmes nues, ils se tordaient : c'est ça, la
science !
Les anthropologues et les ethnologues avaient une meilleure audience,
parce qu'ils allaient faire des fouilles. Il y avait cependant des cas
où c'était des travaux très verbaux car ils n'allaient pas toujours sur
le terrain. Quand j'ai fait des travaux sur le travail, j'ai travaillé
en usine.
Lévi-Strauss disait : "Je ne peux pas voter sur tout. La science ne
connaît que le vrai ou le faux, quand je ne sais pas je ne vote pas".
Alors moi, je lui demandais ce qu'il faisait là...
Balandier, que je connais depuis qu'il est tout jeune, s'occupait de
l'ORSTOM, et j'ai participé à son comité de direction. C'est un
organisme qui s'est beaucoup développé et qui a été assez fécond, même
pour l'enseignement.
Le directoire accordait une aide aux philosophes pendant 4, 5, 6 ans et
même 10 ans, mais après il considérait qu'il fallait qu'ils aillent
dans l'enseignement.
Les mathématiciens disaient : "C'est très simple, il faut un
enseignement et de la recherche, mais la recherche en mathématiques est
tellement spécialisée ou imprévue que si au bout de 4 ou 5 ans un
chercheur n'a rien trouvé, il faut qu'il aille faire de l'enseignement"
(voir ce que dit Laurent Schwarz).
Ces problèmes ont périodiquement suscité cette idée : est-ce qu'il ne
faudrait pas faire un CNRS moins centralisé au sommet, qui comporterait
cinq ou six gros secteurs avec des statuts bien adaptés à chacun ? Les
sciences humaines seraient l'un de ces secteurs et ne viendraient pas
gêner les autres.
Les biologistes avaient plutôt tendance à former un milieu lié à la
médecine. Cela faisait des histoires parce que le CNRS recrutait des
médecins pour faire de la recherche, mais pour des industries
pharmaceutiques.
Après cette discussion avec Pompidou, j'ai reçu une invitation à
rencontrer Palewski, alors ministre de la Recherche. Palewski m'a
demandé : "Que voulez-vous personnellement ?... Faites un projet". Je
lui ai envoyé un projet d'institut de Sociologie qui comprenne le CNRS
et autres choses. Je n'ai plus eu de nouvelles.
Quand j'ai pris ma retraite, le rapport de l'état des choses entre
chercheurs CNRS et d'ailleurs montrait que le CNRS était une petite
minorité. Tout ce qui se faisait d'intéressant se faisait ailleurs
qu'au CNRS et en province.
Comment se pose la question recherche appliquée-recherche fondamentale?
Cette distinction n'a pas de sens. La seule distinction est à faire
entre ceux qui travaillent sur le terrain et ceux qui travaillent sur
les livres.
Prenons l'exemple de l'INED : la démographie, grâce à Alfred Sauvy,
travaille dans le concret. Mais pour les sociologues du CNRS : l'INED ?
Boff !
D'autres peuvent être portés sur la théorie, mais la théorie n'existerait pas si le terrain n'existait pas.
J'ai l'impression que vous manifestez une certaine ironie à l'égard des sociologues du CNRS ?
Il y a un peu de vrai. La sociologie est en recul complet au CNRS. Les
sociologues ne savent même plus de quel problème s'occuper ! Ils sont
devenus timides. En 1981, je leur ai dit : "Vous devriez foncer
là-dedans, ça va poser des problèmes". Au lieu de quoi... (geste vague)
Cela vaut pour tous les sociologues, qu'ils soient de gauche ou de
droite. Pourquoi ça ? De bonnes garanties n'incitent guère, mais c'est
aussi un problème à caractère national : en Grande-Bretagne, il y a une
atmosphère grouillante et une tradition empiriste ainsi qu'un souci de
répercussion qui les aident.
Il y a eu une époque, dans les années 1950-1970, où c'était différent :
on a recruté des tas de jeunes qui posaient des problèmes un peu
nouveaux. Je voyais de jeunes types et je me disais que dans dix ans on
verrait des choses jamais vues avant !
La Revue Française de Sociologie a
été fondée par deux ou trois amis dont Edgar Morin, sans l'appui du
CNRS au départ. On y a fait écrire des gens comme Roland Barthes, un
ami. Il y a eu des initiatives... En 1960, quand le CES s'est installé
rue Cardinet, ce fut une grande aide pour mon travail.
Dans les
années 50, l'automatisation était la clé de ce qui se passerait dans
les années à venir. Friedmann tenait au mot "industriel", pour moi
"travail" était plus large...
Le groupe de sociologie des religions par exemple a pris des
initiatives, mais depuis 68 ça a tourné au flou., certains sont passés
dans l'enseignement, d'autres se sont fatigués.
À la fin des années 50, il y a eu la création de la DGRST : comment le CNRS a-t-il réagi ?
Il y avait avant la commission Longchambon que de Gaulle a supprimée.
Elle disposait de crédits énormes. J'avais obtenu d'elle neuf millions
de francs lourds en 1957. Cette somme a été virée au CNAM et c'est le
Conservatoire qui l'a gérée.
Le Conseil d'Administration et le directoire se sont peu intéressés à
la création de la DGRST. Seuls ceux intéressés par la sociologie s'y
sont intéressés. Il n'y avait pas de lien organique entre la DGRST et
le CNRS. En 1967, j'ai commencé une enquête chez Renault sur les
rapports entre les transformations techniques et la situation
économique pour laquelle j'ai obtenu de l'argent de la DGRST.
De quelle nature furent les démêlés de Lefebvre avec la commission ?
Lefebvre ne faisait pas de politique au CNRS. À la commission, on se
demandait ce qu'il faisait... Il fraternisait avec Gurvitch...
Je pense qu'il faut faire ressortir l'idée d'une connexion vivante
entre des structures fixes et les besoins extérieurs et intérieurs. On
se place toujours sur un plan administratif, sur le plan de la
structure dans ce qu'elle a de stable, mais la recherche est quelque
chose de très spécial qui doit souvent varier d'objectif, de méthode,
etc. Le CNRS s'est bien développé sur le plan des structures et pas
assez sur le plan de la fluidité de la recherche, sur le plan des
contacts scientifiques. Le mot "pluridisciplinaire" n'est pas le bon,
il faudrait plutôt parler du mouvement de la recherche. Ce qu'on
cherche, c'est à résoudre des problèmes : il faut définir des problèmes
à partir d'une question qui n'a pas encore de problématique. Même si on
découvre que c'était un faux problème ou un problème mal posé, ce n'est
pas grave !
Le développement de l'ethnologie a eu un certain succès que n'a pas la
sociologie de nos pays et je le regrette. Balandier a eu des
discussions avec Lévi-Strauss qui ne voulait pas voir les nouvelles
formes... Dans sa préface à la seconde édition d' Anthropologie Structurale, Lévi-Strauss reconnaît les critiques.