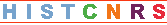En cas d'usage de ces textes en vue de citations,
merci de bien vouloir mentionner leur source (site histcnrs), ses auteurs et leurs dates de réalisation
 |
|
La direction des sciences du vivant (DSV) été installée par Claude Lévi en 1966. Il en est resté directeur une dizaine d'années et à la fin de son mandat, épuisé il s'est cherché un successeur. Moi, depuis le début des années 1970, j'étais à la direction des enseignements supérieurs du ministère de l'Education nationale qui avait à sa tête Jean Sirinelli (le père de l'historien). Je suis venu au CNRS en 1975 à la demande de Bernard Grégory le directeur général comme adjoint de Claude Lévi. J'avais une estime considérable pour Grégory. Un soir, je vais le voir dans son bureau du quai Anatole France, il ouvre son coffre et la seule chose qu'il y avait dedans était son paquet de cigarettes. "Je vous fais rigoler? Et bien je vous annonce une mauvaise nouvelle, je m'en vais". J'ai donc été nommé à la direction des SDV par son successeur, Hubert Curien. Je n'étais pas un grand scientifique, même si j'ai une culture générale en biologie et au delà, mais cela pouvait servir dans un organisme omni disciplinaire. Pour un directeur scientifique au CNRS, la première qualité est de comprendre les autres disciplines et d'oublier la sienne.
Vous avez contribué à appareiller la biologie moléculaire
Non, ça avait commencé avant. Il s'est trouvé qu'il fallait équiper des laboratoires, mais ça n'a jamais été la motivation initiale. Certes, j'étais microscopiste électronique puisqu'on ne pouvait plus faire grand chose en cytologie avec un simple microscope binoculaire. Mais je n'ai jamais considéré que les instruments étaient prioritaires. C'est exactement la même chose pour la biologie moléculaire, il s'agit d'un outil, pas d'une fin en soi. Le vrai problème est d'avoir une vue intégrée de la biologie. Je citais par exemple la neurobiologie qui était capable d'aller des aspects les plus moléculaires jusqu'au comportement et même au delà, la seule discipline à avoir ce continuum.
La discipline a eu quelque difficulté à s'imposer en France
Un jour j'ai dit à l'un des mandarins de l'époque dont je fréquentais le laboratoire, Pierre-Paul Grassé, que ce que faisait André Lwoff à Pasteur était très intéressant. Réponse de P-P Grassé : "Berkaloff, vous n'êtes plus des nôtres !". Reste que Grassé n'avait pas que des défauts, il m'a bien mis une douzaine de fois à la porte de son labo, ce qui prouve qu'il ne ma jamais jeté ! Certes, ses conceptions qui n'étaient plus celles des branches les plus avancées des sciences de la vie et ce n'étaient pas les miennes, mais l'ennui avec la biologie moléculaire est que cette approche extraordinairement réductionniste est en train de dépasser ses objectifs. Quand Piotr Slonimski dit que l'on peut tout faire sur la drosophile, il n'a pas tort à court terme, mais si sur le long terme. Quand on étudie un récepteur et un effecteur quelconque, à quoi cela peut-il servir si ce n'est pas pour les intégrer dans un système global? Il m'arrive de dire aux jeunes chercheurs, arrêtez de vous polariser sur les outils de séquençage et demandez-vous plutôt à quels problèmes vous devriez vous attaquer.
Quand vous dites que la biologie moléculaire est un outil, qu'entendez vous par là ?
C'est une nouvelle approche qui commence par une description de la nature en terme moléculaire et non morphologique. Ensuite, on essaye de comprendre et c'est la physiologie. Par exemple la relation entre une hormone et son récepteur, mais on ne peut pas en rester là et il faut intégrer ça dans un ensemble plus général. Bien entendu, j'ai vécu cette transition dans les sciences de la vie et je tire mon chapeau à Claude Lévi qui, bien que d'origine zoologiste et universitaire, a compris que la biologie moléculaire était une chance de renouveau pour la biologie. Autrement dit, il venait d'un milieu dans lequel une vieille génération de mandarins affirmait que la biologie moléculaire n'apportait rien. Mais il a compris que c'était un outil et quand j'ai pris la suite, j'ai bénéficié de cet élan. C'est lui qui a installé les grands labos de biologie moléculaire au CNRS.
Vous en avez tout de même installé quelques uns
Les deux seules créations réalisées pendant mon mandat sont l'Institut d'immunologie de Marseille (CIML) auquel le CNRS a un peu contribué en coopération avec l'Inserm et l'Institut de Toulouse en commun avec l'INRA (INP-ENSAT). Ce sont deux réussites mais on a échoué dans deux autres cas, à Lyon avec l'épidémiologie pour des raisons de politique locale et l'Institut de neurochimie à Strasbourg. Au début de la crise, ces nouveaux organismes s'inscrivaient dans la politique de décentralisation. On ne pouvait tout avoir à Paris, même si l'installation de nouvelles équipes était plus facile à installer qu'en province. Donc, en relation avec l'INRA, le CNRS et l'Université on a installé l'Institut des interactions micro-organismes à Toulouse pour travailler sur la fixation de l'azote dans les plantes. Puis cela a ensuite débordé sur la pathologie avec Jean Dénarié. Quant au CIML à Marseille, j'ai commencé par aller à Bâle avec le secrétaire général de Pasteur, pour rencontrer N. K. Jerne le pape de l'Immunologie et voir comment on pouvait s'organiser. Mais nous avons rapidement levé le pieds, le principal opérateur étant l'Inserm avec des gens comme François Kourilsky, Claude Mawas et d'autres, ce qui était d'ailleurs logique. J'ai simplement veillé à ce que quelqu'un comme Michel Fougereau, un universitaire qui voulait faire de l'immunologie, puisse venir au CIML. L'immunologie médicale n'était pas si glorieuse que ça à l'époque. Je craignais que des gens comme Georges Mathé qui s’intitulait immunologistes n’interfère, mais il est vrai qu'il avait alors assez à faire à Villejuif avec son usine à gaz (l'ARC).
La gestion du département SDV
A la direction des SDV, j'avais deux ou trois aides, dont forcément un médecin délégué par quelque grand patron pour me surveiller. Je pouvais choisir mes autres adjoints qui furent Michel Imbert, Jean Guern et C. Costes à un moment donné. Il y avait une secrétaire, un homme exceptionnel, Pierre Arrighi, qui assistait à toutes nos réunions scientifiques. Arrighi avait donc notre opinion sur les chercheurs X ou Y et il en tirait les conclusions. Il me présentait un budget en disant là j'ai monté untel, là j'ai baissé et on faisait les dernières mises au point. Il avait la parfaite maîtrise de son outil et il me laissait le dernier mot, sans chercher à biaiser. De même, j'ai toujours trouvé auprès des administrateurs délégués une aide extrêmement précieuse. Ils me disaient l'état des lieux, je leur expliquais ce que j'avais envie de faire et ils me donnaient leur avis. Une fois que l'on s'était mis d'accord, je n'avais plus à m'occuper de rien. En revanche, les discussions avec les chercheurs étaient plus difficiles. C'était parfois orageux comme avec E. E. Baulieu, un endocrinologiste très dynamique que je respectais, bien que ce ne fut pas réciproque et qu'il le prenait de haut avec moi.
Le choix des responsables
Comment choisir un directeur de laboratoire, de département, voire du CNRS? Il y a deux solutions. Ou bien on sa repose sur une très forte personnalité scientifique à qui l'on donne tous les moyens et le choix des hommes pour réaliser son affaire. Mais lorsqu'il prend sa retraite, il faut tout fermer et réaffecter le personnel. L'autre solution consiste à prendre un honnête tenancier d'hôtellerie. Autrement dit quelqu'un qui veille à ce que la morale reste bonne dans l'unité dont il a la charge. Il assure une fonction de manager, d'animateur et on lui demande seulement de vous informer de qui il fait venir ou de qui il veut se séparer et pas de porter de jugement sur les performances de ses chercheurs. Quand on choisit une solution intermédiaire, on n'a que les inconvénients et aucun avantage. Quant au directeur d'un département scientifique, ce doit être un homme qui comprend les autres. Au CNRS, il doit suivre les meilleurs, mais pas les précéder. S'il est en tête, le risque est qu'il ne voit tout que de cet œil. C'est ce que je craignais lorsque Jacques Demaille, un médecin, a pris la direction des SDV, mais cela ne s'est pas produit. Certes, il avait un caractère difficile, une attitude délibérément provocatrice, mais c'était un créateur. En dehors de Montpellier, il a fait l'Institut des sciences du végétal (ISV) de Gif en se battant comme un sauvage. J'ai beaucoup travaillé avec lui pour la prospective de 1988. Un exercice que l'on n'a jamais refait au CNRS, ce qui est dommage. Cela consiste à réunir une quinzaine de scientifiques par périodes pendant un an pour faire de la prospective à court terme. Il était capable de poser des questions tout à fait générales alors que la biologie végétale n'avait pour lui pas d'intérêt particulier. Bien sûr il lui est arrivé de se bloquer avec l'Institut Pasteur, mais quel est le directeur des SDV-CNRS qui n'a pas eu d'ennuis avec l'Institut.
Les relations du CNRS avec l'Institut Pasteur semblent avoir été problématiques
Moi, j'avais beaucoup d'amis là bas et ça se passait bien, mais il faut reconnaître que Pasteur avait l'habitude de considérer le CNRS comme une vache à lait, juste bonne à fournir des postes. S'ils nous avaient dit on a besoin d'un poste, je l'aurais attribué sans problème car ils font de l'excellente recherche, mais les demandes m'étaient toujours présentées par la bande, untel disant : "je ne peux pas diriger mon labo, je suis trop occupé en tant que professeur, il faut que je passe DR" et ensuite le type finit directeur de l'Institut. Quant aux discussions sur la propriété industrielle c'était : "tout doit rester la propriété de Pasteur", alors que c'est nous qui payons les chercheurs. Je constate qu'il y a eu un petit changement, par exemple certains directeurs de labos payés depuis leur naissance par le CNRS, comme Luc Montagnier, citent leur appartenance au CNRS. En fait, Pasteur est peuplé d'universitaires et de chercheurs du CNRS, mais très peu de l'INSERM qui y a mis le haut-là. Nous au CNRS, on a joué le jeu car vu des Etats-Unis, en France la biologie c'est Pasteur et pas grand chose d'autre. Je n'ai aucun patriotisme d'organisme, je suis passé dans certaines d'entre eux, pas à l'INSERM, ni à Pasteur, mais à l'INRA avec le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). Selon moi, un organisme est un outil, pas une fin en soi. Même au CNRS, il y avait un patriotisme sympathique et je pense aux querelles de frontières entre départements. Avec Robert Chabbal en physique, Jean Cantacuzène en chimie, on n'avait pas de difficultés, mais de temps à autre surgissait un problème, "de qui dépend la commission de biochimie, est-ce qu'elle doit passer en chimie, à la biologie?" Cela provoquait tout un tintouin et je levais les bras aux ciel, "qu'est ce que ça peut bien foutre qu'elle soit ici et pas là? Est ce que ce n'est pas la preuve que le CNRS est un organisme capable de gérer les interfaces? Alors que l'on collabore avec les Américains, que l'on cosigne de plus en plus de manière internationale, vous êtes en train de vous demander qui fait quoi en France !". J'ajoute que la multiplicité de nos organismes est une énigme que les étrangers n'ont jamais résolue. Bref, cette multiplicité ne m'a jamais gêné, sauf quand elle empêche les coopérations.
Les relations avec les industriels
J'en ai rencontré dans certaines instances avec Bernard Gregory. J'avais en face de moi, Yvon Gattaz, ce progressiste bien connu, et Jean-Luc Lagardère. Quand on discutait de la revue 'IRBM' (Société française de génie biologique médical) pour pousser la génétique du type ancien comme complément de la génétique moléculaire, Gattaz intervenait "...euh, l'enseignement de la génétique...". Je me disais un fabricant de radiateurs électriques, qu'est-ce qu'il vient foutre ici. Je me suis renseigné, il avait suivi des cours du soir pour son propre plaisir, vous pensez! Quant à Lagardère il nous disait : "cessez de faire des innovations. Le temps qu'on développe une innovation, les choses anciennes ont tellement progressé qu'elles restent compétitives". Il parlait de l'argent qu'il avait jeté par les fenêtres pour les tubes de télévision, mais la biologie moléculaire, ça ne l'intéressait pas vraiment.
Les autres organismes scientifiques
Il y avait des difficultés avec l'Inserm et avec l'INRA, pas tant
avec les chercheurs qu'avec les directions. Alors que je n'étais pas
encore directeur des SDV, je déboule un jour dans le bureau de Constant Burg,
le directeur de l'Inserm, pour lui dire : "racontez moi ce que vous
faites, je pourrais vous dire ce que nous faisons, mais je suppose que
vous le savez...
- Non détrompez vous, me dit-il, mais à quel titre venez-vous me voir?
- Je viens à titre personnel car je m'intéresse à ce que vous faite".
Il l'a très bien pris et jusqu'à la fin du règne de son successeur, le
pauvre Philippe Laudat, avec lequel j'ai pu avoir une réunion
mensuelle. Evidemment, ce n'était pas désintéressé car dans les deux
cas nous espérions bien tirer les marrons du feu sous prétexte de
coopération. A l'INRA, je dois dire qu'avec Nicolas Pauly on a tout de
suite trouvé l'accroche intellectuelle. C'était quelqu'un qui avait les
pieds sur terres. On a lancé des opérations, ce qui ne nous a pas
empêché de nous engueuler régulièrement, mais aussi de s'entendre. Cela
n'avait rien de formel, mais chaque fois que les relations
industrielles s'en mêlaient, ça se gâtait, il est vrai que les
organismes sont là pour défendre les intérêts de la maison, mais tout
bon scientifique devrait s'intéresser d'abord à la science et pas à
l'organisme de rattachement qui est là pour l'aider.
Inserm - CNRS, casser les corporatismes
En ce qui concerne l'Inserm. Le problème était que nos règles d'évaluation étaient différentes. A l'Inserm il y a des critères scientifiques (i.e. de publications) pour simplement pouvoir voter sans parler d'être élu dans les comités scientifiques, alors qu'au CNRS tout universitaire a le droit de voter au comité national avec pour conséquence que tous ceux qui ne sont pas soutenus pour des raisons spécifiquement scientifiques ont le droit de voter et d'être élus. Mais l'Inserm a un autre problème, ses chercheurs disposent d'un salaire unique alors que leurs collègues PU-PH disposent d'un double salaire. Or, il faut se souvenir que l'Inserm faisait ses instituts, payait son loyer aux hôpitaux, sans aucun rapport avec le milieu universitaire ou hospitalier. D'autre part, sa coopération avec les autres organismes était quasiment nulle dans certaines disciplines comme la biochimie. L'Inserm ne tire pas partie d'une coopération avec le CNRS, pourquoi n'envisage t-il pas un mode de fonctionnement comme celui des NIH aux Etats-Unis? Le financement des sciences végétales par le NIH est très supérieur à celui de la 'National Science Foundation' parce qu'on y a compris que des problèmes de biologie végétale relèvent des sciences de la vie et sont susceptibles de les intéresser (mais il est vrai que le corporatisme des médecins américains existe aussi). Cela dit, l'Inserm a eu une remarquable succession de directeurs. Philippe Lazar a été l'un des plus extraordinaires et je lui tire mon chapeau. Bien que non médecin et qu'il ait été nommé grâce à une situation politique favorable, tout le monde a fini par reconnaitre ses compétences. Je souhaite qu'un jour on puisse avoir un D.G. comme lui au CNRS. Mais je pense aussi à Burg qui savait que s'il tombait dans le piège du corporatisme, il était foutu.
La recherche fondamentale et ses applications
En physiologie végétale à laquelle je m'intéresse pour ses débouchés industriels et autres, il n'y en avait presque plus rien au CNRS. Il y avait un trou, ou bien on le comble et on coopère ce qui s'avère souvent très laborieux, ou bien on regarde au cas par cas. Actuellement, il y a des domaines où l'INRA est plus fort qua le CNRS, par exemple l'entomologie qui n'existait plus. Ainsi, je dis que le jour où l'Inserm décidera de faire de l'entomologie à cause des parasites transmis par les insectes, je ne crierai pas au loup. Dans un organisme comme le CIRAD, j'ai eu une position différente que celle que j'avais au CNRS. On a des applications à considérer, comment organiser la recherche? D'abord, je veux que l'on maintienne 10 % de 'blue sky research' (chiffre au hasard, Pierre Aigrain évoquait un pourcentage de 5% chez Thomson). Pourquoi faut-il que l'on ait le meilleur modélisateur d'arbres du monde ? D'abord parce que cela soutient notre réputation, ensuite parce que cela ouvre une fenêtre sur l'extérieur. Mais c'est là que le conflit avec le CNRS risque de surgir. Il n'y a aucune raison de nous séparer de nos chercheurs les plus fondamentalistes. Il y une chose qu'on oublie souvent, c'est que les instituts de recherche ne règlent pas toujours tout comme il faut. En particulier l'accès à la science internationale. Prenons le cas des bibliothèques. Dans les institutions que l'on me faisait visiter, il y avait une petite bibliothèque par étage, ce n'était pas la bonne méthode : "vous allez chacun avoir 'Nature', 'Science' et vous n'aurez plus de crédits pour acheter d'autres revues. Votre bibliothèque doit rester commune. Je vais même plus loin, je veux une cafeteria commune et non une cafétéria par étage ou par service". Les machines à café qui traînent dans les labos sont un handicap pour la discussion scientifique. Dans les sciences de la vie au CNRS, on entend souvent les chercheurs dirent qu'ils ne veulent pas entendre parler d'applications. Je réponds que l'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. A partir d'une certaine taille, un organisme doit avoir une petite équipe qui s'occupe des applications, c'est une question d'assurance sur l'avenir. Dans les périodes de vaches grasses où il y a beaucoup d'argent pour le fondamental, il faut penser à son entretien pendant celles de vaches maigres. En sens inverse quand les gros contrats industriels arrivent, attention à renvoyer la demande vers les autres. Il n'y a que les chimistes qui vivent uniquement de leurs contrats et n'en ont rien à foutre du CNRS...
La gestion de la recherche revient à gérer des ressources humaines
C'est vrai dans une large mesure. Prenez l'hypothèse de la fermeture d'un institut ou d'un labo. On ferme et on a rapatriera les bons, ce qui est particulièrement facile dans une ville comme Paris, mais beaucoup moins en province. Là, quand un chercheur se fâche avec son patron - et les fortes personnalités doivent se fâcher avec leur patron -, ils n'ont pas de solution autre que d'émigrer. C'est moins vrai maintenant dans les grandes métropoles comme Toulouse, Marseille, Montpellier ou Lyon, mais cela reste tout de même une faiblesse. Je me souviens de certaines discussions au CNRS avec les financiers. Ils vous disent pour étoffer Limoges : mettez y vingt labos et vous n'aurez plus de problème. Lorsque je m'occupais des bourses OTAN, je privilégiais les gens de province car cela leur permet de rentrer chez eux sans drame si ça n'a pas marché pour eux. J'ai vécu cette situation au CNRS et en tant que directeur, quand on a des équipes pulvérisées, il faut demander l'autorisation pour qu'un technicien, un chercheur passe dans l'équipe qui est à l'étage au dessus, alors que s'il s'agit d'un institut, vous réglez l'affaire directement avec l'intéressée sans que personne n'en entende parler.
Comment se passe l'évaluation des chercheurs au comité national?
De mon temps ce n’était pas si mauvais que ça sauf dans certaines sections où le monolithisme syndicalo - intellectuel impliquait que l'on ne fasse pas de peine à un membre de la commission. Mais dans la plupart des cas, il était assez facile de démonter la manip en demandant des explications aux gens. En l'occurrence, un universitaire est souvent mieux armé qu'un chercheur pour ce faire. Il a eu à le faire avec des étudiants, il connait la pratique consistant à pousser les gens dans leurs retranchements. Moi même, je n'avais pas de mauvaises relations avec les syndicats. J'acceptais de discuter, bien sur pas avec les plus cons. Il m'est même arrivé de dîner avec certains d'entre eux après une réunion de section, surtout des techniciens. Je crois avoir eu le respect de tous les techniciens de quelque bord qu'ils soient car j'estimais qu'ils n'avaient pas assez d'accès au comité national ou à la direction. Quant aux syndicats de chercheurs, c'était très inégal. Il y avait ceux qui étaient d'une honnêteté scrupuleuse, qui veillaient à ne pas être favorisés en tant que membre d'une commission. Et puis il y avait ceux qui venaient à la soupe, pour avoir leur avancement. Plusieurs noms me sont restés à travers du gosier. Le pire, ce sont les mandarins qui soudoient les syndicalistes par des avancements. Mais je réfléchis, le monde étant tel qu'il est, quelle autre méthode vous permettrait d'obtenir un résultat. Il y a un point positif avec le Comité national, cela m'a été soufflé par Chabbal, un directeur de département ne peut pas faire n'importe quelle connerie car il sait qu'il devra s'en expliquer au comité national.
La crise de 1974 a t-elle eu des incidences sur la recherche?
J'ai vécu quelques années pénibles. En 1975, il n'y avait pas beaucoup de fric et j'ai encaissé la deuxième crise du pétrole en 1979. Vous me direz, cela peut être le prétexte pour se débarrasser de tout ce dont on veut se débarrasser. Mais on ne l'a pas fait car le problème avec une pénurie qui dure longtemps, c'est le risque de désamorçage de la recherche. Imaginez que l'on dise aux finances que l'on n'a plus besoin de notre augmentation de 10% par an! On continue donc d'embaucher et on recrute des gens qui se sont accrochés. Mais parfois on s'en repent amèrement. Je pense à l'embauche d'un directeur de recherche que l'on estimait exceptionnel et dont on s'est aperçu qu'il ne l'était pas tant que ça. Mon sentiment est qu'un chercheur CNRS n'est pas motivé par son salaire, mais par l'amour propre. Si ses conditions de travail baissent, il prend ça comme un affront personnel et non comme la conséquence d'une contrainte budgétaire. Mais baladez vous dans les labos, est-ce qu'ils manquent vraiment de moyens? Les Anglais sont descendus beaucoup plus bas que nous, en pratiquant une politique de sélection des plus féroce. La recherche anglaise va peut être en crever, mais ce n'est pas dit.
N'y a-t-il pas une incompatibilité entre vouloir faire avancer tous les fronts de la science et être le meilleur dans certains domaines?
C'est une question d'échelle. Ou bien on raisonne au niveau de la France et on dit qu'on ne peut pas tout couvrir et on ne peut pas mettre de l'argent n'importe, où bien on essaye d'équi-répartir, ce que l'on appelle le saupoudrage. Mais n'oubliez pas qu'une petite équipe qu'on fait décoller, parfois avec un patron ou un mandarin, il y a des jeunes derrière qui peuvent faire leurs premières armes jusqu'à la thèse. Il y a des domaines que j'ai essayé de relancer par exemple la systématique (taxonomie) qui était en train de crever. Elle était mal vue par les syndicats, mal comprise par les biologistes moléculaires. Mon idée était qu'affecter de temps en temps un poste sur 5 ou 10 à cette discipline ce qui n'était pas une catastrophe. J'ai du me battre pendant deux ans pour recruter un chercheur qui a atterri chez une dame qui faisait des lichens. Vu de loin, à une époque où les postes sont rares, c'est du saupoudrage, mais je pensais que si ce jeune était aussi brillant qu'on le disait, ca permettrait peut-être réamorcer la pompe. Dès que quelqu'un voulait faire de la systématique, on lui disait mon pauvre ami choisissez autre chose, vous en ferez après. J'avais été très frappé quand en physique du solide à Orsay dans les années creuses, il n'y avait qu'un candidat en 3ème cycle chez Friedel et de Gennes pour 35 offres d'emplois. On disait que la physique du solide n'avait aucun avenir...!
En 1966, le CNRS inaugure la procédure des laboratoires universitaires pour se rapprocher de la recherche universitaire
Les formations associées, c'est essentiel pour le CNRS puisque c'est là que l'on a accès aux jeunes. Vous êtes à Gif, vos étudiants sont à Paris. Vous n'aviez que ceux que vous voyiez par les universitaires, ils ne venaient pas spontanément. Dans mon institut de microbiologie, si on avait appliqué vraiment les critères de qualité du CNRS, j'aurais du être éliminé. Par contre je leur amenais l'animation scientifique grâce aux étudiants qui étaient au labo. A un moment donné, l'Inserm a fait de même avec ses 'Jeunes équipes'. Mais le problème des équipes associées a été biaisé par la délocalisation. On fout une équipe dans tel ou tel coin pour voir si ça démarre. Souvent c'est un type qui s'est expatrié pour une raison personnelle, qui est allé à Caen, à Lyon ou ailleurs. Donc le DSV va à Caen pour voir qui l'on peut faire, quitte à mettre de l'argent là-bas, au moins que ça serve à quelque chose. Il faut reconnaitre que l'on n'a pas toujours réussi. Si vous voulez avoir une des forces de frappe sur un sujet déterminé, il faut décider à priori, mais il ne faut pas se tromper. C'est là que le jeu du mandarin devient dangereux, il faut savoir si lui-même a prévu sa succession. Prenez le cas de l'Institut de neurobiologie de Paul Mandel à Strasbourg, une énorme usine bien supérieure à celle de Pierre Chambon qui en venait (il s'était déguisé en neurobiologiste à l'époque). Quand Mandel est parti, ça a fait un flop. Alors que dans une grosse équipe, les bons scientifiques sont jugés sur leur qualité, les universitaires ne peuvent pas faire de paillasse, sauf s'ils ont des chercheurs dans leur équipe qui font le travail. Mais vous ne pouvez pas trouver un assistant ou maitre-assistant qui puisse faire de la recherche qui soit compétitive avec celle d'un chercheur du CNRS. Moyennant quoi tout le monde lui passe devant. On parle des Américains, mais ils ont des petits auditoires, une charge universitaire allégée qui ne les empêche pas d'avoir des PhD qui constituent leur main d'œuvre.
Comment s'est opérée votre succession à la DSV
Je me suis aperçu que le choix d'un directeur au CNRS devenait une
affaire politique. Je m'entendais mal avec Alice Saunier-Seïté la
ministre des Universités nommé en 1979. Tous les gars avec lesquels
j'étais en bisbille allaient se plaindre à elle. Heureusement,
elle avait un homme remarquable dans son cabinet, un lyonnais qui avait
été plusieurs fois conseiller de ministres, Pierre Juillet, qui me
sauvait la mise. J'avais aussi des problèmes avec l'Académie des
sciences ce qui faisait se dresser les cheveux sur la tête de Robert Chabbal,
le directeur général dont on sait qu'il était toujours impeccablement
peigné! J'ai une grosse affaire avec un académicien Roger Gautheret qui
était parti en emmenant tout le matériel du CNRS à Lille en laissant
ses chercheurs tous nus dans son labo. Je voulais lui envoyer un
commissaire de police. Chabbal intervient : "écoutes, tu as assez
d'emmerdes comme ça avec l'Académie, laisses tomber.
- Je m'en fous, je ne suis pas candidat à l'Académie. Arrêtes si tu veux, moi je ne le ferai pas". J'ajoute que Pierre Creyssel,
le directeur administratif, était dans la boucle avec ses petites
combines et ses accointances franc-maçonnes. Reste que ma position
devenait intenable, la ministre m'envoyait des lettres comminatoires
que je jetais au panier. J'en avais marre et j'ai commencé à me
chercher un successeur. Je savais que Rogier Monier
pouvait prendre la suite, mais Alice a découvert qu'il avait été
communiste quand il avait 18 ans et elle lui a tiré dessus à boulets
rouges. Elle m'avait déjà fait le coup pour René Nozeran au conseil
scientifique du phytotron parce qu'il était membre du comité central du
PCF, mais je n'avais pas calé. Daniel Hartmann mon 'surveillant' à la
DSV qui était piloté par Jean Bernard, Jean Hamburger
et la clique médicale lorgnait sur le poste. Avec l'aide de Demaille
qui était au ministère, j'ai réussi à glisser quelques peaux de bananes
et finalement Monier a pris la suite en 1982.