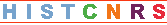En cas d'usage de ces textes en vue de citations,
merci de bien vouloir mentionner leur source (site histcnrs), ses auteurs et leurs dates de réalisation
Jean Wyart, la naissance du CNRS
Entretiens avec J.-F. Picard, E. Pradoura, les 5, 12 et 20 mars 1986 (source : https://www.histcnrs.fr/temoignages.html)

DR
Voir aussi : 'La République des Savants revisitée. Du CNRS à l'ANR un siècle d'organisation de la recherche scientifique en France' (J-F Picard, janv. 2022)
Vous avez été témoin de la naissance du CNRS...
...et aujourd'hui, le CNRS est mort. Enfin, je veux dire qu'il n'a plus
cette liberté du début, qu'il est devenu très administratif.
Maintenant, quand on veut une mission, il faut prévenir deux ans à
l'avance, c'est grotesque. Le CNRS après de beaux débuts a eu des
fonctionnaires qui jouaient les importants et qui ont empêché les
scientifiques de travailler. Il avait été créé par des professeurs
d'université qui voulaient une certaine liberté. La recherche a besoin
de liberté. Avec le CNRS, on a voulu se libérer du poids de
l'administration. J'ai connu cette première période, c'était
magnifique. Il y avait des types responsables, Laugier et Longchambon,
ensuite Jacob et Dupont, après ce fut Joliot. La belle période, ça a
été ça. C'est une question d'hommes. A l'origine, l'affaire était purement dirigée vers les sciences exactes
et un peu vers la biologie, mais en retrait. La biologie n'avait pas
encore subi sa transformation moléculaire. La biologie moléculaire est
d'ailleurs une conséquence des progrès apportés par les méthodes
physiques - et en particulier les rayons X - dans la détermination des
structures atomiques. La biologie a pris son essor bien après la
guerre, lorsque l'on a commencé à faire l'analyse de structures de
molécules compliquées à partir des cristaux, de la diffraction
cristalline des rayons X. Au début donc, c'étaient les sciences
exactes, les mathématiques et l'astronomie tenaient la vedette, puis
venaient la physique et la chimie.
L'origine du CNRS remonte au Front Populaire. Le président du Conseil,
Léon Blum, avait demandé à Jean Perrin ce qu'il voulait faire. Perrin
était un type merveilleux, mais il était un peu pagaye. Il donnait un
rendez-vous et il ne venait pas. Il était d'une gentillesse extrême,
mais ce n'était pas un administrateur, au contraire. Très rapidement,
il a conseillé au gouvernement de créer un sous-secrétariat d'Etat à la
Recherche scientifique qui a été confié à madame Joliot. Mais ça
embêtait celle-ci et elle ne savait pas trop quoi faire. Au
gouvernement non plus, on ne savait pas. Puis, il y a eu l'histoire des
médailles. Le gouvernement avait dit à Jean Perrin et aux savants qui
l'entouraient et avaient la réputation d'une sensibilité de gauche : on
va vous donner un budget et vous vous débrouillerez. Vous êtes mieux au
courant que nous de ce qu'on doit faire pour aider la recherche. Au
début, on a donc créé quelques postes de techniciens pour les mettre à
la disposition des chercheurs. J'ai eu l'un des premiers en 1937. On a
donc embauché une dizaine de 'travailleurs scientifiques', des
ingénieurs chômeurs intellectuels. J'ai donc eu l'un des tout premiers,
Salaignac, un type admirable qui travaillait auparavant dans un
laboratoire médical où il faisait des clichés aux rayons X. Je l'ai
recruté par l'intermédiaire de Pierre Urbain, le fils de Georges
Urbain, le pontife qui faisait un peu la loi avec Jean Perrin dans le
monde scientifique de l'époque. Il y avait donc déjà vaguement l'idée
de créer ce qui est devenu ensuite le CNRS. C'est à dire un organisme
qui recruterait des gens qui pourraient faire carrière dans la
recherche (comme aujourd'hui) en leur donnant des moyens de
fonctionnement en dehors de la lourdeur de l'Education Nationale.
L'affaire des médailles
Donc Perrin et son groupe ne savaient en fait pas trop quoi faire.
Subitement, quelqu'un a eu une idée lumineuse : des médailles pour le
prestige de la science. On va créer un grand prix, dans le style du
Nobel, un Nobel et des petits sous-Nobel, des tas de médailles, le vrai
gag ! Mais des appétits se sont éveillés. A Paris, le milieu
scientifique était plutôt pour les médailles. Mais assez rapidement,
l'affaire a fait scandale. On savait qui allait avoir la première, il
s'agissait de Georges Urbain. Puis on a vu arriver une masse de types
qui faisaient de la lèche à Urbain pour avoir les suivantes. Là-dessus
mon camarade normalien André Weil est intervenu pour contrer cette
affaire de médailles. C'était le frère de la philosophe Simone Weil, un
professeur de mathématiques à l'université de Strasbourg, le pape des
Bourbaki, le groupe de mathématiciens qu'il avait créé. C'est un type
qui avait la foi de sa soeur (elle est morte tragiquement en Angleterre
pendant la guerre) et qui, étant pacifiste, a refusé d'être mobilisé à
la déclaration de guerre. Comme officier, il a été dégradé, puis il est
parti en Amérique où il est devenu l'un des grands mathématiciens
mondiaux avant d'être élu à l'Académie des Sciences. Avec Weil, dans le
camp des anti-médailles, il y avait Yves Rocard et toute une bande de
normaliens provinciaux dont mon grand ami Jean Delsarte professeur à
Nancy.
Yves Rocard était un type génial, lors qu'il n'avait que 25 ans, il
avait élucidé un terrible accident de chemin de fer, le déraillement
inexplicable d'un train qui avait provoqué des centaines de morts.
Rocard était extrêmement fort pour tout ce qui concernait les
phénomènes vibratoires. Le bon physicien, c'est le type qui devant un
phénomène, sait classer les paramètres par ordre de grandeur. Dans le
cas du déraillement, il a réussi à éliminer toutes les causes
superflues pour arriver à une équation extrêmement simple, celle du
pendule amorti. Mais pour arriver là, il faut être génial. Quand il a
annoncé son résultat, personne ne l'a cru, une blanc-bec qui sortait à
peine de la faculté. Mais des expériences sur modèles réduits ont
prouvé qu'il avait raison. Par la suite, on a eu recours à lui pour la
construction d'un pont sur la Seine. Puis pour concevoir des ailes
d'avion. Bref, il a joué un rôle énorme dans la recherche. Moi, j'étais le seul anti-médailles parisien. Il y avait aussi Henri
Cartan dans ce groupe. Bref, je me souviens des démarches à la Chambre
des députés et au Sénat. Nous étions très remontés, notamment Rocard
qui publiait des pamphlets anonymes ! Nous avions la conviction que ce
système de médailles était en contradiction avec l'idée qui aboutirait
au CNRS. Nous pensions que plutôt qu'un système de récompenses, il
fallait organiser un service qui puisse acheter de l'appareillage
scientifique, financer des mission, payer des collaborateurs
techniques, etc. Finalement, c'est cette situation qui a prévalu. Nous
étions très jeunes à l'époque, nous étions donc assez accrocheurs, mais
il y avait tout de même avec nous des gens plus rassis comme Henri
Laugier, un vrai politique. Laugier avait un titre de Professeur, mais
en fait il n'a jamais fait de cours.
Le rôle de Laugier et
de Longchambon dans la genèse du CNRS
Indiscutablement, Henri Laugier a joué un rôle considérable dans la mise en
place du CNRS. C'était un type éblouissant, extraordinaire, mais il est
évident qu'il était moins scientifique que politicien. Cela dit, il
aimait la science et nous disait même comment il fallait faire des
cours. C'était un radical socialiste, l'éminence grise d'Yvon Delbos
qui avait été ministre de l'Education nationale et qui a joué un grand
rôle sous la troisième République. C'était un humoriste qui adorait
tendre des piéges aux gens. Il aimait voir comment ils allaient réagir
quand il distribuait les fonds secrets, ça l'amusait. Il prenait la vie
sous une certaine forme, il était resté célibataire, mais il était lié
à la femme d'un sénateur d'Oran (mme Cutoly), une personne qui
s'occupait de peinture et Laugier était très amateur d'art. Il lié à
Picasso, à Matisse. Il avait une collection de tableaux sensationnelle
dont il a fait don à l'Etat à sa mort. Quand les médailles ont étés
balayées, Henri Laugier et le comité des normaliens qui avait oeuvré
contre, ont créé le CNRS Appliqué en 1938. Laugier s'est alors établi
Quai d'Orsay au service de la Recherche, devenu depuis quai Anatole
France (le siège du CNRS). Il y avait là un appartement au quatrième
étage. Il s'agissait d'assurer la succession du sous-secrétariat d'Etat
de madame Joliot qui s'en était débarrassée sur Laugier. Il a pris
madame Mineur comme secrétaire et comme directeur adjoint, chargé des
applications techniques, Henri Longchambon, auquel j'ai succédé à la Sorbonne.
Quand j'étais à l'ENS, je faisais de la physique avec Eugène Bloch (qui est mort plus tard dans un camp allemand) et qui
était lié avec Charles Mauguin,
professeur de minéralogie
cristallographie de la Sorbonne. En 1925, c'est Bloch qui m'a envoyé
chez Mauguin, lequel avait besoin de quelqu'un pour faire ses calculs.
C'est comme cela que j'ai été attiré par les rayons X puisqu'il était
alors le seul à en faire en France. Comme assistant dans ce
laboratoire, il y avait Henri Longchambon qui venait d'être nommé
maître de conférence, puis il a été nommé à Montpellier et enfin à Lyon
ou il est devenu le plus jeune doyen de fac de sciences de France.
Bref, c'est Longchambon qui m'a conseillé de rester à l'université
plutôt que de retourner à l'ENS. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est
que Longchambon est devenu ministre par la suite (ministre du
ravitaillement après la guerre), donc que j'ai eu comme prédécesseur un
ministre, mais aussi comme successeur dans ma chaire de Jussieu, avec
Hubert Curien ministre de la Recherche dans les années 1980. En 1938,
Longchambon arrive donc de Lyon pour s'occuper de la recherche
appliquée dans ce CNRS qui n'était guère plus que cet appartement du
quatrième étage du Quai d'Orsay. Dans son équipe il y avait Boutillier,
un
très brave type, mademoiselle Lapierre sa secrétaire et un troisième
dont le nom ne me revient pas (il avait vaguement été ingénieur des
T.P. à Lyon), mais qui a joué un grand rôle notamment pour s'occuper
des travaux lancés par le CNRS. A l'époque, j'étais maître de
conférence, ayant été nommé en 1933 à la Sorbonne. Dès son arrivée,
Longchambon m'a appelé pour me demander si je pouvais l'aider. C'était
un copain, on se tutoyait. C'est comme cela que j'ai assisté à la
naissance du CNRS.
Création du CNRS Appliqué (CNRSA)
C'était pittoresque. Tous les types travaillaient comme des brutes,
aussi bien Henri Laugier, plus fantaisiste et plus politique, qu'Henri
Longchambon, plus introverti et plus organisateur. A minuit, tous
étaient encore au quai. Moi, j'y retournais le soir, après mes cours.
Minuit passé, nous allions chez Longchambon qui habitait un hôtel à
Saint-Germain. On travaillait vraiment dur. La guerre arrivait. En
1938, c'est Munich. Il s'agit d'équiper les laboratoires. Il faut
préparer la recherche pour la guerre. C'est comme cela que nous avons
bâti le CNRS avec une structure qui a ensuite été fortement
perfectionnée par Joliot. Après Munich, on s'est dit : quels sont les
types qui pourraient être utiles pour la préparer cette guerre du point
de vue scientifique ? Même si ça ne sert pas, il faut que nous fassions
un inventaire des laboratoires français, inutile de donner des
équipements à des gens qui n'en auront aucun usage. Laugier et
Longchambon ont donc imaginé d'installer un corps de chargés de
missions. Il y en a eu quatre : Andant, adjoint d'Aimé Cotton et
professeur à la Faculté de pharmacie, Georges Champetier le chimiste, Félix
Trombe et moi. Chacun faisait son boulot. Nous n'étions pas appointés.
Quoique chargés de mission, nous n'avions aucun statut. On nous payait
notre billet de chemin de fer et c'est tout. Nous nous étions partagés
la France pour faire cette grande enquête sur l'état des laboratoires.
On s'occupait de toutes les disciplines dans chaque université visitée,
cela pour ne pas perdre de temps. Je suis allé à Lille, à Strasbourg, à
Marseille, à Montpellier et à Grenoble. Je faisais mes cours au début
de la semaine et dès le mercredi soir je prenais le train. Quand on
allait à Marseille, il fallait y passer la nuit. On restait deux jours
dans chaque université pour voir tous les laboratoires. Je me souviens
de Grenoble où l'université était toute neuve, mais où on ne faisait
rien. On trouvait dans les couloirs des appareils qui avaient coûtés
très chers et qui étaient là depuis deux ans sans avoir été jamais
déballés.
Les gens se laissaient vivre. Ils avaient leur métier, ils donnaient
des cours, ils avaient des heures supplémentaires et puis, il faut
reconnaître qu'ils n'avaient pas d'aide. Un professeur était livré à
lui même, il devait faire ses manipulations tout seul. Alors on finit
par se fatiguer. Au début, quand je faisais mes rayons X dans le labo
de Mauguain, avant d'avoir Salaignac en 1937, je fabriquais moi même
mes tubes à rayons X. Il fallait faire le vide. S'il était insuffisant.
Paf ! on allumait un arc électrique. Le téléphone sonnait, il fallait
tout arrêter. Ensuite tout remettre en route, faire le cliché. C'était
long et on ne pouvait faire que ça. Quand on a eu les aides techniques,
ça a été un grand progrès. En province, les gens resté livrés à eux
même finissaient par se fatiguer. A l'étranger, dans les laboratoires anglais que je
connaissais bien, il y avait des techniciens. Le recrutement de
techniciens, cela a été le principal argument en faveur de la création
du CNRS. Plutôt que des médailles, ce que nous voulions, c'était des
aides pour faire nos manipulations. Pour développer des photos par
exemple, il n'est pas besoin d'être un grand savant. Auparavant, à la Sorbonne, nous devions manier le balai
nous-mêmes pour avoir des laboratoires propres. Le notre était
d'ailleurs le plus propre de tous. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a
du personnel d'entretien, mais il coûte cher et c'est bien moins propre
qu'avant. Il n'y a pas de doutes qu'il ne faut pas trop d'organisation.
Il faut être un peu anarchiste pour faire de la science.
La mobilisation scientifique
Notre enquête a servi à préparer la mobilisation scientifique.
J'insiste sur ce
point, avant la défaite de juin 1940, le CNRS a fait un énorme travail.
C'était une ruche. Au moment de Munich, j'ai été mobilisé comme
observateur en ballon d'observation dans l'Est, à Metz. J'y suis resté
deux mois. Longchambon et Laugier trouvaient ça idiot : "Wyart dans un
ballon... !". En plus le ballon d'observation c'était bon pour la
première guerre mondiale. Moi, je n'aimais pas beaucoup les militaires
et j'étais allé dans les ballons parce que je trouvais ça grotesque.
Laugier et Longchambon se sont donc dit, après Munich, "plus question
de faire des conneries pareilles". Si la guerre survient, il faut
préparer une liste des types disponibles et une autre des problèmes que
l'armée va nous poser. Déjà l'Armée posait des questions grâce à un
universitaire qui jouait un grand rôle dans les services de recherche
de la Marine, Charles Fabry. C'était un
spécialiste de l'optique. Au titre des recherches militaires, il nous a
chargés de fabriquer des gros cristaux pour lentilles infrarouges. Il
s'agissait de détecter des cheminées de navire la nuit ou par temps de
brouillard. Les Allemands aussi s'occupaient de ce genre de trucs.
Beaucoup de laboratoires étaient dans cette situation. Le CNRS était en
relation avec le grand Etat-major et on a vu ce que c'était... Il y
avait un service de sourciers qui faisait du repérage avec des
pendules. Effrayant ! Je me souviens ils étaient à Fontainebleau. Je
suis allé plusieurs fois là-bas. Il est vrai qu'à l'époque, nous étions
jeune et que nous voyions facilement les travers des gens. Arrive
septembre 1939 et ce qu'on a appelé très vite la drôle de guerre. Moi
je suis rappelé tout de suite. On a monté un ballon, mais ils l'ont
foutu par terre et on est resté là. Les types passaient leur temps à
jouer au bridge et à boire du pernod.
Tous les scientifiques n'ont pas été mobilisés au CNRS, ça dépendait des services et des besoins. Par exemple, Jean
Cavaillès comme littéraire a été versé dans l'infanterie. On n'a
rappelé qu'un tout petit nombre de gens pour des taches bien précises
ou pour organiser des laboratoires. Dans les ballons où il n'y avait
rien à faire. On n'a donc fait aucune difficulté pour me laisser
partir. J'ai donc été affecté à Paris pour fabriquer des cristaux. De
plus, j'allais constamment au CNRS qui était, comme je vous l'ai dit,
une ruche bourdonnante d'activité. Inimaginable. Longchambon au milieu
de gens qui amenaient des idées, qui venaient avec des demandes de
renseignements.
Il y a eu des affaires assez cocasses comme celle de ce
type, subventionné par l'armée, pour son invention du rayon de la mort.
J'apprend l'affaire parce que je passe par hasard dans le bureau de
Longchambon. Boutillier, l'un de ses chargés de mission, un type en or,
adorable mais naïf croyait dur comme fer à cette histoire de rayon de
la mort. Longchambon qui était un type un peu méfiant, il n'était pas
comme Laugier et n'avait confiance que dans ses collaborateurs immédiats.
Cette histoire de rayon de la mort, il disait, "si jamais ça marche, ce
serait tellement beau…" . D'ailleurs, l'inventeur paraissait
sincère. Bref, je bavarde avec le type et je m'aperçois
rapidement que les lois fondamentales de l'électromagnétisme ne
collaient pas avec son procédé. Immédiatement je dis à Longchambon :
"C'est une farce ce truc ! - Mais non, il y a l'Etat-major derrière et
le gouvernement…". Il s'agissait du Gouvernement républicain espagnol
en exil. Je me disais aussi, ce type est dingue, mais s'il avait raison
? Je dis à Longchambon : "il faut organiser une expérience. S'il
prétend pouvoir descendre un avion à 3000 mètres avec son rayon de la
mort, il doit pouvoir tuer quelqu'un à 10 mètres". On s'installe donc
dans mon labo à la Sorbonne à 11 heures du soir pour lancer l'affaire
en présence de Longchambon, de Laugier et d'une dizaine de types du
CNRS. L'etat-major était lui aussi représenté par quelques officiers,
le gouvernement provisoire espagnol par deux types, l'inventeur était
venu avec sa femme et son gosse. Il y croyait vraiment ! Je lui avais
dit que s'il pouvait abattre un avion, il devait pouvoir tuer 'una
palomba'. Dans une salle assez grande, on avait ouvert des couloirs et
je lui avais demandé ce qu'il lui fallait comme appareils. A sa demande
on lui avait fourni, ce qui m'avait paru bizarre, un arc électrique. Si
encore il avait eu besoin d'un générateur d'oscillations
électromagnétiques, mais non, c'était un arc électrique. Bref, on a mis
le pigeon dans une cage, on s'est tous reculés et il a lancé son fourbi
vers la cible. Tout le monde s'est mis à tousser, il y avait du chlore
dans son bazar. Mais la palomba ? Elle roucoulait. Voilà le genre de
choses qui occupaient certains grands esprits pendant cet hiver 1939-40.
Mais il y a eu aussi des travaux extrêmement importants dans le domaine du magnétisme. C'est l'oeuvre de Louis Néel,
il s'agissait d'éviter que les navires ne sautent sur des mines
magnétiques allemandes. Il fallait désaimanter les bateaux. Dès le
début ils ont travaillé la dessus, Néel, Rocard. Ce dernier a continué
ensuite pendant la guerre à Londres. Il y avait aussi l'équipe Joliot,
mais je ne la connaissais pas à l'époque, sauf un garçon qui avait fait
sa thèse en chimie physique avec Edmond Bauer et qui s'appelait Lew
Kowarski. C'est moi qui l'ai fait entrer chez Joliot. J'avais fait
partie de son jury - puisque son sujet concernait la croissance
cristalline - et il m'avait demandé ce qu'il allait faire maintenant
qu'il avait soutenu sa thèse, je lui ai conseillé d'aller chez Joliot.
Celui-ci venait d'être nommé au Collège de France et Kowarski a du le
rejoindre vers 1936.
La débâcle du printemps 1940
Arrive le mois de mai 1940. La percée, la débâcle. Les allemands
arrivent. On était trahi, il n'y a pas de doute. Je revois l'un de mes
amis, Billiet, un professeur de l'université de Gand en Belgique qui
avait travaillé avec moi et qui était venu de là jusqu'à Paris à pieds,
pourchassé par les allemands qui avançaient à toute vitesse. En
arrivant il s'était rendu au Ministère de l'Information, celui de
Giraudoux, où les Belges devaient se présenter. En revenant, il me dit
:"Mais dites donc, vous êtes trahis, c'est une bande de traîtres que
vous avez là. Tous ces types se réjouissent de voir les allemands
arriver". Il faut bien le dire. La moitié de la France était déjà
pétainiste, la peur du Front populaire ! Déjà, vers la mi-mai,
l'atmosphère de débâcle m'avait frappé. J'avais mes parents à
Abbeville. Je me dis : je vais aller les chercher. Je prends un ordre
de mission que je fais signer par Longchambon, puis j'enfile mon
uniforme de lieutenant et me voila parti pour Abbeville. A Chantilly, à
trente kilomètres de Paris, plus moyen de passer. Des avions
bombardaient. Les routes étaient encombrées. J'essaie de me faufiler.
Je passe les premiers postes. Ou sont les allemands ? Personne n'en
savait rien …et Abbeville était prise depuis deux jours ! Je suis
retourné à Paris le soir, complètement dégoûté, je vais au CNRS où je
vois arriver Louis Néel qui revenait de Dunkerque à pieds. Lui qui est
infirme, qui marche difficilement, il était parti dans des conditions
infernales. Sale, furieux d'avoir été abandonné. Abbeville avait été
prise, bombardée deux jours auparavant et on ne le savait pas.
L'Etat-major n'était pas au courant, inimaginable. Je me souviens aussi
d'un déjeuner dans un restaurant près de la place de l'Opéra avec Jean
Perrin, Melle Choukroun son amie et madame Mineur. En sortant, on
annonce la déclaration de guerre de l'Italie à la France. Je revois
Jean Perrin poussant des cris d'indignation : "Chacals !, chacals !",
ce devait être entre le 10 mai et l'appel du général De Gaulle.
Quand les allemands se sont approchés de Paris, le CNRS à
commencé à
déménager ses archives dans des conditions de précipitation
inimaginables. Moi, je ne suis pas parti tout de suite. J'étais un des
rares propriétaires de voiture à l'époque et on me demandait sans arrêt
de faire des transports. Je me souviens de n'avoir pas dormi pendant
trois ou quatre nuits d'affilée à l'occasion. Je m'arrêtais une heure,
je dormais sur la route, je faisais la navette entre Paris et chez
Rocard qui avait une propriété dans la banlieue sud. J'y ai conduit
madame Rocard, madame Mineur et d'autres… Il y avait aussi un chargé de
mission de Longchambon. Enfin ils sont partis pour un château du côté
d'Azay le rideau, de l'autre côté de la Loire. Quand les allemands les
ont rattrapés, ils se sont dispersés, soit à Bordeaux, soit à Toulouse.
Personnellement, je n'ai quitté Paris que la veille de leur arrivée en
emmenant Charles Mauguin et sa femme, une personne parfaitement
détestable. Je les ai emmenés vers Toulouse. Je voulais rejoindre mon
centre de mobilisation qui s'y était replié. Je devais passer par
Saint-Etienne pour m'arrêter chez Neveux, un ingénieur important dans
la
métallurgie. J'avais aussi ma soeur avec moi, nous étions donc quatre
au départ. Nous sommes partis un soir et je suis arrivé le lendemain en
fin d'après midi chez Neveux qui, comme tous ces ingénieurs de grosses
boîtes, était admirablement logé dans un château avec parc. J'installe
les Mauguin, ils allument la radio et j'entends l'appel de De Gaulle,
nous étions le 18 juin…/ Puis on est reparti par Saint-Flour, par des
routes épouvantables, et on est arrivé à Toulouse où j'ai confié les
Mauguin à l'université et je ne les ai plus revus. Le père Mauguin m'en
a voulu longtemps. Toute la bande des cafards universitaires nous
regardaient de travers, madame Mauguin avait du déblatérer sur mon
compte. Je suis allé à mon bureau de recrutement pour demander à mon
commandant ce qu'on faisait maintenant. Réponse : on attend les
allemands. Il y avait cinq cents avions sur le terrain, tout neufs, ils
n'avaient jamais volé. Je vous dis qu'on avait été trahi.
A Toulouse, j'étais exclu de l'Université à cause de Madame Mauguin.
C'était inénarrable, toute la France scientifique était soit à
Bordeaux, soit à Toulouse. Quand j'ai entendu le commandant du
bataillon des ballons d'observation dire qu' on attendait les
Allemands, j'ai compris. C'est comme ça qu'un tas de types qui
n'avaient pas fait la guerre se sont retrouvés prisonniers pendant
quatre ans ! Je me suis donc démobilisé tout seul. Il a fallu revenir à
Paris. Il y avait le laboratoire et mon labo c'était toute ma vie. A
Toulouse, j'avais rencontré un certain nombre de bons amis, en
particulier Jacques Nicolle, le neveu du grand pasteurien, directeur de
l'Institut Pasteur qui avait été mon élève et qui travaillait avec Paul
Langevin. Et aussi Emile Audubert, professeur de chimie physique au
Conservatoire des Arts et Métiers. Nous nous sommes dit que la guerre
n'était pas finie. D'abord il y avait de Gaulle, ensuite on savait bien
que l'Amérique interviendrait un jour ou l'autre. L'Angleterre n'avait
pas lâché. Puisque les militaires ne voulaient pas faire la guerre,
nous nous sommes dit que nous, nous allions la continuer.
Le CNRS sous l'occupation
En septembre, à Toulouse, j'avais entendu dire que pour le CNRS, cette
créature du font populaire', Charles Jacob allait être désigné comme
chargé d'inventaire. Il devait préparer un rapport en vue de l'éventuel
rattachement du Centre à l'Education nationale, c'était à dire en fait
la suppression du CNRS. Il se trouve que je connaissais bien ce professeur de géologie à la Sorbonne, parce qu'il
était installé juste en face de mon laboratoire de la Sorbonne. Je le
connaissais également parce qu'il avait été l'un des tout premiers
élèves de mon maître Frédéric Wallerant. Sitôt rentré à Paris, je vais
le voir pour lui parler du CNRS. Il habitait place du Panthéon :
"qu'est-ce que c'est que cette histoire de liquider le CNRS ? Vous
n'allez pas faire le salaud ?". Je lui parlais comme ça alors qu'il
avait vingt cinq ans de plus que moi. Il me répond que le Front
Populaire, cela avait été "une bande d'excités, de farceurs qui avaient
du s'en mettre plein les poches, etc.". On l'avait chargé d'une enquête
avec l'idée de supprimer le CNRS, autrement dit de le fondre dans
l'Education Nationale. Il avait chargé de cette mission parce qu'il
était de Grenoble et que le ministre de l'Education nationale de
Pétain, Jacques Chevalier, un type qui devait être Action Française,
était lui aussi grenoblois. Ils avaient été étudiants ensemble.
Je n'ai donc connu intimement Charles Jacob qu'après ces événements, mais c'est vrai
qu'il était pétainiste. En fait, nous sommes devenus amis plus tard,
même si je ne lui ai évidemment jamais parlé de mes activités dans la
Résistance. Jacob a eu des malheurs considérables : il a perdu
tragiquement deux fils. Je les connaissais bien. L'un, polytechnicien,
était capitaine aviateur, parti à Londres, tombé en service commandé.
L'autre est mort tragiquement en montagne. A cause de ce second fils,
nous nous sommes rapprochés, j'étais devenu son confident. Mais en
1940, il était persuadé d'avoir raison. "Perrin et Cie., ce n'est pas
sérieux…/ Laugier, c'est un fantaisiste…/ Ils sont incapables de faire
une bonne gestion, etc.". La personne qui m'avait mis au courant du
rapport Jacob était Gabrielle Mineur, l'épouse de l'astronome, elle
aussi revenue au CNRS à Paris. D'autre part, Jacob avait un chauffeur,
une femme très liée à Paul Rivet. Bref, j'avais mes informatrices et
j'allais le voir de temps en temps. Un jour, il m'appelle : "je vais
vous faire lire les premières pages de mon rapport" . En fait, il
s'était rendu compte au fil de son enquête que les types ne s'étaient
pas remplis les poches. Bon, Charles Jacob a été pétainiste, il n'y a
pas de doute, mais c'était un type honnête. Son enquête lui avait
montré que ses préjugés étaient infondés, que notamment personne ne
s'était enrichi grâce au CNRS. Il a donc rédigé un rapport favorable
qu'il a remis à Chevalier : "ils n'ont pas triché, ces types ont bien
travaillé, le CNRS est utile" et le maintien du Centre a été
officialisé, Charles Jacob en étant nommé directeur, avec comme adjoint
Georges Dupont le directeur de l'ENS.
Sous l'occupation, la recherche était ultra modeste et, en plus, on n'avait pas
d'argent. Notre laboratoire de la Sorbonne n'a jamais été chauffé de
toute la guerre. On n'avait pas de crédits… Et puis, nous n'allions pas
collaborer avec les Allemands, quand même ! Nous avons recommencé à
travailler à l'automne 1940. Pour faire marcher notre tube à rayon X,
nous avions un redresseur de vapeur de mercure, c'était le seul endroit
où on était chauffé la nuit. On mettait une petite résistance
électrique pour maintenir une certaine température dans ces redresseurs
et c'est comme cela que nos tubes à rayon X ont toujours marché. Dans
ces conditions difficiles, il s'est surtout agi de maintenir l'acquis.
Jacob se préoccupait moins de recherche que de maintenance. Tout comme
Gramont à l'Institut d'Optique. Il y avait là une grosse société de
fabrication d'appareils optiques qui fournissait la Marine avant guerre
et ils ont sans doute été obligés de travailler pour l'occupant. Mais,
ils essayaient de préparer l'avenir, par exemple ils ont créé le
'Foca', un appareil photographique qui est sorti après la guerre, cela
permettait d'occuper les gens, tout en travaillant au ralenti pour les
Allemands.
La Résistance et les scientifiques
Au début de la guerre, les Allemands ont arrêté Charles Mauguin, Aimé
Cotton, Emile Borel et ils les ont mis en prison, mais il s'agissait de
mesures d'intimidation. Mon premier contact avec la Résistance a été Jacques Salomon, le physicien gendre de Paul Langevin. J'ai du le
rencontrer par l'entremise de Nicolle qui travaillait chez Langevin.
Les premières réunions de ce qui allait devenir le Front national
universitaire ont eu lieu dans mon bureau et c'est là que j'ai connu
plus intimement Joliot. Mais Jacques Salomon arrêté très vite a été l'un
des premiers fusillés. Il y avait le monument aux morts dans le couloir
de la Sorbonne et nous avions fait une manifestation. Charles Montel,
le doyen, était venu nous engueuler. Il n'aimait pas les allemands,
bien sur, mais il n'aimait pas non plus la prison. Alors, nous l'avons
chahuté. Il m'en a toujours voulu un peu par la suite. Mais sa position
pouvait se comprendre. Puis, c'est devenu plus tragique. Certains de
mes copains sont morts, comme Jean
Cavaillès, mon camarade de promotion
(ENS). Mobilisé en 1939, il était entré dans les corps francs, lui qui
n'était pas sportif. C'était un fils d'officier comme Rocard (ce
dernier était le fils d'un saint-cyrien tué pendant la première guerre
mondiale), un autre type qui a eu une attitude remarquable pendant la
guerre. Mais Cavaillès est certainement le plus résistant de ceux que
j'ai connu, celui qui à pris le plus de risques, le plus pur et le plus
joyeux de le faire. Cavaillès comme Rocard, tous deux sont allés à
Londres. En 1940, Cavaillès avait quitté son enseignement. Il était
maître de conférence de philosophie à la Sorbonne et il s'est installé
dans la clandestinité dans le quartier de l'Observatoire. C'était un
intellectuel, mais qui s'est révélé un véritable aventurier. Il prenait
un plaisir fou à prendre des risques. Souvent je lui disais qu'il
jouait au con, on le voyait débarquer en plein hiver avec un chapeau
noir et des lunettes de soleil. Il faisait un petit signe
d'intelligence et il disparaissait aussitôt. Il a été arrêté deux fois
et chaque fois, il a réussi à s'échapper. Mais il a fini par être pris
et il a été fusillé en 1944.
Quand ils l'ont arrêté, j'étais tranquille, je savais qu'il ne
parlerait pas. Mais tous les collègues n'ont pas eu une attitude aussi
glorieuse. Il y a eu des types arrêtés, comme le mari de madame Mineur
(l'astrophysicien Henri Mineur) qui a fait le mouton. Il y en a eu
d'autres, comme ce type fortement décoré, grand manitou universitaire,
qui a lui aussi a trahi et qui aurait été tué si les autres l'avaient
appris. Moi, quand je me rendais compte que la situation devenait
délicate, j'abandonnais mon domicile, c'est tout. Le danger, si vous
étiez recherché, était instantané. Quinze jours plus tard, ils avaient
d'autres chats à fouetter. Et puis j'étais prévenu par la Préfecture de
Police. Quand un type était arrêté, je savais où il était exactement.
De plus j'étais seul, j'avais perdu ma femme avant la guerre et je
n'avais pas de risques à faire courir aux miens. On est venu me
chercher au début de l'occupation. Deux policiers français voulaient
s'informer de mes opinions, mais j'avais réussi à les mystifier.
Cependant, j'étais certainement resté dans leurs fichiers. Et puis, il
y avait eu quelques petites manifestations ou j'étais allé. On savait
que j'étais de sensibilité anti-allemande. Je me suis fait arrêter,
puis on m'a relâche. Une fois j'ai été obligé de rester deux mois dans
les Alpes, ce que j'ai pu faire grâce à mes laissez passer et quand je
suis revenu à Paris, j'ai décidé de ne plus habiter chez moi. Bref,
j'étais catalogué anti-pétainiste, de plus, j'étais l'ami de Cavaillès.
Mais j'ai eu une veine extraordinaire.
C'est alors que la Résistance a commencé à être tiraillée entre deux tendances. D'une part, De Gaulle avait envoyé ses émissaires, et l'on a créé le C.N.R. avec le Professeur de Louis le Grand, le type qui se piquait le nez... Georges Bidault. De l'autre il y avait les Communistes. Je me souviens de réunions au Laboratoire de géologie appliquée, chez Louis Barrabé et des discussions entre la gauche et la droite. J'entends encore Cavaillès me dire : "tout ça sent mauvais, on va voir apparaître une bande de zigotos..." La résistance a alors perdu la pureté de la lutte anti-nazie. Un jour, je m'aperçois qu'un monsieur qui n'avait rien foutu de la guerre, était devenu colonel. Un autre, auquel j'avais été obligé de foutre des coups de pied au cul, président des résistants intellectuels... Ils se sont disputés. d'un côté les gaullistes, de l'autre les communistes. Et puis, il y avait le problème des actes de résistance. Moi-même, je n'ai jamais eu une mentalité de terroriste. Tuer un Allemand dans le métro, je trouvais ça dégueulasse. Vous tuez un type en uniforme qui est peut être un brave type, mais vous savez que dix otages seront fusillés. A propos d'otages, à l'été 1940, j'avais travaillé à Toulouse dans un laboratoire de minéralogie dont le monteur de générateurs de rayons X était un jeune électricien, un jeune type très débrouillard d'origine polonaise, très anti-Allemand, s'appelait Choumov. Il revient à Paris, on se revoit, puis un beau jour il disparaît. après la guerre, j'ai appris qu'il avait été arrêté par les Allemands. Très fort en radio, il avait monté des postes et il transmettait des messages pour un groupe de résistants. Choumof, ça s'écrit C-H-O-U.…, mais les Allemands l'avait orthographié S-H-O-U. Un jour, un allemand est tué dans le métro et on décide de fusiller des otages. Les Allemands les ont pris par ordre alphabétique, mais comme ils avaient écrit son nom avec un S au lieu d'un C, il a échappé au peloton. En 1945, je l'ai revu et l'ai aidé à finir ses études et il a fini ingénieur dans une grosse boîte. Mais cette affaire d'otage l'avait terriblement marqué, le fait qu'un autre ait été fusillé à sa place à cause d'une simple faute d'orthographe.
Des 'Tables de constantes' au 'Bulletin signalétique'
En octobre 1940, nous avons eu une première réunion concernant
l'organisation de la révolte universitaire. Il y avait là aussi
Frédéric Joliot avec lequel j'ai noué le contact. C'est lui qui m'a
demandé, peu après, de venir l'aider aux 'Tables de constantes et
données numériques'. Les 'Tables' étaient un organisme créé par Charles
Marie au début du siècle destiné à l'origine à faire la documentation
de l'Union Internationale de Chimie, les autres disciplines ayant suivi
ensuite. A la fin des années 1930, ces Tables étaient moribondes. Il y
avait eu des difficultés d'argent au moment du Front Populaire et on
avait demandé à Joliot de les remettre à flot. Il avait obtenu l'appui
de l'industrie chimique, en particulier de Rhône-Poulenc. Ensuite il y
a eu une aide du CNRS qui y appointait quatre ou cinq personnes. Mais
le secrétaire général qui s'occupait de cela, Pierre Auger
est parti au début de l'occupation et Joliot m'a demandé de prendre la
suite.
Début 1941, j'ai accepté, bénévolement, en plus de mes autres
occupations. Il y avait donc quatre ou cinq employés qui ne savaient
quoi faire, du fait de la guerre, il n'y avait plus de coopération
internationale. On recevait toutes les revues de physique et de chimie
en double et des spécialistes en faisaient une extraction critique que
l'on publiait. Mais la France était maintenant coupée en deux et le
problème était de se procurer les revues. En accord avec Joliot, j'ai
donc organisé tout un réseau de collecte. Pour cela, j'ai pris contact
avec un certain nombre d'industriels, des gens qui avaient l'avantage
de pouvoir franchir facilement la ligne de démarcation. On a beaucoup
travaillé au début avec la firme 'LMT' (Le Matériel Téléphonique) et son
chef de service des brevets, Chéreau, qui est devenu un ami ainsi qu'un
ingénieur, Rigodet qui fournissait les revues. Mais c'était
insuffisant. Or, très rapidement et pour d'autre raisons que la
documentation, j'ai réussi à obtenir un laisser passer pour la zone
Sud. J'avais un ami astrophysicien, Daniel Chalonge, et, comme vous le
savez, les astronomes sont des types universels. Chalonge connaissait
un allemand important dans l'organisation scientifique qui s'occupait de la prévision météo. Cet allemand lui
avait dit : "si vous avez besoin d'un laissez-passer, j'ai mon bureau
chez les nazis au siège de la B.N.P., avenue de l'opéra. Voici un
papier que vous présenterez à mon secrétaire, il vous en donnera un".
Je demande donc à Chalonge si il peut me confier le fameux papier.
Bien sur, personne ne voulait aller dans ces bureaux, mais il a bien
fallu que je me décide. Il y avait deux soldats à la porte. Ils me
saluent, je remets le papier au secrétaire. Le type me regarde
bizarrement, un peu inquiet, et sans un mot, il me donne le
laissez-passer. Je n'avais qu'une crainte, c'est qu'en sortant, je
croise des français qui me prennent pour un collabo… Cet ausweis m'a
permis d'aller souvent à Lyon, pour prendre contact avec un service
scientifique de l'armée d'armistice. De même que l'industrie créait des
laboratoires de recherche pour l'après-guerre, l'armée avait commencé à
créer un centre de documentation. Il y avait là un type bizarre, un
ancien polytechnicien qui avait commandé le premier régiment
d'artillerie de France au mois de mai 1940. Il avait un adjoint, à
l'époque capitaine que j'ai revu quand il est devenu général. Tous deux
étaient très anti-allemands, mais pétainistes bien sûr. Ils m'ont
procuré beaucoup de documents. Et puis, je suis allé plusieurs fois à
Grenoble. Bref, c'est comme cela que l'on a organisé notre réseau de
collecte de revues
Pour faire paraître notre bulletin de documentation scientifique, il
fallait une autorisation administrative, ce qui dépendait du CNRS, donc
de Charles Jacob et de son adjoint, le chimiste Georges Dupont. Je
voyais Jacob chaque semaine, c'était un homme simple et un chic type.
Il avait accepté que nous continuions à payer les gens. Parmi ceux-ci,
quelques Israélites dont on a changé les identités pour des patronymes
moins dangereux. Jacob a fait l'aveugle, je m'occupais directement de
ces faux papiers avec mme Mineur, la secrétaire du CNRS. Nous étions
installés rue Pierre Curie, au siège des 'Tables de constantes'. Mais
il fallait aussi une autorisation des autorités occupantes. Or les
Allemands avaient donné tout pouvoir à un scientifique qui dirigeait
l'Institut Pasteur, le chimiste Ernest Fourneau. Celui-ci était très
germanophile et il présidait l'Association France-Allemagne. Au début,
il ne voulait pas me donner cette autorisation. Mais c'était un type
honnête, un bon scientifique, et il a fini par accepter : "maintenant,
débrouillez vous avec le ministère, je ne veux plus entendre parler de
vos histoires !" Du côté de l'Education nationale, si on était bien
avec les bureaux, on obtenait tout ce qu'on voulait. Surtout à l'époque
d'Abel Bonnard, une sorte de polichinelle, une vraie tapette dont ses
propres services au ministère se foutaient.
Le ministère
s'était déchargé de toutes les questions de documentation scientifique
sur Jean Gérard, le secrétaire général de La Maison de la Chimie. C'était un affairiste qui avait joué un très grand rôle dans sa
création. Il avait été président de
l'Association générale des étudiants. C'était ce genre de types qui
naviguent partout, qui ont du bagout. Il connaissait tous les grands
patrons de l'industrie française et il était devenu, le grand manitou
des revues scientifiques. Il avait créé une société, la 'Soprodoc'
qu'il avait installée à la Maison de la Chimie. Il étranglait les
vieilles revues de pharmacie pour les remplacer par d'autres plus
luxueuses grâce aux 'bons papiers' que lui valaient son entregent dans
l'industrie et avec l'occupant. Donc, de ce point de vue, le nouveau
'Bulletin signalétique' du CNRS était un concurrent. Ainsi pas moyen
d'obtenir notre autorisation. Il a écrit une lettre officielle à Jacob,
lequel a délégué le dossier à son adjoint, Dupont. Celui-ci nous a
convoqué, Jean Gérard et moi à la direction du CNRS et on a failli en
venir aux mains… Gérard n'était d'ailleurs pas le seul adversaire de
notre entreprise. L'association des naturalistes marchait à fond contre
le 'Bulletin', ils étaient tous pétainistes, comme toute la France
d'ailleurs. Quant au président de la Maison de la Chimie, Gabriel
Bertrand, il était terrifié par Gérard. La Fédération des scientifiques
n'a pas été très courageuse, comme cela arrive souvent. En particulier,
lorsque on lui a demandé, vers 1942, quelles revues devaient subsister,
l'illustre Jean Vergne, un médecin très connu a désavoué le bulletin du
CNRS. Je me suis donc débrouillé pour obtenir du papier par d'autres
voies. Comme j'allais souvent à Grenoble, j'ai rencontré Félix
Esclangon, professeur à la faculté de Grenoble et directeur de l'Ecole
de papeterie dans cette ville. C'est ainsi que j'ai pu avoir tous mes
'bons papiers'.
Il faut que je vous parle de quelqu'un qui a joué un très grand rôle
pendant la guerre pour le milieu scientifique. Il s'agit d'Enrique
Freyman, un homme de nationalité mexicaine, le patron des Editions
Hermann, sises rue de la Sorbonne. C'était un type merveilleux,
artiste, pas scientifique pour un sou, mais connaissant bien les gens.
Il avait épousé la fille d'Arthur Hermann, le fondateur des éditions
éponymes. Soutenu par Louis de Broglie qui lui fit connaître Langevin,
Einstein et d'autres, c'est lui qui avait créé la collection
'Actualités scientifiques et industrielles pour y publier des textes
refusés par les autres éditeurs. Bref,il s'était intéressé à notre
entreprise et c'est grâce à son aide que nous avons pu imprimer notre
Bulletin à Saint Amand Monrond pendant toute la durée de la guerre.
Mais aurions pu ne jamais exister. En fait, de toute l'occupation, le
Bulletin n'a jamais eu d'existence légale. En 1942-43, lorsqu'on a
demandé l'avis des scientifiques, nous n'étions même pas classés. Jacob
était très embêté. Je lui ai conseillé de ne pas tenir compte des
résultats de l'enquête. Notre Bulletin avait une existence toute
récente, il n'avait donc pas encore toute la notoriété souhaitable,
mais je savais qu'il commençait à pénétrer dans les laboratoires Et,
l'année suivante, fin 1943, nous étions en tête, avant même le
'Bulletin de la Société chimique de France' et le 'Journal de
Physique'. le 'B.S.' s'était imposé, nous étions en tête des journaux
scientifiques.
Pour la diffusion de notre documentation, on a organisé un
service de
microfilms grâce à l'aide de notre photographe, Bastardi. Il était tout
seul et il faisait des photos dans des conditions épouvantables.
Ensuite, il a eu un adjoint, puis deux, trois, mais pas de locaux. Je
m'étais emparé, avec l'appui de Georges Dupont, le directeur adjoint du
CNRS, de l'Institut d'orientation professionnel situé au coin de la rue
Thuillier et de la rue Gay-Lussac. L'INOP. qui avait été fermé pendant
la guerre, laissait des locaux disponibles. Là, nous avons disposé de
beaucoup plus de place et nous avons pu démarrer une bibliothèque. Nous
ne pilonnions plus nos périodiques (devenus ultra précieux), nous les
mettions dans un amphithéâtre en gradin, certes pas très commode pour
des rayons de bibliothèques, mais à la libération, notre bibliothèque
était pleine, ce qui veut dire que nous avions bien travaillé. Et tout
cela était pratiquement clandestin. Je me rappelle que le jour de la
libération de Paris, alors qu'il y avait des coups de fusil dans tous
les coins, des barricades, plus d'électricité, Bastardi développait et
faisait sécher ses films dans la cage d'escalier. On travaillait jour
et nuit. C'est comme cela que nous avons pu sortir les premiers
'Bulletins signalétiques' du CNRS. Pour nos activités clandestines,
j'avais toutes les clefs des caves de la Sorbonne. Nous y faisions des
microfilms. Mais une fois, un cas d'urgence, je me souviens qu'on en a
fait au centre de documentation rue Gay Lussac. C'était avant
l'arrestation de Cavaillès, en plein jour, une imprudence folle. Pour
les microfilms de la Résistance, je demandais en général à Salaignac,
mon employé très pétainiste, mais le seul type en qui j'avais
confiance, de rester le soir et on faisait ces microfilms. Cavaillès me
dit un jour : "il me faudrait ça très vite" et on a tiré nos trucs en
plein jour au Service de documentation. Ce travail consistait à fournir
des fiches à Louis Armand qui travaillait à la SNCF. Elles
répertoriaient les mouvements des trains militaires allemands.
La libération, épuration au CNRS
La
libération de Paris, ça s'est fait dans des conditions un peu
extraordinaires. Les communistes étaient particulièrement bien
organisés. L'Ecole de Physique et de Chimie était un centre F.F.I. On y
mobilisait des volontaires à la suite de l'appel de Rol-Tanguy, le chef
de l'insurrection parisienne. L'etat-major se trouvait au collège
Stanislas. J'allais en vélo de la rue Vauquelin à Stanislas, où j'avais
un lit. Je ne couchais plus chez moi, rue Lacépède. Il y avait des
forces allemandes au Sénat, ce qui m'obligeait à faire un détour.
Finalement, tout s'est bien passé pendant l'insurrection. Les Allemands
auraient pu faire sauter le Sénat, mais le général responsable du Gross
Paris, s'est finalement bien conduit. Il n'y a pas eu beaucoup de
morts, alors que ça aurait pu être catastrophique. Ca s'est un peu gâté
quand la division Leclerc est arrivée. Les Leclerc et les Américains
bivouaquaient au Jardin des Plantes, puis il y a eu une alerte. Les
Allemands étaient encore au Bourget. C'est la seule fois de toute la
guerre où j'ai obligé ma femme à descendre mon gosse dans la cave.
J'étais (re)marié à l'époque et j'avais un petit gosse de trois-quatre
mois. Il est tombé des bombes au métro de la rue de Navarre. Il y avait
une bouche d'entrée qui n'existe plus à l'angle de la rue de Navarre et
de la rue Monge. Là, il y a eu une vingtaine de tués. Les vitres de
tous les immeubles, sauf les miennes, ont été brisées.
Dupont et Jacob sont débarqués et Joliot, devenu
communiste, est nommé directeur du CNRS. Mais c'est alors qu'on a vu
les salauds sortir de leurs trous. J'avais une mitraillette qui n'a
jamais servi contre les Allemands, mais qui m'a permis d'empêcher
certains Français de faire des saloperies. En particulier, d'empêcher
des gens qui n'avaient pas bougé pendant la guerre de coller Jacob en
prison. Il a fallu que je m'interpose : "si quelqu'un touche à Jacob,
je lui flanque une rafale". Il s'agissait d'universitaires qui le
détestaient, phénomène si classique dans le milieu. Certes, il avait
été pétainiste. Qu'on le révoque, d'accord. Mais qu'on le foute en
taule, non ! C'était un homme honnête, il n'avait rien fait de mal. Je
voyais Joliot tous les jours à l'époque. C'est là que j'ai vu des
scènes incroyables, des types très connus, des manitous formidables,
venir se jeter à genoux dans son bureau, le suppliant : "ne me faites
pas arrêter !". On ne savait même pas quelles saletés ils avaient fait.
L'un d'eux, un professeur du lycée Saint-Louis, avait envoyé une lettre
de dénonciation de ses collègues à l'ambassadeur Abetz. Celui-ci avait
été si dégoûté qu'il avait renvoyé le torchon au proviseur, lequel
l'avait gardé tranquillement jusqu'à la Libération. Le type a été
révoqué et il est parti à l'étranger. Puis il est revenu en France et,
devenu gaulliste comme beaucoup d'anciens pétainiste, il a fini
professeur à la Sorbonne et membre de l'Institut. A la libération,
toutes les petites rancunes personnelles sont ressorties… Même dans mon
laboratoire, j'avais deux garçons de labo dont l'un était neutre, un
brave type, et l'autre se disait vaguement de sensibilité résistante,
en réalité il faisait surtout du marché noir. Mais, il voulait tuer le
premier qui était le plus brave des types. Malgré tout, dans ce milieu
où on est encore à peu près évolué. Il y a des choses qu'un
intellectuel ne fait pas, mais à Abbeville, chez mes parents, je revois
encore tous ces braillards qui se proclamaient résistants... Quant à
Jacob, il a repris sa chaire à la Sorbonne jusqu'à son décès en 1962.
A la Libération, Jean Gérard a été arrêté, pas par les Français, mais
par les Américains. En fait, ils ont trouvé dans les archives que les
Allemands avaient abandonné au Sénat que Jean Gérard était l'un de
leurs agents. En réalité, je crois que Gérard avait surtout fait son
beurre avec sa 'Soprodoc'. Bref, les Américains le mettent en cabane et
Joliot m'appelle me demande de m'occuper de la Maison de la Chimie.
J'en ai donc été nommé administrateur provisoire, tout en continuant à
faire mes cours et à m'occuper du centre de documentation. La maison de
la chimie avait un président, Gabriel Bertrand, un type magnifique,
mais complètement obnubilé par Jean Gérard. L'affaire devenait
empoisonnante. Surtout que les Américains ont bientôt viré leur cuti :
toute cette clique CNRS-Joliot, c'est bolcheviques et Cie. et qu'ils
ils ont passé la main à la Justice française. Gérard a mobilisé tout un
tas d'avocats, il avait le soutien de l'industrie chimique. Nous, on
était devenus des dangereux communistes. En fait il y a eu pas mal de
manœuvres de part et d'autre et j'ai fini par convoquer une assemblée
générale extraordinaire et j'ai fait nommer administrateurs Joliot et
des gens avec lesquels on avait le bon contact, Jolibois ou Alfred Landucci,
la patron de Kokak par exemple. Quant à Jean Gérard, il a fini par
laisser tomber le contentieux et il a été libéré. Je me souviens de
l'avoir rencontré deux ou trois ans plus tard dans une réunion à
Londres. On s'est trouvé nez à nez, on s'est regardé et on à éclaté de
rire. Ca s'est terminé comme ça. En réalité, la Maison de la Chimie,
c'est une façade, une belle demeure du XVIII ème siècle pour faire des
réceptions, mais ce n'est pas un endroit adéquat pour travailler. Le
CNRS pendant un certain temps, a simplement pris la bibliothèque et j'y
ai installé la documentation en sciences humaines.
Du CNRS au Commissariat à l'énergie atomique
Avec Joliot au CNRS, ça a magnifiquement marché. Quand il est parti au
CEA, je l'ai beaucoup regretté. Bien sur il y avait son engagement, le
Mouvement de la Paix, etc. A ce propos, je vous ai parlé d'Yves Rocard.
après la guerre, il a joué un très grand rôle au Commissariat, mais
surtout pour les aspects militaires, en particulier par la détection
des expériences nucléaires russes et américaines. Lui qui n'avait pas
fait de service militaire à cause de sa surdité, était devenu amiral
après la guerre. Il avait quitté la France pour l'Angleterre avec ses
travaux sur le magnétron. Il était devenu conseiller scientifique de la
Marine, et il avait toujours une voiture avec un matelot chauffeur
qu'il a gardé jusqu'à la retraite. Je me souviens que lorsque on a fait
exploser la première bombe atomique au Sahara, il avait fait un petit
trou dans le mur, du coté de l'explosion et il avait regardé le départ
du coup, puis le panache dans l'image projetée sur la cloison opposée.
Dés le lendemain, il avait appliqué des relations très simples comme la
loi de Mariotte, et il avait calculé la puissance de la bombe. A
l'issue de leurs calculs les techniciens militaires avaient trouvé un
chiffre très différent et Rocard de commenter : "Ils se sont foutus
dedans". Effectivement, c'est lui qui avait raison. Ce qui l'a coulé,
c'est le pendule. J'ai voulu le mettre en garde lorsqu'il a voulu
publier son livre sur la radiesthésie. Rocard pense qu'il y avait des
gens plus sensibles que d'autres au phénomène de résonance magnétique.
Dans le sang circule des petits doublets magnétiques, enfin certaines
molécules sont magnétiques. On a découvert que dans le cerveau du
pigeon voyageur, il y avait des petites particules qui semble leur
permettre de s'orienter grâce au magnétisme terrestre. Avec son marin
chauffeur, il faisait des manipulations. De fait, le type travaillait
très facilement de la baguette. Lorsqu'il a présenté sa candidature à
l'Académie, je lui ai dit : "si jamais tu sors ce bouquin chez Masson,
c'est foutu !". Il a tellement fait de choses en physique que son
élection aurait honoré l'Académie, je dirais même qu'elle se
déshonorait en ne l'élisant pas, il y a là une bande de types qui ne
lui arrivent pas à la cheville. Son livre n'est pas paru à ce moment
là, mais il s'est tout de même fait battre d'une voix ou deux. Il avait
critiqué certains membres de l'Institut. Il faut dire qu'il a un plume
extraordinaire. Il est capable de ridiculiser un bonhomme en deux
phrases. Bref, c'était un individualiste génial.
Au CNRS, Joliot a donc été remplacé par Georges Teissier, un de mes camarades de
l'ENS. Mais, nos tempéraments ne s'accordaient pas. C'est un type qui
voyait tout par le petit bout de la lorgnette, il n'avait pas l'ampleur
de vue d'un Joliot. Et puis, il était très influencé par tous les
biologistes qui étaient allés aux Etats-Unis pendant la guerre, Boris Ephrussi,
Louis Rapkine et qui ne juraient que par l'Amérique. Cette fameuse
biologie moléculaire commençait à naître et Teissier était très
influencé par tous ces biologistes qui avaient leurs propres réseaux
d'information. Bref, il n'a jamais été très favorable à la
documentation et j'ajoute que nos tempéraments ne collaient pas. Un
jour je me suis vraiment fâché : "tu n'es qu'un con. Je ne veux plus te
voir. Si tu as un peu de courage, fous moi donc à la porte !". Bien
entendu, il n'en a rien fait et c'est mon adjoint chargé des problèmes
administratifs, Gabriel Picard, qui a du jouer les intermédiaires.
Essor et servitudes de la documentation scientifique
Au lendemain de la guerre, la documentation scientifique a subie une
véritable explosion. En 1939, la bibliothèque la plus riche en
périodiques scientifiques pour la physique, celle du Laboratoire de
Charles Fabry, était composée d'une petite pièce avec une douzaine de
revues. Aujourd'hui, la physique sur le plan mondial, cela représente
1500 revues. Le travail est devenu différent. La science s'est
étroitement spécialisée. Pour développer le Centre de documentation du
CNRS, j'ai commencé par recruter un agent comptable. C'est comme cela
que j'ai débauché Gabriel Picard, un jeune type de moins de vingt ans
qui faisait la comptabilité de la faculté des sciences. Rapidement, il
m'a déchargé de la responsabilité de toute notre administration. Pour
la partie scientifique, j'ai eu de la chance de pouvoir recruter des
personnes compétentes, madame Millot, l'épouse d'un professeur du
Muséum, mesdames Duval et Berthelot qui est restée jusqu'à récemment au
Centre de doc. Des sciences et des techniques, madame Dussoulier qui
est partie à New York, etc. A la Libération, nous nous sommes installés
dans des locaux neufs de l'ENS à l'angle de la rue Amiot et de la rue
d'Ulm où nous sommes restés une dizaine années. Le Bulletin s'est
formidablement développé avec la fourniture de revues qui venaient du
monde entier, des revues anglaises, américaines et russes, ces
dernières que j'étais le seul à avoir grâce à Smirnov, le président de
l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. avec lequel Joliot m'avait mis en
relation. Notre centre de doc lui a d'ailleurs inspiré la réalisation
de 'ViniSty'. Moi j'avais un correspondant américain qui m'a aidé à
compléter nos collections des 'Chemical abstracts' dont nous avions été
privés pendant la guerre. Nous sommes ainsi devenus une sorte de modèle
sur le plan international. Au début des années 1950, nous pouvions dire
que nous avions toutes les revues du monde. Nous faisions des analyses,
même si le principe du 'Bulletin signalétique' était critiqué par certains théoriciens de
la documentation. Cet après-guerre a été notre période glorieuse. Quand
le Bulletin arrivait, les chercheurs se battaient pour l'avoir. C'est
l'époque où, pour répondre à la demande, nous faisions 3000
reproductions d'articles scientifiques par jour
Avec Gaston Dupouy, la doc. a marché de manière épatante. Pourquoi ?
Parce qu'il était physicien. A Toulouse, il s'occupait de microscopie
électronique. Pour lui, le 'Bulletin Signalétique' était la grande revue
dont il s'était toujours servi. On a donc reçu un appui sans réserve de
la direction du CNRS. Dupouy était tout petit par la taille,
mais il voyait les choses en grand. Il voulait que la documentation
fonctionne et nous n'avons jamais eu autant de moyens qu'avec lui. Mais
il nous a quand même joué un drôle de tour. C'est lui qui s'est occupé
de construire les nouveaux bâtiments du quai Anatole France où l'on
avait prévu de loger le centre de documentation, un service qui avait
un grand prestige aux yeux du gouvernement. On a donc construit pour
elle et en particulier, pour la bibliothèque - c'est moi qui en ait
fait les plans - ce nouveau bâtiment situé sur des terrains extrêmement
meubles du quai Anatole France. Mais à peine le chantier achevé, Dupouy
a commencé à prendre les plus beaux bureaux pour l'administration, et
finalement... on n'a eu que les résidus. J'ai râlé quand il a voulu
faire ce hall gigantesque qui prenait beaucoup de place. Finalement, on
a tout de même récupéré les sous-sols pour mettre nos deux étages de
bibliothèque.
Les mathématiciens quant à eux ne s'intéressaient pas à notre entreprise
pour une raison très simple, c'est un petit milieu et où ils se
connaissent tous entre eux. C'est la même chose chez les astronomes.
Ces sciences très particulières forment des associations. Il y a des
réunions très fréquentes. Ils communiquent directement entre eux. Mes
ami mathématiciens du groupe Bourbaki me disaient qu'ils se foutaient
de mon bulletin. Il en allait de même dans cette biologie moléculaire
que l'on ignorait en France et qui venait d'Amérique et qui comptait
beaucoup d'israélites émigrés. Conscients d'être des seigneurs, les
gens comme Boris Ephrussi nous considéraient comme des loqueteux
ignorants. En physique, nous nous sommes surtout occupés de structures
atomiques déterminées au moyen des rayons X. On a créé, juste après la
guerre, l'Union Internationale de cristallographie dont j'ai été élu
président en 1960 et puis 'Acta Cristallographica'. Dans ce domaine,
j'ai vu les Américains défendre nos bibliographies alors qu'elles
étaient critiquées par nos chercheurs. Certains chercheurs de mon labo
voulaient que nous nous abonnions à la revue de l''American
cristallographic association' qui publiait deux ou trois bibliographies
par an. Je me suis finalement laissé faire. Peu de temps après, John
Crane, le rédacteur en chef de la revue américaine m'écrit : "nous
voulions faire un bulletin bibliographique, mais nous nous sommes
aperçus que le votre est beaucoup mieux. Est-ce que vous ne pourriez
pas nous fournir la partie cristallographique du Bulletin CNRS ?".
C'est ce que nous avons fait pendant plusieurs années et mes chercheurs
recevaient cette partie du 'Bulletin' via l'Amérique avec plusieurs
semaines de retard ! Les plus intéressés étaient les chimistes.
C'est ainsi que les 'Tables de constantes' ont continué à vivre, mais elles ont cessées d'être internationales. J'avais demandé à madame Allard, leur responsable, de s'occuper des stéroïdes. La mesure du pouvoir rotatoire de ces molécules permet de caractériser un stéroïde, or, celles-ci jouent un grand rôle en chimie biologique. Mais, tous les ans il naissait deux cent nouveaux stéroïdes et nous avons fini par être dépassés. Et puis il y avait les sciences humaines et sociales. Au lendemain de la guerre, on a vu apparaître au Conseil d'administration du CNRS quelques littéraires, des historiens, des philosophes. Par ailleurs, des professeurs d'universités, rêvaient d'avoir leur documentation comme la notre. En particulier François Bérard, le fils du Ministre et qui était professeur de philosophie à Nancy. Comment faire un bulletin signalétique exhaustif en philosophie ? On en a discuté et finalement, on s'est limité à certains périodiques qu'on analysait entièrement sans trier.
Les centres de doc
Puis la V° République qui nous a flanqué des administrateurs
partout. La direction générale du CNRS a été émasculée. On nommait à
coté du directeur général un directeur administratif et financier
(DAF), le premier étant relégué au rôle de simple soliveau. C'est comme
cela que Claude Lasry est devenu le véritable patron, toujours en train
de sucer des bonbons et de jouer à l'important. Puis il a été remplacé
par Pierre Creyssel qui ne s'est pas du tout entendu avec son directeur général, Robert Chabbal.
Quand ils se rencontraient, ils se tournaient le dos. Quand l'un disait
oui, l'autre disait non. Ca me rappelait les débuts du CEA quand De
Gaulle avait collé Raoul Dautry à côté de Joliot comme représentant du
gouvernement… Pour les sciences humaines, quand j'ai vu toutes les
difficultés que j'avais avec des zigotos genre Lasry et autres, ça a
fini par me dégoûter de la documentation. Et puis, il y avait 'lCSU
Abstracting Board', créé à l'origine pour fédérer les centres de
documentation du monde dont nous n'avions pas besoin d'eux, parce qu'il
y avait longtemps que nous avions établi des relations directes, mais
des gens de chez nous ont voulu se donner de l'importance vis-à-vis de
ces organismes. Bref, le bazar est devenu trop lourd, j'étais arrivé à
plus de 400 personnes vers 1965. Trois mille articles par jour de
reproductions de microfilms. Ca tournait, mais on nous a envoyé aux
Buttes Chaumont (Centre de documentation des sciences et des
techniques). après ils ont nommé des directeurs adjoints - il y a eu
projet de décentralisation à Lyon, mais les sciences humaines sont
allées au Cherche Midi (Centre de documentation sciences humaines) car monsieur Lasry était très bien avec Madame Cadoux qui
travaillait chez nous au début. Quand on a du aller aux Buttes Chaumont, les
sciences humaines ont demandé leur indépendance, elles devenaient trop
importantes pour que nous les conservions dans l'étage que nous louions
à la Maison de la Chimie.
Moi, je ne m'intéressais qu'aux laboratoires de recherche. Je savais
bien que la documentation était nécessaire, mais je n'en faisais pas
par plaisir. Ça m'éloignait de mon équipe. Ma vie, c'était le labo.
Lorsque la documentation était logée rue Pierre Curie, c'était très
commode puisque j'habite dans cette même rue, mais il m'arrivait de ne
pas y aller de la journée, tandis que je n'ai jamais manqué un jour
dans mon laboratoire. Mais les gens comme Lasry ont décidé que la doc
devait être rentable et les industriels qui sont devenus les plus gros
clients du CDST. Le résultat a été que les chercheurs ont cessé de
s'abonner au Bulletin. Lorsque sa gestion est devenue soi-disant
commerciale, sa diffusion est tombée en chute libre, le prix de
l'abonnement est devenu tel que les gens préféraient s'abonner
directement aux revues. Et puis les prix d'extraction (de nos douze
mille périodiques) et de publications du Bulletin ont flambé. L'an
dernier (1985), j'ai été obligé d'intervenir auprès d'Hubert Curien pour que
le centre de doc reçoive une subvention qui lui permette de payer
certains abonnements. C'est du rafistolage. Il fallait supprimer le
'Bulletin signalétique' pour ne plus faire que de la bibliographie.
D'autant que la science, aussi, a changé de caractère. Par exemple,
dans mon domaine, il suffisait d'une ou deux revues pour être au
courant de tout. Aujourd'hui, nous sommes plutôt devenus des
utilisateurs de technique. Cristallographe, ça n'a plus de sens, c'est
comme si vous disiez physicien. Le type qui fait de l'optique n'a rien
à voir avec un atomiste. On a créé les 'Acta Cristallographica' à
Londres en 1947. Au début, il y avait six fascicules par an. Désormais,
on ne les compte plus… La cristallographie s'est scindée en
cristallographie générale, cristallographie appliquée à la technique,
physique du solide, etc. De plus, la documentation n'a plus la même
importance qu'a l'époque où on n'avait rien. Aujourd'hui tout est
disponible. Les laboratoires n'ont jamais étés aussi riches. C'est la
pénurie due à la guerre qui avait expliqué l'essor de la documentation.
Aujourd'hui, les chercheurs reçoivent sur place la documentation
indispensable, tous les jours et très facilement. Vous travaillez sur
un sujet donné, vous savez qu'il y a trois ou quatre laboratoires dans
le monde qui sont sur le même sujet. Donc vous surveillez ce qu'ils
font, puisque vous avez des contacts avec eux.
L'utilité d'un gros Centre de documentation c'est de pouvoir traiter
toute la science. Dans toute revue scientifique, vous avez un article
qui peut intéresser des cristallographes ou des chimistes. Par exemple
en chimie organique, on ne détermine plus des molécules par
distillation, mais par des moyens physiques. Voyez mon laboratoire, la
minéralogie se base sur la cristallographie, mais une espèce minérale
se définit par des propriétés physico-chimiques. L'étude de la
structure atomique au moyen des rayons X, ça intéresse d'abord des
minéralogistes et des cristallographes. Mais désormais, vous ne pouvez
plus faire de chimie organique - même la plus compliquée comme celle
des protéines - sans diffraction aux rayons X et j'ai maintenant trois
ou quatre médecins d'origine chez moi qui font des structures atomique
de protéines. La microscopie électronique, ça intéresse toutes les
branches de la science. Il est évident que si un article de microscopie
électronique parait dans une revue de chimie, il peut aussi bien
intéresser un physicien nucléaire, d'où l'utilité d'un centre de
documentation qui pourra alerter les chercheurs susceptibles d'être
intéressés par la microscopie électronique. Les gens reçoivent une
revue spécialisée, mais ils ne peuvent pas recevoir des milliers de
publications.
L'informatisation
Dans les années 1970, on a vu arriver dans la documentation une bande
de parasites qui ont prétendu faire carrière en développant des
systèmes d'analyse automatique. C'était grotesque, imaginer confier
l'extraction de mille périodiques à une machine, sans penser qu'il faut
d'abord introduire les données dans la machine. Mais il y a un type qui
a dépensé un milliard la dessus. Bien entendu, pour le calcul
scientifique, l'informatique est devenue une obligation. En
cristallographie, il n'est plus possible de travailler sans ordinateur.
Il y a des calculs itératifs et additionner trente mille cosinus à la
main, ce que j'ai du faire pendant un certain temps, c'est
insupportable. A propos d'informatique, il y a eu aussi quelques belles
bagarres politiques. Un copain de promotion, René De Possel, un très
grand mathématicien s'intéresait aux ordinateurs IBM. Mais chez Bull,
un certain Louis Couffignal essayait de mettre au point une machine
concurrente. L'affaire est bien entendu remontée à la direction du
ministère de l'Industrie et Charles Perès, le mathématicien qui avait été
sous-directeur du CNRS au temps de Teissier, m'a demandé d'arranger
l'affaire : "Comment ça, vous ne voulez pas importer IBM parce que nous
ne voulez pas contrer Bull ? Mais vous allez nous entendre hurler !" .
Les gens du ministère ont eu la trouille et ils ont laissé entrer notre
machine. Et puis quand il y en a eu une, il y en a eu d'autres et c'est
comme cela que De Possel a installé l'informatique du CNRS. De Possel
était un excellent mathématicien et c'est grâce à ses ordinateurs que
l'on a établi ce qui est devenu la base informatisée 'Pascal', un
excellent système de documentation automatisée pour les sciences
exactes. Il a également travaillé sur les questions de lecture
automatique, il avait installé rue du Maroc, une machine à lire
remarquable qui a servi par la suite à faire des machines à lire les
billets de banque.