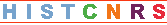En cas d'usage de ces textes en vue de citations,
merci de bien vouloir mentionner leur source (site histcnrs), ses auteurs et leurs dates de réalisation
Entretien avec Michel Lejeune
P.-E. Mounier-Kuhn, E. Pradoura, le 11 juin 1986 (source : https://www.histcnrs.fr/temoignages.html)

DR
Avez vous gardé des souvenirs du CNRS des débuts ?
Je
ne sais absolument rien sur la période qui m'a précédé, i.e. avant
1955. J'étais membre d'une commission, mais j'y allais deux fois par
an, j'y passais trois demi journées, je n'avais pas de rapports avec
l'administration, on apercevait Dupouy un quart d'heure et puis c'est
tout. J'étais très extérieur à tout ça. Je ne sais rien donc sur avant
cette date, sauf par les conversations avec les uns et les autres qui
me disaient "ah! si tu avais connu Aimé Cotton, ah! si tu avais connu
Untel", pour moi c'est une espèce de légende, d'avant mon temps.
Finalement, dans la mesure où j'ai pu avoir des informations sur la
suite, étant resté au Comité national, je gravitais tout autour
et j'avais des nouvelles par tous les gens que j'avais connus de mon
temps, mon impression est que les choses se compliquaient,
s'alourdissaient, se sclérosaient et qu'elles étaient moins agréables à
manier qu'avant. Autrement dit que le CNRS a dépassé
probablement une certaine masse critique. Pour tous les organismes, il
y a de bonnes dimensions. J'ai l'impression que j'ai connu le CNRS à un
moment où il était maniable et qu'il a tendu à l'être de moins en
moins. C'est ce qui explique en particulier cette multiplication
d'administration, à partir d'un certain moment les choses tendent à
vous échapper. Je connaissais mon royaume, quand j'étais roi, là. J'ai
l'impression qu'il y a eu un moment où je ne connaissais plus mon
royaume. On a eu beau multiplier les rois, chacun d'entre eux
connaissait mal son royaume. Je garde un souvenir extrêmement agréable,
pas seulement comme réaction personnelle, mais avec le sentiment qu'il
y a derrière une certaine réalité : Le CNRS était sorti de l'état plus
ou moins artisanal par lequel, par nécessité, il avait commencé. Il
avait des structures, mais des structures qui n'étaient pas encore
devenues des structures lourdes. J'ai l'impression que j'ai connu le
CNRS à un bon moment. Bon moment pour l'exercice de la direction et je
dis même aussi pour le plaisir de la direction. Ca va ensemble. J'ai
l'impression que je l'ai connu à un moment, à cet égard,
favorable et que pour rien au monde, je ne voudrais avoir, même si
j'avais l'âge voulu, à recommencer dans les conditions actuelles qui me
paraissent être finalement dégradées. Même si le CNRS a multiplié son
activité de façon extraordinaire, et s'il y a un bilan positif de tout
ça que je ne nie absolument pas. Le moment où j'y ai été correspond, à
mon jugement, à ce qui a été la meilleure époque.
Ce qui me porte à croire que ce n'est pas une espèce d'utopie retrospective, c'est que quand je parle à des gens comme Jean Coulomb (un ancien directeur du CNRS), je pense qu'il est également de cet avis. Je suis témoin d'une certaine époque, d'une certaine façon d'être qui n'était pas du tout inefficace, mais qui permettait, justement à cause des dimensions demeurées raisonnables, un contact direct avec les choses et avec les gens. Au dessus d'une certaine dimension, ce n'est plus possible. J'avais l'impression d'avoir bien en mains tous mes gens, j'entends tous les gens des commissions, de l'ensemble de mes commissions, c'est-à-dire de m'entendre avec eux, de bien parler la même langue, de pouvoir voir avec eux les problèmes et les résoudre, de pouvoir intervenir dans les commissions, bien qu'avec certains nous n'étions pas de la même discipline. Je n'étais pas interventionniste dans les commissions, j'étais un témoin qui suivait les commissions de bout en bout. Il y avait un des chefs de service, madame Niéva ou madame Carle, qui suivait les commissions chacune pour son secteur, les bourses, les publications, et moi qui étais là pratiquement à côté du président de la Commission de bout en bout. J'étais peu intervenant, mais j'ai l'impression que ma présence était en général considérée comme une marque d'intérêt porté par l'Administration à leurs problèmes, même mineurs. Les gens sont curieux, ils croient que quelqu'un de l'administration c'est un être d'une autre espèce qu'eux! Je laissais intervenir les chefs de service pour les questions techniques et j'intervenais quand quelque chose allait de travers. J'étais vraiment en symbiose avec mes commissions. J'étais là tout le temps, je connaissais tous les gens, on était dans des relations de bonne collégialité pour le moins, de confiance ou d'amitié dans les autres cas. C'est aussi une question d'atmosphère. Ils n'avaient pas le sentiment que l'administration est une chose différente, d'une autre nature qu'eux-mêmes. Je leur expliquais que si untel ou untel était à ma place, il serait bien obligé de faire ce que je faisais. Au niveau de la direction, je vous l'ai dit, c'était les portes ouvertes, on allait chez l'un chez l'autre. C'était aussi peu formaliste que possible et en même temps je crois d'une bonne efficacité. Quand j'ai décidé de partir, c'est parce que plus de huit ans et demi c'est un morceau de vie important. J'étais en plus directeur d'une maison de cinq cents étudiants à la Cité Universitaire, je produisais également beaucoup, livres ou articles. J'ai eu là une période de ma vie très surmenée. Je trouvais qu'il était raisonnable de me décharger progressivement et en particulier de ce qui pesait le plus lourd, le CNRS. Par ailleurs je pensais qu'il n'était pas bon qu'un organisme soit dirigé trop longtemps par quelqu'un qui a certaines vues, alors que le voisin pourrait avoir d'autres vues également bonnes mais différentes.
Pourriez vous évoquer le début de votre carrière ?
J'avais enseigné pendant une dizaine d'années en province à
Poitiers et ensuite à Bordeaux. Je suis arrivé en 1946 à la
Sorbonne, dans un enseignement qui s'appelait linguistique, et où
pratiquement je faisais de la grammaire comparée. Je succédais à
la Faculté des Lettres et à l'Ecole des Hautes Etudes (4ème
section), à Vendryès qui partait à la retraite. Telle était ma
situation universitaire jusqu'en 1955, moment où (je prend mes
fonctions de Directeur Général Adjoint). Mon contact avec le CNRS était
antérieur car j'appartenais déjà au Comité National dans la Commission
qui s'occupait d'antiquités classiques. J'avais donc vu comment le CNRS
fonctionnait au niveau du Comité national dans un domaine particulier,
celui de ma Commission. Un beau jour, Gaston Dupouy, le directeur du
CNRS, m'a demandé si je voulais devenir directeur adjoint. En fait je
ne le connaissais pratiquement pas. Nous nous étions rencontrés au
printemps 1946, il était doyen des sciences à Toulouse, j'étais doyen
des lettres à Bordeaux, et il y avait eu une réunion générale
officieuse des doyens à Toulouse à son instigation. Ces deux facultés
étaient plus ou moins en conflit avec le Ministère pour des histoires
de baccalauréat et Dupouy était d'avis que les doyens accordent
leurs violons. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois.
Quand j'étais au Comité National, il venait jeter un petit coup d'oeil
aux commissions de sciences humaines à l'époque où Jamati, que je n'ai
pas connu, était décédé. Il y eut un long interrègne et Dupouy,
ne sachant pas comment résoudre cette question sur le plan personnel,
l'a laissé dormir. Ces compartiments du CNRS étaient plus ou moins
menés par une secrétaire, Madame Meierovitch, qui faisait partie des
cadres administratifs du CNRS. Elle avait travaillé avec Jamati, on lui
avait dit : "vous connaissez un peu les questions, débrouillez vous!"
Elle n'avait d'autorité ni personnelle ni scientifique, elle assurait
simplement la gestion des affaires courantes. A l'époque, je savais
bien qu'il n'y avait pas de directeur en sciences humaines, mais je ne
savais même pas qu'il devait y en avoir un. Je savais seulement que
nous marchions comme ça, avec la Commission, un président de séance,
Mme Lucienne Plin. Et de temps en temps le directeur général qui venait
gentiment dire bonjour, écoutait les choses pendant un quart d'heure,
prenait l'air de la commission et repartait.
Quand donc un jour, il m'a demandé si je voulais prendre la direction des sciences humaines, je fus interloqué par cette proposition que rien ne m'avait laissé prévoir. Plus tard j'ai demandé à Dupouy la raison de cette démarche. Il a évoqué le souvenir de cette rencontre des doyens à Toulouse, le fait que j'étais à l'époque le plus jeune doyen d'une faculté de lettres et une conversation qu'il avait eue avec le recteur Sarrailh à qui il avait demandé conseil et qui lui avait dit de me prendre. J'ai demandé à réflechir, je ne pouvais pas lui répondre comme ça, je ne savais même pas en quoi ça consistait, si c'était compatible avec d'autres activités ou pas... Dupouy m'a expliqué tout cela et (il a ajoutté) que je verrais bien à l'usage ! Il m'a envoyé voir Champetier, l'autre directeur adjoint qui m'a décrit également les choses et l'atmosphère qui régnait au CNRS.
Comment cela ?
Il m'a encouragé en me disant que de toute façon je n'y
resterai pas toute la vie. D'autre part, J'ai demandé conseil à
Vendryès qui avait toujours été mon patron et qui attachait énormément
d'importance au rôle du CNRS. Il y croyait. Je lui ai dit que
j'hésitais parce que j'allais être obligé de laisser tomber des choses
auxquelles je tenais et que je ne savais pas du tout si je ferais
affaire ou si (ce rôle) ferait mon affaire! Il m'a dit d'accepter.
C'était parfait pour le CNRS que des gens comme moi en fasse
partie. Finalement, j'ai accepté et je suis entré en fonction à Pâques
1955. Je suis resté jusqu'au premier octobre 1963, c'est à dire pendant
huit ans et demi. Je me suis fait détaché de la faculté. En réalité
j'ai fait les deux pendant les trois mois qui restaient de l'année
scolaire pour ne laisser tomber ni les cours, ni les étudiants, ni les
examens, puis j'ai eu un suppléant à la rentrée d'octobre. J'étais donc
en position de détachement au CNRS tout en continuant à assurer mon
enseignement de recherche aux Hautes Etudes que je ne voulais pas
abandonner. Ma fonction principale est devenue le CNRS, au lieu de la
Sorbonne.
Je suis donc resté huit ans et demi directeur. Je dois le dire, avec beaucoup de satisfaction et d'intérêt pour cette activité. Cependant, au bout d'un certain temps, j'ai eu l'impression, non pas d'une lassitude ni de difficultés, mais que ça n'était pas très bon pour un organisme de recevoir toujours l'impulsion de la même personne. Il était important qu'il y ait une certaine rotation de personnes pour que d'autres tempéraments, des points de vues nouveaux puissent se faire jour. J'avais comme tout le monde, une vue partielle des choses et il fallait que dans le domaine des sciences humaines, quelqu'un appartenant à une autre discipline que la mienne, prenne les choses en main. Entretemps Dupouy était parti et avait été remplacé par Coulomb avec qui j'ai passé le plus d'années au CNRS. A un certain moment, Champetier a lâché aussi et a été remplacé par Drach. J'ai dit un jour à Coulomb que j'étais en poste depuis un grand moment et que je pensais que ce serait une bonne chose, sans qu'il y ait urgence, que quelqu'un d'autre prenne ma place.
Vous souhaitiez retourner à l'enseignement ?
J'avais gardé la partie la plus intéressante qui était les Hautes
Etudes, mais je désirais avoir un peu plus de loisir pour mon travail
quoique je n'aie jamais arrêté d'écrire des articles ou des livres.
Mais pendant ces années, j'étais vraiment surmené. Je désirais
retrouver un peu de souffle. Coulomb m'a dit : "ça ne va pas. Moi
aussi, j'ai envie de m'en aller. Tu étais sans doute dans la maison
avant moi, mais comme je suis ton ainé tu me dois le respect ! Et comme
il n'est pas bon que deux directeurs sur trois, s'en aillent d'un coup,
je part le premier et tu partiras un an après moi." C'est comme ça que
ça s'est fait . Ensuite, je suis resté un an avec Jacquinot qui
avait été prévenu que je n'étais là en principe que pour un
an. Au bout d'un an j'ai donc dit que comme convenu
je désirais partir, Jacquinot m'a dit d'accord, mais à condition que
je trouve quelqu'un pour me remplacer. J'ai contacté différentes
personnes dans des domaines autres que le mien : Raymond Aron,
Lévi-Strauss, Raymond Barre, des gens que j'avais vus à l'oeuvre dans
des commissions. Tous les trois m'ont remercié vivement, mais pour des
raisons personnelles ont décliné mon offre. Finalement, je me suis
adressé à un géographe, Monbeig, qui a accepté. Par la suite, mais
c'est une autre histoire, les sciences humaines au CNRS ont été
scindées en deux. Ce qui fait que ma descendance, si j'ose dire, est
bifide à partir d'un certain endroit. D'autre part, j'ai hésité à
retourner à la Sorbonne pour ne pas renvoyer dans les ténèbres mon
suppléant qui était un de mes élèves, Perrot. Jacquinot m'a alors
proposé de devenir directeur de Recherches. J'étais détaché de la
Sorbonne et j'ai changé de cadre en 1963, ce qui a duré jusqu'à l'âge
de la retraite. Je me suis gardé à partir de ce moment là d'interférer
dans les problèmes du CNRS avec mes successeurs, ce qu'à mon avis, on
ne doit jamais faire une fois parti. Naturellement si jamais on avait
besoin de moi pour quelquechose , présidence de commission électorale,
par exemple ou pour des corvées tout à fait occasionnelles, je ne
demandais pas mieux. Ceci me donne l'occasion de dire que j'estime
capital que la direction du CNRS soit assurée par des professeurs, par
des universitaires, et non par des administratifs. Il faut des gens de
la profession. Naturellement il faut aussi des administratifs, et même
des bons administratifs, mais simplement pour les seconder. Ca pose
d'abord un problème de personne. Il y a de très bons chercheurs ou de
très bons enseignants - chercheurs et enseignants pour moi c'est le
même métier - mais qui n'ont aucune espèce de compétence
administrative, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui
laissent agir les bureaux au lieu d'avoir prise sur eux, enfin
qui ne sont pas adroits dans les négociations avec les autres
administrations. Il y a au contraire des scientifiques qui se
débrouillent tout à fait bien dans ces domaines. C'est une affaire de
tempérament. De même qu'il y a de gens très savants qui savent ou non
enseigner, de même il y a des gens qui savent administrer et d'autres
qui ne le savent pas. Je ne pense pas que ça s'apprenne, c'est plus une
affaire de don. Naturellement, il y a des choses à apprendre, mais
quand le don existe, on les apprend vite. Je crois que j'étais idoine
pour ces choses là et ça m'a intéressé. Je dirais même, encore que le
mot va vous scandaliser, que ça m'a amusé. Ca me donnait des contacts
beaucoup plus variés, avec des "collègues" et des possibilités
d'action. Après tout, ce n'est pas déplaisant d'exercer une action ! Il
faut naturellement s'interroger sur la nature, la portée de cette
action, mais il y a aussi le sentiment d'avoir réellement prise
sur des gens et par exemple de les faire changer d'avis.
Je vous raconte une anecdote à ce propos. A un certain moment, il était dans le vent de faire des retouches au sectionnement du Comité national. J'en avais moi-même l'expérience. Si certaines commissions fonctionnaient mal, c'était naturellement en partie la faute des personnes, mais c'était aussi parce que le domaine de leurs compétances était mal équilibré. Aucune Commission n'a jamais une matière homogène à manier. Il peut en résulter des tiraillements, des rivalités. "Ah! vous avez pris un type pour ceci, alors moi maintenant, je vais en prendre un pour cela". Ce genre de chose n'était même pas sous entendue. Il y avait des commissions peu chargées en nombre de dossiers, et il y en avaient de surchargées. J'ai décidé un nouveau sectionnement. Par exemple, dans l'ancien Comité national, il y avait une commission d'antiquité classique et il y avait une commission d'histoire. Celle d'histoire avait une charge monstrueuse. J'ai donc fait trois commissions au lieu de deux. Les questions d'archéologie, même d'archéologie nationale, étaient du ressort de la commission des antiquités classiques, c'étaient des anciens membres de l'Ecole d'Athènes ou de Rome qui recevaient la direction des circonscriptions archéologiques françaises. Ils se mettaient à l'archéologie nationale, mais en même temps dans leurs universités, ils enseignaient l'histoire latine, grecque, l'histoire de l'art ancien. Petit à petit, à partir de cette (première) réorganisation, j'ai créé une commission d'antiquité nationale et du moyen âge. Le moyen-âge, bien qu'européen, était couvert essentiellemnent par des médiévistes français qui faisaient suite, historiquement, aux antiquités nationales. C'est-à-dire que je soustrayais le moyen-âge, d'une commission débordée qui faisait auparavent commencer son domaine à la Renaissance. Quand cela s'est su, j'ai reçu visite de deux historiens classiques, Piganiol et Demargne (qui est toujours mon confrère), pâles de rage, et disant : " c'est affreux, on ne nous a pas demandé notre avis". Je leur ai répondu : "Je suis directeur, le Comité national a un rôle consultatif, c'est entendu, mais il y a des décisions qu'il faut prendre. Si on consulte les gens on ne fera jamais rien, donc je décide que c'est comme ça." Ils étaient furieux de n'avoir pas été consultés, ce que je comprends. Je leur ai expliqué que (cette modification) donnait finalement beaucoup plus de place aux antiquisants, puisqu'ils continuaient à meubler une Commission toute entière tout en meublant occupant la moitié d'une autre. Il y aurait maintenant deux portes au lieu d'une, pour entrer au Comité national. D'autre part, s'il était important de donner une place plus grande aux antiquités nationales, il s'agissait d'une chose dont je m'étais déja occupé du temps du ministère Malraux. C'est la première fois que le mot antiquités nationales apparaissait dans les intitulés du Comité national, ça n'existait pas avant, elles étaient un sous produit des antiquités classiques. Mes interlocuteurs étaient des gens qui n'avaient pas le caractère facile, mais ils sont repartis contents. Des épisodes comme celui-la, il y en avait tout le temps.
Vous avez d'autres exemples ?
A un moment donné, j'ai eu des débats avec la commission de
philosophie, parce qu'une année, des renouvellements n'ont pas eu lieu.
Un tas de gens sont partis parce qu'ils étaient en bout de course ou
parce qu'ils avaient demandé à partir, d'autres n'ont pas été
renouvelés parce que depuis des années les rapports d'activité étaient
scandaleux. On ne pouvait pas renouveler indéfiniment des gens qui
disent qu'ils continuent à s'occuper de leur thèse et dont on ne sait
rien. Un directeur d'études disait "untel m'a assuré qu'il continuait",
ça allait bien un an, deux ans, mais ce n'était plus possible après. Ca
prouvait que les collègues directeurs de thèse n'étaient pas sérieux.
Je me suis trouvé en face de cas comme ça, une année où il y avait de
plus beaucoup de départs naturels. Bien sur, on a dit qu'on était en
train de décapiter la philosophie! Réaction absurde, mais prévue. J'ai
fait un long rapport pour le directeur Général qui me demandait ce que
je faisais avec mes philosophes. On l'a distribué au Directoire,
qui est tout de même au dessus du Comité national. Le Directoire s'est
saisi de la question et il a trouvé mon rapport
parfaitement normal. Il y a des commissions faciles à manier, d'autres
qui, pour des raisons de comportement, de caractére, étaient plus
difficiles. Certaines, je ne donne pas de noms bien sûr, m'ont
quelquefois exaspéré. On votait, il y avait des votes secrets, pour
désigner le premier candidat à prendre. Une fois le vote dépouillé,
proclamé quelqu'un a dit que ce n'était pas possible, qu'on
allait recommencer! Là, je me suis mis en travers, j'ai dit que je
n'avais pas de préférence pour x ou pour y, mais qu'on n'annule
pas un vote parce que le résultat ne plait pas à X ou à y. Ils
pouvaient annuler s'ils le voulaient, mais la direction du CNRS
ne tiendrait compte que du premier vote. On ne peut pas travailler dans
ces conditions. J'ai donc eu des difficultés. Ce travail en commission
n'était pas toujours tranquille.
Revenons sur l'activité de la direction....
Au niveau de la direction, ça a toujours été un travail
admirable. J'ai commencé en 1955 dans les anciens bâtiments. Les
nouveaux, la grande idée de Dupouy, étaient encore en construction.
Après, on s'est transporté au dernier étage des nouveaux bâtiments. Il
y avait le bureau du directeur général et de chaque côté les deux
directeurs adjoints , le scientifique à un bout et moi à l'autre. Le
tout communiquait sans passer par le couloir. Derrière moi, j'avais le
bureau de secrétariat où il y avait Melle Peyrouté. Quand on avait un
problème, on poussait la porte. Nous nous tutoyions. On était vraiment
des camarades.
Quelle idée Dupouy se faisait il des sciences humaines ?
A vrai dire, il n'en faisait pas. Il n'avait aucune position
précise, sauf qu'il avait l'impression de quelque chose de très
importante à laquelle il déplorait personnellement de ne rien
comprendre. Mais au lieu de la traiter avec négligence, il y attachait
au contraire,beaucoup de prix, justement parce que ça lui était très
étranger. Les aspects les plus techniques de ces disciplines lui
échappaient, il aimait la littérature par exemple, la poésie, et il
avait l'impression que ça faisait partie de ces domaines qui étaient le
domaine du voisin là-haut, mais pas le sien. Il s'est intéressé
personnellement à plusieurs entreprises qui étaient de mon ressort, par
exemple la publication des Cahiers de Paul Valéry qu'il avait commencé
à mettre en train avant mon arrivée. Ca a été une opération qui a
rencontré une certaine hostilité de la part du Directoire, parce
qu'elle n'était commercialement pas viable. "C'est du luxe, le CNRS n'a
pas pour rôle d'être le mécène de Valéry." Ca a été une entreprise de
prestige.
Dupouy n'était pas vaniteux pour lui, il était vaniteux pour la maison. Il tenait par exemple à recevoir avec faste les collègues étrangers importants, de passage à Paris. On allait chez Prunier, on allait chez Lasserre. On invitait des dames. C'était très bien. Mais à partir d'un certain moment le contrôle financier s'est mis en travers : désormais ce genre de repas ne sera justifié que s'il s'agit de collègues étrangers, et si le collèque étranger n'est pas avec une dame -il n'y a pas de raison qu'il n'y ait des dames que de votre côté!- et de toute façon, ça ne peut pas dépasser tant par personne. Dupouy était fastueux: "nous sommes un grand organisme, nous sommes des gens importants, nous sommes parmi les gens les plus importants, pas personnellement, mais du fait de l'organisme. En même temps, il faut qu'on travaille, qu'on travaille bien et il faut qu'on représente." A mesure que les difficultés financières (du CNRS) ont crû, il est devenu de plus en plus difficile de bien traiter ces choses. Dupouy aimait mieux ne pas faire de déjeuner du tout que de déjeuner dans un petit bistrot. Il a été très fier quand il a été élu à l'Académie des Sciences. Il me disait :"Quand tu seras de l'Institut, surtout n'oublies pas que quand tu es dans un repas officiel, la maîtresse de maison doit te mettre à sa droite.... ".
Dans quelles conditions a t-il quitté la direction du CNRS ?Il voulait retourner travailler sur son microscope électronique. Il avait profité, ce qui est fort légitime, de sa position au CNRS pour injecter un peu des crédits à Toulouse, pour monter ce laboratoire d'optique électronique. A ce moment là la France était en avance même sur le Japon. Dupouy a été vraiment à l'avant garde de l'optique électronique. C'était le rêve de sa vie. Pendant qu'il était au CNRS on commençait à monter la labo à Toulouse, le jour où ça a été en place et où l'appareil a été prêt à fonctionner, il a dit "je retourne à mon microscope!". Ca a été l'unique raison et il est parti avec regret parce qu'il aimait bien le CNRS. Mais, comme il était un peu fastueux de nature, c'était agréable pour lui, être directeur général du CNRS, comme position dans le monde ça a plus de prestige, mais scientifiquement, c'était plus important d'être à son labo.
On a dit qu'il voulait en faire un organisme qui coiffe
la recherche française. Au moment où on commençait à parler de la DGRST
et de conseils interministériels pour la recherche, il estimait que
c'était contraire à l'idée d'un CNRS destiné à coiffer toute la
recherche française...
Je ne crois pas du tout que cela
correspondes à la réalité. Que sa réaction n'ait pas été très favorable
à certaines mises en place d'organismes comme la DGRST, qui n'est pas
un organisme de recherche, mais simplement un organisme de distribution
d'argent. Il avait l'impression que ces gens là travaillaient en
l'air, alors que le CNRS travaillait avec l'aval de la communauté
scientifique représentée par le Comité national, sorte d'Etats généraux
de la recherche que la DGRST venait court circuiter. Le CNRS n'a jamais
été un organisme de recherche unique : la recherche médicale a toujours
échappé au CNRS, le comité de recherches atomiques se faisait en
dehors. Ca excédait énormément les moyens du CNRS. C'est un problème de
dimension. Je ne dis pas que la recherche atomique n'intéresse pas le
CNRS, intellectuellement parlant, mais ça représente à l'échelle
nationale une mise de fonds incommensurable avec le budget du CNRS. Il
y a eu l'ORSTOM et nous avons eu des relations avec lui, quelquefois un
peu ironiques" L'ORSTOM avait des cadres, des cadres de
chercheurs, avec attachés de recherche, chargés de recherche,
directeurs de recherche, etc. on avait l'impression qu'il y avait une
sorte d'inflation, que cet organisme jettait un peu de poudre aux yeux
avec les grades. Mais après tout dans les pays où il travaillait,
c'était peut-être utile, vis à vis des gouvernements locaux. Il n'y
avait pas vraiment de conflits, on ne travaillait pas dans les mêmes
zones. J'ai essayé de nouer quelques liens avec l'ORSTOM sciences
humaines, à Dakar ou ailleurs, ça n'a jamais été très loin, chacun
restait un peu dans son coin. Même du temps de Dupouy le CNRS n'avait
pas et ne prétendait pas avoir le monopole. Mais c'est différent
d'avoir à côté de soi, dans d'autres domaines, des gens qui font
autre chose ou d'avoir au dessus de soi des gens qui distribuent de
l'argent, les maitres de l'enveloppe. Car l'argent du CNRS sortait de
cette enveloppe générale et cela donnait l'impression d'une sorte de
court circuit, puisqu'il avait été dit au départ que le Comité national
serait quelque chose du genre Etats Généraux de la Recherche
française et établirait entre autre chose les fameux rapports de
conjoncture. Les gens de mes sections ont toujours considéré le rapport
de conjoncture comme une abominable corvée. Je ne suis pas tellement
sûr que jamais dans mes sections un grand projet soit sorti de là. Ces
rapports, vous les avez regardés ?, c'est mesquin! ce n'est pas comme
ça, du moins dans mon secteur, que naissent les choses.
Mais je suppose que certaines commissions scientifiques, du côté sciences, ont réagi au niveau de ces rapports de conjoncture de façon tout à fait différente. Ils avaient probablement une mentalité constructive différente. Mais, mes clients à moi n'étaient pas des gens constructifs. Quand je voulais construire quelquechose je le faisais tout seul! J'avais des conversations avec les uns et les autres. A propos du Centre d'Etudes Sociologiques, Stoetzel, que j'avais eu autrefois comme collègue à la Faculté de Bordeaux, m'a dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'on ne pouvait pas rester comme ça. On s'est mis à deux ou trois pour en parler, mais il n'en est jamais sorti d'un rapport de conjoncture. Vous me direz qu'il y a peut-être des idées qui seraient bonnes et à côté desquelles on passe, mais je nen ai jamais jamais trouvé une de constructive. Dans la mesure où on a fait des choses on les a faites indépendamment de ces rapports. En SHS on disait : "words, words, words", personne ne croyait que cela nous permettrait d'obtenir de l'argent.
Les indicences de la nouvelle administration scientifique sur les SHS
Pour les sciences humaines, Dupouy, comme Coulomb, m'ont
laissé carte blanche. Pour les affaires qui risquaient de créer
un précédent, on discutait, on pesait le pour et le contre, mais quand
ce risque n'existait pas, j'avais carte blanche. C'était un accord
absolument total, et une bonne camaraderie parfaite. Dans le cas de
Coulomb, elle était presque fraternelle au bout d'un certain nombre
d'années. Ceci pour vous expliquer que ça a été pour moi, et je pense
pour d'autres qui ont été dans mon cas, une expérience très
enrichissante. Elle s'est déroulée dans un cadre très séduisant, parce
qu'on avait les moyens de faire des choses. (Par la suite) ce n'est un
mystère pour personne que l'action des syndicats n'a cessé de croître,
quoi qu'on pense de cette situation. Or la période dont je vous parle,
celle que j'ai connue, est une période où l'action des syndicats était
assez minime. Un certain nombre de mes successeurs ont eu du fil à
retordre avec eux. J'avais l'impression quand j'étais avec les gens du
Comité national , ou les gens du Directoire, d'être non pas en face
d'organismes mais en face de personnes, en face de collègues. Des gens
qu'on prenait un à un, avec qui on discutait. Ces conditions d'exercice
du "pouvoir" rendaient la chose attractive. J'avais aussi l'estime de
mes collègues, ce qui facilite les choses. J'avais des moyens
financiers, car jamais au cours de ces années de direction au CNRS je
n'ai eu à me battre pour la répartition des crédits. Avec mes deux
autres collègues on s'entendait. Il n'y avait aucune espèce de
"pourcentage". On ne disait pas "les sciences humaines ont 13% ou 18%
de l'ensemble". La part de gateau était toujours raisonnable et quand
il y avait une opération ponctuelle particulière, le directeur Général
s'arrangeait pour que les moyens existent. Je n'étais bridé ni
institutionnellement, ni financièrement.
Le dernier aspect du problème c'est la structure administrative, c'est-à-dire les bureaux. A mon avis les directeurs doivent être des scientifiques, mais du fait qu'il y a une technique, la finance par exemple, il faut des techniciens à côté d'eux. J'ai assisté à la création du poste de directeur administratif et financier. Avant ça, il y avait un brave homme, Laurichesse qui est devenu par la suite sous directeur. Il s'occupait du budget, mais d'une façon purement technique. C'était le comptable de la maison. Mais il n'avait aucun pouvoir de choix, il n'avait pas de prise sur quoi que ce soit. Tous les ans, en Conseil d'administration, il était là pour la discussion du budget, mais en réalité les problèmes s'adressaient à nous et pas à lui. Ces séances pénibles ( rires)! Il y avait des gens qui devaient de l'argent au CNRS, pour des raisons quelconques, 50 francs, 243 francs,... et qui n'avaient pas payé. En comptabilité, on n'a pas le droit de négliger ce genre de choses. Ca revenait tous les ans dans les comptes profits et pertes, et de temps en temps on faisait des apurements. Ce pauvre Laurichesse , c'était vraiment un comptable et ces trucs là le mettaient hors de lui. Il fallait qu'il demande au conseil d'administration la permission d'annuler un certain nombre de debets en expliquant à chaque fois pourquoi, parce que le type était parti, parce qu'il était insolvable, etc. (Laurichesse) était un personnage très précieux, mais sans aucune envergure. Un pur exécutant. Au contraire, à partir du moment où il y a eu des directeurs Administratifs et Financiers, ils ont plus ou moins prétendu dire leur mot non pas sur la correction des opérations, mais sur leur bien fondé et ce n'etait pas de leur ressort. Plusieurs fois, soit avec Claude Lasry, soit avec l'autre, il y eut des petits accrochages. Je leur disais : "mais, monsieur, ce n'est pas votre affaire!"
Pierre Creyssel ?
Oui, surtout avec Creyssel, mais déjà avec Lasry. C'est assez normal
quand on se trouve dans la situation d'un ministre des finances dans un
gouvernement ! (Au CNRS), Il y a deux contrôles, d'abord celui du
contrôleur financier. Avec celui-ci, on n'a jamais eu de difficultés,
les Contrôleurs financiers ne se sont jamais mêlés de savoir si on
avait raison de faire ceci ou cela, mais seulement si l'opération était
correcte ou conforme ou non aux consignes qu'il avait reçues du
Ministère. Mais, le directeur Administratif et Financier, à cause
de sa surface, était devenu le deuxième personnage de la maison.
Quelque fois il avait plus de pérénité que les directeurs généraux. Il
avait donc une certaine tendance à empiéter. Les relations entre
le directeur Général et le directeur Administratif et Financier ne
pouvaient être résolues sur le papier de façon satisfaisante.
C'est une question de personne, de relation personnelle entre les deux,
chacun respectant le domaine de l'autre.
Aujourd'hui, il n'y a plus de directeurs adjoints. Qu'on ait multiplié le nombre des directeurs scientifiques, a évidemment très certainement réduit leur position. Je prends un exemple: nous trois, nous allions les uns et les autres représenter la maison à différentes occasions, par exemple dans les ministères. Généralement c'était le directeur général qui allait en personne, en se faisant accompagner d'un chef de service . Mais quand il était empêché, quand il était en voyage, c'était l'un des deux autres. Il m'est arrivé d'aller au nom de la maison discuter le budget du CNRS rue de Rivoli. Il y avait Laurichesse, mais il était la cinquième roue du carosse. J'emmenais Laurichesse, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un du métier. Ainsi une année, je ne sais plus laquelle, j'ai discuté pendant une demi journée avec Poniatowski, directeur de cabinet. Une autre fois, pour prendre des choses un peu banales, je suis allé à l'Education Nationale pour les dossiers de demandes de Légion d'honneur. Naturellement j'allais au Ministère pour les affaires de mon ressort, mais aussi à l'occasion, pour les affaires générales de la maison. Ce qui est possible à un directeur adjoint me semble tout à fait impossible à un directeur Scientifique. Ceci pour vous faire remarquer qu'il y a eu une certaine diminution de standing. Naturellement c'est lié à l'augmentation continue de volume des opérations CNRS, à une certaine multiplication et à une espèce de prolifération administrative. Je ne dis pas que le CNRS est suradministré, je n'en sais rien, mais il y a eu incontestablement une tendance , genre loi de Parkinson, à multiplier l'administration.
(Avant), j'ai connu le CNRS de 1955 qui était dans une phase très artisanale, avec peu de personnel; du personnel d'ailleurs surchargé de travail. Il y avait quelques piliers comme madame Plin, Charles Gabriel, madame Niéva, trois ou quatre comme ça. Il y a eu Delaroche ensuite. Quatre ou cinq "officiers" et en dessous du personnel qui avait des responsabilités limitées, mais qui était surchargé de travail. La maison a été à un moment donné sous administrée. J'ai l'impression qu'elle a plutôt versé ensuite dans le travers contraire. Et je ne crois pas que le CNRS y ait gagné en souplesse au point de vue administratif. J'ai l'impression qu'une certaine sclérose accompagne de façon presque fatale ce genre de développement administratif.
Pourriez-vous
nous décrire, à travers les réalisations que vous avez pu faire, les
changements qui ont eu lieu dans votre secteur entre 1955 et 1963 ?
Je
vous avoue qu'avec le recul je vois cette période un peu en bloc.
Je vois bien ce à quoi vous voulez en venir : la description d'une
évolution, mais avec le recul, je n'ai pas l'impression d'une
évolution. Il y a des événements comme la création du directeur
Administratif et Financier. Il y a certainement eu des changements,
mais je n'ai pas l'impression d'une très grande évolution. Je me suis
beaucoup occupé, quand j'étais au CNRS des relations non pas avec
l'URSS, mais avec toutes les républiques populaires d'Europe de l'Est.
C'est à dire des conventions d'échange entre le CNRS et ce qui y
correspond dans ces pays, ce qu'ils appellent les Académies des
sciences. J'y allais avec la bénédiction et les instructions des
Affaires étrangères. Les Relations culturelles disaient par exemple:
"il faut qu'on essaye d'accrocher quelque chose avec la Pologne, mais
nous avons une difficulté du domaine purement diplomatique, depuis des
années un litige nous empoisonne à propos de la bibliothèque
polonaise à Paris, personne ne veut céder." Autrement dit, il y avait
des moments où rien n'était possible de ministère à ministère. C'était
bloqué par des contentieux, mais les choses pouvaient se développer au
niveau infra-ministériel. Ce niveau là, c'était CNRS - Académie des
sciences. Ainsi, on a commencé à développer des systèmes d'échanges.
Avec Varsovie, Prague, Bucarest, Sofia, etc. Je me heurtais à deux
types de difficultés: l'une est due à ce que dans ces pays, il y
a rivalité entre l'Académie des sciences et les universités qui sont à
couteaux tirés. Or, moi je ne pouvais conclure qu'avec l'organisme qui
avait des responsabiltés de même type (que celles du CNRS) qui était
non pas l'université, mais les académies. Il me fallait donc
faire des visites aux recteurs, leur montrer que je n'ignorais pas
l'université, que j'étais universitaire moi-même, mais que j'étais
obligé d'agir dans un certain cadre administratif et que je ne prenais
pas parti pour les uns contre les autres. Il y avait une autre
difficulté, absolue, qui était la Sécurité sociale. Les échanges se
faisaient sur la base d'un nombre égal de "mois-chercheurs" de part et
d'autre, étant entendu que si une des deux parties ne remplissaient pas
son contingent, celui-ci était perdu. Or, il y avait moins de
chercheurs français désireux d'aller à Budapest que de chercheurs
Hongrois qui voulaient venir en France. Par conséquent, il y avait un
contingent égal sur le papier mais il était convenu que l'on fermerait
les yeux si dans la réalité l'équilibre ne se faisait pas. La partie
qui recevait prenait en charge les chercheurs à raison de tant de mois,
etc. Il fallait fixer également le rang hiérarchique et les
émoluments... En France il y avait surtout le problème de la Sécurité
Sociale. Dans les pays de l'Est, tout le monde est automatiquement
assuré. Mais en France, vous n'avez pas idée des difficultés que cela
posait! J'ai appris à partir de la deuxième fois quel subterfuge
(échange de lettres annexé à la convention) permettait d'accorder
à ces étrangers le même régime qu' à nos éléments. Ces conventions ont
été ensuite englobées dans une convention générale. Au moment où les
contentieux entre Paris et les autres capitales ont été réglés, la
convention CNRS-Académie est devenue un élément constituant de la
convention culturelle générale.
A partir de 1955, je me suis également pas mal occupé des problèmes d'Afrique du Nord pour préparer le repli prévisible des organismes de recherche français en sciences humaines. Nous avions par exemple une équipe archéologique qui a été mise à la porte de Rabat. J'ai donc créé un organisme d'accueil à Aix-en-Provence qui est devenu un centre de recherche sur l'Afrique Méditerranéenne. Les sciences humaines ont été les premières balancées (quand ces pays sont devenus indépendants). Ils ont gardé plus longtemps les sciences appliquées, parce qu'ils n'avaient pas de techniciens de haut rang. Le Centre nucléaire d'Alger par exemple ne pouvait marcher qu'avec des français. Après l'indépendance, j'ai été pendant assez longtemps membre des commissions scientifiques mixtes franco-algériennes. Ces activités "hors frontières" qui ne m'avaient pas été demandées, étaient à mon initiative. J'avais bavardé avec les gens des Affaires Etrangères qui m'avaient dit que ce serait une bonne chose si je pouvais faire ceci ou cela.
Vous vous êtes occupé du Service de l'architecture antique d'Aix-en-Provence
Le Service d'architecture antique existait indépendamment de ces
histoires. Mais je me suis en effet occupé d'archéologie
nationale. J'ai essayé de discuter longuement avec le ministère
de la Culture, c'est-à-dire avec Malraux, des réformes de structure à
accomplir avec l'aide du CNRS. Malraux était un type étonnant, très
cordial. On bavardait et puis il disait : "écoutez, je suis très occupé
en ce moment, revenez m'en parler dans deux ou trois ans"! Je n'avais
jamais entendu un ministre antérieur dire une chose pareille. J'avais
toujours connu des ministres qui duraient six mois. Rue de Grenelle les
ministres duraient six mois en moyenne. C'était du Malraux tout pur,
mais malheureusement il est vrai aussi que pas mal de choses
attendaient...
Quelle opinion du CNRS avait Malraux ?
J'ai entendu un entretien de Francis Perrin disant qu'il avait une très
mauvaise conception de la science...Ce que je faisais n'a aucun rapport
avec ce que faisait Francis Perrin... Moi, je travaillais dans son
secteur, l'archéologie. Je lui disais "qu'est-ce qu'on peut faire
ensemble ?" Il était coopératif, mais il renvoyait à plus tard... Il y
a eu une loi Carcopino sous l'occupation qui a commencé à fonder
l'organisation de l'archéologie nationale et qui a en particulier donné
la mission de publication au CNRS. Le CNRS n'organisait pas la
recherche, mais organisait la publication. C'est le moment où on a créé
'Gallia', une chose unique que le CNRS a mené à bien. Mais il a fallu
batailler. Au début, 'Gallia' dont s'occupait Grenier était logée
dans une chambre de bonne, à côté du Bon Marché, rue de Rennes ou rue
de Sèvres. J'ai réussi à obtenir des locaux un peu plus grands et
j'ai fini par l'installer rue Pierre Curie, dans le bâtiment CNRS.
Puis, ça n'a plus été suffisant parce que la bibliothèque, par suite
d'échanges notamment, s'accroissait. Il y a eu ensuite le
transfert rue Jean Calvin que Pouilloux a réalisé.
Vous vous êtes aussi occupé des sociologues
Je me suis occupé, en liaison avec Jean Stoetzel,
du Centre d'études sociologiques. Je l'ai installé rue Cardinet dans un
ancien établissement de bain transformé et aménagé. Chaque fois,
c'étaient des querelles épouvantables avec l'administration centrale
sur la décentralisation. Implanter à Paris, s'agrandir dans Paris
était un scandale. Mais si on essayait de choisir la proche banlieue,
ça ne prenait pas.
Avez vous connu Mario Roques, l'homme qui avait introduit les sciences humaines au CNRS avant la guerre ?
Mario Roques était un grand personnage. Physiquement, c'était
un petit homme. Il a joué dans l'histoire, même de la Troisième
République, un rôle important. C'était un ami personnel d'Albert
Thomas. Il était une espèce d'éminence grise, ces gens qui n'ont
jamais eu la moindre situation politique, mais qui jouent un rôle
énorme parce qu'ils ont des amis qui connaissent tout le monde et parce
qu'ils ont de l'autorité. Scientifiquement également, Mario Roques
était quelqu'un. Etudient, j'ai eu Mario Roques alors qu'il était
encore jeune professeur à la Sorbonne. Je l'ai retrouvé ensuite comme
président d'un jury d'agrégation dans lesquels j'ai siégé. Je l'ai
connu à l'Ecole des Hautes Etudes, où il était président de la IVème
section. J'ai eu avec lui des relations diverses et toujours bonnes.
Pourtant, son caractère n'était pas toujours facile. Au CNRS, sans
qu'il y eût de raison ou de titre à cela, il avait une énorme autorité
. Dans le domaine qui était le sien, la philologie française, romane,
la littérature du Moyen Age, il a mis en route au CNRS, des opérations
comme l'atlas linguistique de la France, une vieille idée de (Broussard
?) qu'il a reprise, développée et organisée. Mario Roques est mort, et
toutes ces choses là me sont restées sur les bras avec des équipes
auxquelles il fallait donner un chef. Il y avait Monseigneur
Gardette ( ?), qui est mort depuis. Dans les équipes, les gens
n'étaient pas toujours d'accord. Au début du siècle, deux
linguistes français (Jules Lyon et Edmond ?) ont fait un atlas
linguistique de la France, c'est à dire le relevé de tous les patois et
de toutes les langues locales, sur la base de questionnaires
extrêmement détaillés (comment dites vous ceci ?, comment dites vous
cela ?, etc.). Il y avait une partie lexique, mais il s'agissait aussi
de faire faire des phrases aux gens ("il fait beau aujourd'hui, mais il
pleuvra demain", des choses comme ça), les gens interrogés étaient les
plus illettrés qu'on puisse trouver, pour que leur réponse ne soit pas
trop colorée par l'enseignement scolaire reçu. C'est le même
questionnaire que (Lyon et Edmond ?) ont promené partout pour pouvoir
confronter les réponses. Chacune des questions a donné lieu à une
carte. Cela intéressait à la fois la phonétique et la lexicographie,
quelquefois aussi la syntaxe. Ceci a été le premier instrument de
travail de ce type. Les autres pays ont ensuite imité et ont fait
mieux, la Suisse par exemple.
Roques a alors décidé de refaire l'atlas avec un questionnaire encore plus détaillé. On reprenait un certain nombre de questions des années 1900 pour voir ce qui avait pu changer au bout d'un demi siècle dans ces patois en décadence. C'était une énorme entreprise et les enquêteurs étaient peu nombreux. (Lyon et Edmond ?) ont tout fait à deux, extraordinaire! Ca a abouti à de nouveaux atlas régionaux, atlas de Bourgogne, d'Alsace, du Poitou, etc. Les enquêteurs ont voulu avoir un secteur libre dans leur questionnaire, il y a des questions, par exemple sur la culture de la vigne ou de l'olivier qui ont un sens dans certaines régions et pas dans d'autres. Il y a eu des disputes sur les limites: "Je prends tel département", "non, je le veux!" . On passait un temps fou en discussions. Résultat, des endroits n'ont pas été pris en considération, d'autres l'ont été deux fois. Finalement, du temps de Roques, ça n'a pas mal marché parce qu'il était "terrible". Mais avec Gardette, un excellent ecclésiastique, très doux, très apaisant, ça n'allait plus car il n'avait pas une autorité suffisante. Et ça régurgitait jusqu'à la direction ! J'ai convoqué les gens à Lyon en leur disant: "on ne sortira pas d'ici sans que vous vous soyez mis d'accord !"
Pour une entreprise comme celle là, vous avez dû faire appel à des collaborations exterieures au CNRS ?
Bien sûr, ce sont des universitaires qui ont travaillé. Je n'ai jamais
fait de différence. A l'époque dont je vous parle, sauf pour certaines
disciplines spécialement pointues (comme la biologie) qui n'avaient pas
de débouchés en facultés, c'étaient des gens de la même famille. Prenez
l'assyriologie. Si on veut qu'il y ait une petite, je dis bien
une petite, équipe d'assyriologues en France -si nous voulons garder un
rang dans ce domaine d'étude des textes du monde mésopotamien
ancien- il faut bien qu'on lui donne des moyens de travailler,
des missions bien sûr, mais surtout des hommes qui aient une
situation. Il y a trois chaires d'assyriologie en France (Strasbourg,
Collège de France et Ecole des Hautes Etudes), soit trois endroits où
on pouvait caser une personne. Mais on ne pouvait faire marcher les
choses avec trois personnes. Il fallait des chercheurs permanents,
professionnels, capables le jour venu de devenir professeurs, mais
jusqu'à ce que ce moment vienne que le CNRS leur donne la
possibilité de pouvoir travailler. Ca a été vrai aussi dans un
certain nombre de disciplines, comme la psychologie ou la sociologie,
des disciplines où il n'y a pas d'Agrégation. Magré tout le CAPES ou
l'Agrégation donnent des possibilités de situation, au moins dans
le second degré. Que voulez-vous que fasse quelqu'un qui a une licence
de sociologie ? Par conséquent il faut bien que le CNRS ait des
équipes, des chercheurs groupés et organisés -qu'on appelle ça
laboratoire ou autrement, peu importe- qu'il entretient. D'où un
certain déséquilibre statutaire dans la clientèle de mon ensemble de
commissions (SHS au CNRS). Ma clientèle comportait des commissions où
les gens étaient chercheurs de passage. Quand, par exemple, un agrégé
de lettres faisait une thèse, il la commençait comme professeur dans un
petit lycée. Mais l'enseignement quotidien, les corrections de copies,
pesaient lourd, et une fois que l'on voyait qu'il avait fait ses
preuves sur un chapitre, sur un plan général, on le prenait au CNRS
pendant un, deux ou trois ans. C'était une sorte de situation
sabbatique qui lui permettait d'avancer sa thèse. Il y avait des
commissions, comme celle de littérature française, où existait un
système rotatif de bourses de doctorat. Mais dans cette même
Commission, il y avait aussi des chercheurs permanents. Par exemple,
Jean Jacquot qui s'occupait de musicologie et d'histoire du théâtre. Il
en a toujours résulté, non pas des frottements, mais une espèce de gêne
parce que les commissions étaient obligées de traiter des personnes de
même mérite d'une façon différente, en tenant compte des entreprises
(je pense à Jean Jacquot qui avait une très grande entreprise
d'histoire du théâtre et de la musique). Elles devaient essayer de
tirer le meilleur parti pour la production scientifique des sommes et
des nombres de postes relativement modestes dont elles disposaient. Il
y a au contraire des commissions qui, parce qu'il n'y avait pas cette
infrastructure Education nationale (dans la discipline concernée),
prétendaient, souhaitaient ne travailler qu'avec des éléments
permanents. Et puis il y avait les syndicats qui étaient toujours pour
la titularisation, pour faire avancer le gens à l'ancienneté. Il
fallait manoeuvrer au milieu de ces difficultés, en tenant compte du
comportement individuel.
Au CNRS, les sciences humaines ont elles bénéficié de leur proximité avec les sciences exactes ?
Les sciences humaines ont toujours rencontré une autre difficulté, non
pas à l'intérieur du CNRS, mais au dessus ou au dehors, au niveau du
ministère. Le CNRS a été fabriqué pour les sciences exactes. Que les
sciences humaines y aient eu accès, c'est parfait. Mais il y a des gens
qui ont longtemps pensé que les sciences humaines avaient - si peu que
ce soit - parasité le CNRS. Résultat, on a toujours regardé le Centre
avec les lunettes de sciences exactes. Du point de vue des structures,
du point de vue du fonctionnement, tout a été imaginé en fonction des
facultés des sciences. C'est le modèle de la recherche en sciences
physiques et naturelles qui sert de cadre. Mes clients (SHS) recevaient
des questionnaires qui n'avaient pas de sens pour eux, ils étaient dans
l'impossibilité d'y répondre. Cette difficulté, je tiens à le
dire, je ne l'ai jamais rencontré à l'intérieur de la maison.
Elles venaient d'ailleurs, du gouvernement qui n'a aucune idée de
ce qu'est le CNRS! Il y a encore un autre problème, celui
des publications. Le CNRS a-t-il le droit d'être éditeur ? Comment
réglementer la concurrence entre l'édition publique et l'édition privée
? Le Centre doit-il uniquement se consacrer au livre invendable - la
réglementation de la concurrence revient finalement à ça - ou doit-il
opérer en publiant lui-même ou en subventionnant partiellement les
publications chez des éditeurs privés ? Si je vous en parle, c'est que
pratiquement l'édition au CNRS concerne les sciences humaines à 90%.
C'était d'ailleurs un des griefs fait aux sciences humaines. Quand on
prétendait que ça n'était pas le travail du CNRS d'être éditeur, on
s'en prenait aux sciences humaines. On cherchait des exemples, pris
dans le catalogue, qui pouvaient prêter à critique, et on vous les
jetait tout le temps à la figure. Quand je suis arrivé au CNRS, un
sociologue avait fait un travail sur "la colombophilie chez les mineurs
du Nord", travail dont aucun éditeur ne voulait et qui a été publié,
assez luxueusement avec des tas de photos, par le CNRS. C'était un bon
petit travail avec des statistiques, une enquête dans plusieurs
villages, un exposé de la technique, etc. mais, évidement, c'était le
genre de livre qui passionnait pas les foules. Eh bien, vous ne savez
pas combien de fois on m'a jeté ça à la tête ! On me considérait comme
un personnage ridicule à cause de cette histoire de pigeons voyageurs.
Ceci n'arrive pas pour les sciences exactes. Là, rien que les titres
sont en général imcompréhensibles pour un simple journaliste.
Les relations des sciences humaines avec l'administration ?
Autre type de difficulté dans mon secteur, les rapports avec un certain
nombre d'administrations dépendant du même ministère ou surtout
dépendant d'autres ministères : L'administration des musées, celle des
archives ou des bibliothèques demandaient au CNRS des collaborateurs
techniques. Celui-ci avait toujours tendance à leur répondre que ce
n'était pas lui leur patron. Qu'elles demandent donc à leur patron les
moyens de travail dont elles avaient besoin. Le CNRS n'est pas un
'SOS médecin' pour administrations malades! Les administrations
répondaient qu'elles voulaient bien faire leur métier, par exemple de
la muséographie, mais qu'il fallait aussi un secteur de recherche dans
les musées (comme il y a le laboratoire d'Ours au musée du Louvre pour
la restauration des tableaux). Si le CNRS ne les aidait pas, elles ne
pouvaient rien faire! C'était la même chose dans les
bibliothèques, aux archives, dans un certain nombre d'institutions
latérales avec qui on était en fréquent désaccord pour des
délimitation de compétence. En définitive, on était obligé de céder ,
ce qui créait des précédents. On ne voulait pas laisser tomber des
choses vraiment intéressantes alors que l'administration ne levait pas
le petit doigt.
Le
CNRS ne patissait-il pas de l'héritage de la Caisse des sciences
créée essentiellement pour fournir des aides techniques aux chercheurs ?
J'ai
été moi aussi de la Caisse des sciences et je ne savais même pas
qu'elle existait! C'est encore une parenthèse autobiographique. Je suis
entré en 1926 à l'Ecole Normale, j'ai passé l'Agrégation, j'ai fait mon
service militaire en 1929-30, la quatrième année d'Ecole n'existait pas
à ce moment là, mais Boutelet( ?) qui était directeur et qui voulait
m'aider, m'a proposé une quatrième année d'Ecole en échange de menus
services : aider les agrégatifs de philo à préparer les auteurs grecs
de leur programme. Je commençais seulement à débrouiller un peu ma
thèse et mes patrons, Meillet et Vendryès, me disaient qu'il fallait
que je reste encore au moins deux ans à Paris avant de partir en
Province comme tout le monde. C'était nécessaire moins pour mon travail
que pour mon apprentissage. J'avais à travailler (études germaniques,
sanscrit) avec un tas de gens qui étaient à Paris. Ils m'ont fait
remplir une demande et j'ai été boursier de la Caisse des Sciences
pendant deux ans. Au bout de ces deux ans, je m'apprêtais très
honnêtement à demander à la direction de l'Enseignement
Secondaire un poste de lycée quelquepart, quand Meillet et
Vendryès m'ont dit de demander mon inscription sur la liste d'aptitude
à l'Enseignement Supérieur! Ca me semblait pour le moins prématuré,
$ j'avais seulement écrit un chapitre de ma thèse pour montrer
que j'étais capable de le faire, je ne savais même pas sur quoi serait
mon autre thèse! Le comité consultatif m'inscrit sur la liste, et je
suis convoqué rue de Grenelle à la direction de l'Enseignement non pas
secondaire mais supérieur par le directeur qui m'offre le choix entre
trois postes de maitre de conférence. Un à Lille, un à Nancy, un à
Poitiers. J'ai choisi Poitiers. C'était en 1933, Hitler était déjà
arrivé au pouvoir et Poitiers était tout de même plus loin de la
frontière! J'ai eu un entre deux sous forme d'une espèce de
bourse de la Caisse des Sciences, mais en réalité ce sont mes patrons
qui ont fait ça pour moi, je ne savais même pas que ça existait! Je
faisais allusion à ça à la réunion du Comité de Patronnage, l'autre
jour au CNRS, et un autre de mes collègues, je ne sais plus lequel, m'a
dit que lui aussi avait été pendant deux ans à la Caisse des Sciences!
Cette Caisse donc n'avait pas pour fonction unique de donner des
collaborateurs techniques, mais elle avait en même temps un petit
"stock", comme on dirait maintenant, de chercheurs tout à fait
temporaires.
Vous nous avez parlé des sections
de la façon de travailler, de juger les chercheurs, je prends un
exemple de chercheur aux frontières de plusieurs disciplines, Georges
Dumézil. Comment a-t-il été considéré dans les commissions du CNRS à
votre époque ?
Je comprends votre question, mais en même
temps elle n'a pas de réponse. Il y a des gens en effet qui sont à la
jointure de plusieurs disciplines, ça a des avantages et des
inconvénients. Un personnage pose sa candidature à un poste de
chercheur, il est dans cette situation frontière, il choisit une
commission, la commission A, parce que dans la A, il connait
monsieur X, mr Y, mr Z, et qu'il a l'impression qu'il y aura des gens
pour appuyer son dossier, tandis que dans la commission B il y en aura
peut-être moins. Idée un peu naïve, parce que dans les commissions il
n'y a pas que trois personnes et que trois appuis dans une Commission
qui comporte souvent une vingtaine de personnes ne changent pas
vraiment les choses. Si le gars est un type remarquable, ça ne fait
jamais un pli nulle part. Si le gars est loin d'être encore un type
remarquable, mais est un candidat moyen, et dieu sait s'il y en a, il
arrive dans cette Commission A, le rapporteur de son dossier le
connait, il fait un rapport favorable, les deux autres se rangent à cet
avis, mais il reste les dix sept autres. Ils se disent: "on ne nous a
donné que cinq postes à distribuer, or voilà un gars qui pourrait aussi
bien être de l'autre côté, dans la commission B. On ne va pas gaspiller
un de nos postes à nous, il vaut mieux garder nos cinq postes pour des
gars qui sont en plein dans l'axe de notre discipline." Au moment du
vote, malgré l'avis favorable, le gars est classé dixième. Il se dit à
la session suivante, je me présente à la Commission B. Et là il se
produit la même chose. Cela affecte les gens moyens, les bons on se les
arrache! pour eux, il n'y a pas de problème de frontière. Ces problèmes
de frontière existent sur le plan pratique. Si le type est un type très
bien les frontières n'ont aucune espèce d'importance, si le type est
une type moyen, les petits égoismes locaux joueront contre lui, à
chaque coup. Peu importe Dumézil en l'espèce, on a bien eu un élève de
Dumézil au CNRS que j'ai toujours trouvé extrêmement médiocre, et qui
est mort le pauvre malheureux, il s'appelait Guerchev( ?). Lui aussi a
été balloté: il est entré, mais au bout d'un moment la Commission qui
l'avait a voulu le refiler à une autre! Vous ne supprimerez jamais ces
problèmes là, parce qu'il est nécessaire qu'il y ait des frontières. Au
fil des ans on a multiplié les commissions. Je l'ai fait moi-même
modérément. Plus on multiplie les commissions, plus on multiplie les
frontières. Il m'est arrivé de voir le même dossier une fois dans une
Commission, une fois dans une autre. Quand un dossier arrive dans la
seconde commission, après avoir été refusé par la première, c'est une
mauvaise note. C'est un des cas où j'estimais pouvoir éventuellement
intervenir quand je pensais qu'il y avait une erreur d'appréciation. Je
disais à la seconde commission " la raison pour laquelle il a été mal
placé, c'est qu'en partie il vous appartient , il appartient aux deux."
Il fallait éviter les réactions dejalousie de Commission. "Vous dites
que vous n'avez que trois postes à distribuer, mais qui vous les a
donnés à distribuer, sinon moi ?, si vous vous comportez comme ça,
rappelez vous que le nombre de postes que vous brandissez ainsi, c'est
de mes mains qu'il vient."
Pourrait-on
remédier à ce genre de problèmes en créant des intercommissions, ou
lors du redécoupage du Comité national en mettant une section là où il
y avait une frontière ?
Je réponds de manière absolument
pessimiste à votre question : il n'y a pas de solution. Les
intercommissions ne servent qu'à alourdir encore le fonctionnement. Je
pense qu'il faut que la direction soit vigilante sur ces problèmes là.
C'est pourquoi il faut être présent, être sur place. Ce n'est pas en
créant des organismes supplémentaires qu'on résoud des problèmes comme
celui là. Votre système est parfaitement utopique: il y aura encore
plus de difficultés avec votre système qu'avec les autres. Une
intercommission céée pour le règlement d'un contentieux frontalier, je
n'y crois absolument pas. Je me suis toujours arrangé autrement,
pour ça il faut être en contact avec les gens et que le cas en vaille
la peine. Vous allez trouver probablement que je donne l'image d'un
personnage autoritaire. Mais, je ne crois pas. Avoir de l'autorité et
être autoritaire, ce n'est pas du tout la même chose. L'autorité
personnelle n'est pas inscrite dans les organigrammes ni dans les
textes. L'esprit du système repose ou devrait reposer énormément sur la
présence, non pas dans l'empyrée, du directeur, mais présence sur le
terrain auprès des gens, et sur l'autorité personnelle qu'il a sur les
gens. Vous n'imaginez pas combien ça supprime de faux problèmes
irritants. Ca marchait comme ça à mon époque et ça marchait dans
l'ensemble bien. Il peut arriver que deux commissions aient à mettre
sur pied ensemble une entreprise commune. Là oui, il faut créer un
petit organisme, même temporaire, même officieux, mais qui réunisse des
gens des deux commissions concernées pour mettre sur pied un projet
commun. Il n'est pas raisonnable de présenter séparément à deux
commissions un projet qui les intéresse au même titre toutes les deux
en les laissant discuter sans aucun contact l'une avec l'autre. Avec en
plus l'avantage parfaitement injuste donné à celle des commissions que
le calendrier aura fait servir la première, et qui par conséquent ne
laissera pas la situation intacte au moment où l'autre va discuter.
Mais ce n'est pas un cas fréquent. En général les commissions
travaillent à 90% dans les limites de leur secteur.
Ne peut-on pallier ces difficultés en déplaçant périodiquement ces frontières ?
Je vais vous décevoir aussi, si c'est une idée qui vous est chère! A
première vue ça me semble une très mauvaise idée. Plus vous changez les
choses plus vous allez déconcerter les gens. Le CNRS ne travaille pas
en principe uniquement à court terme. Vous allez mettre les chercheurs
devant un Comité national qui ne sera jamais le même d'une fois sur
l'autre, comme ces malheureux adolescents qui subissent une réforme du
bac chaque année! Les changements dans le Comité national ont fait des
drames parmi les collègues mêmes du Comité national, sans parler des
clients que sont les chercheurs eux-mêmes! Je vous en ai raconté un que
j'ai résolu, mais il y en a eu d'autres! Cette idée d'une espèce de
changement permanent me semble déraisonnable.
Quid d'initiatives un peu originales comme la création du Centre d'étude pour la traduction automatique de Vauquois ?
Ca venait des militaires. C'était une idée compréhensible, mais en même
templs la motivation était saugrenue. Les militaires voulaient une
machine qui permette de traduire le russe, pour pouvoir lire les
ouvrages scientifiques russes, savoir où en étaient les gens de ces
pays là qui nous tomberaient sur le dos un jour ou l'autre et pouvoir
aviser en temps voulu. Je caricature un peu bien sûr. Mais c'était la
motivation. On met un traité de physique atomique russe dans la machine
et après ça on connait tous les secrets atomiques! Les militaires
avaient installé quelque chose au Fort de Montrouge. A un certain
moment ça a intéressé les scientifiques de Grenoble pour des raisons
qui n'avaient rien à voir avec la menace soviétique! Il y avait des
recherches en Amérique, en Californie je crois ou au MIT qui
travaillaient là dessus. En France, il y avait deux équipes assez
dépourvues de moyens l'une et l'autre et qui travaillaient chacune dans
son coin, l'une à Montrouge, l'autre à Grenoble. On a essayé de les
faire travailler ensemble, d'organiser au moins une répartition des
axes de recherche, qu'ils ne soient pas deux avec peu de moyens à faire
en plus exactement la même chose. Les militaires ont lâché pied au bout
d'un certain moment et ce qui a subsisté, c'est le noyau de Grenoble,
dont je n'ai pas suivi très exactement les progrès, mais qui s'est fait
très largement coiffer par les recherches de l'étranger. Il y a un
problème théorique: est-ce qu'on peut faire avaler du français à une
machine pour qu'il en ressorte de l'allemand ou du chinois. Est-ce que
ça peut se faire par des manipulations bilatérales ou est-ce qu'il faut
inventer un langage machine, c'est-à-dire une espèce de linguistique
théorique schématique propre à la machine ? On entre du français qui
est traduit en langage machine, puis le langage machine sera retraduit
dans n'importe quelle autre langue. Il y a deux grandes options:
fabriquer un langage machine ou pas. Cela pose d'énormes problèmes de
linguistique générale. C'est d'ailleurs la linguistique générale que ce
genre de développement a le plus perturbée, parce qu'elle n'avait
jamais travaillé dans ce genre d'hypothèses pratiques. Les analyses du
fonctionnement du langage en général ont toujours été faites d'une
façon purement théorique. Un jour on a dit quelqu'un va dire si
vos théories sont bonnes ou mauvaises : c'est une machine !
Dans l'affaire de la traduction automatique, il s'agissait de réduire une concurrence stérile
Il m'est arrivé assez souvent d'avoir des entreprises concurrentes à
mettre d'accord. Par exemple, l'inventaire du lexique de la langue
française. C'était au moment où on se posait la question peut-on faire
un inventaire général de la langue française à partir du moment où on a
eu une batterie d'ordinateurs avec des mémoires pratiquement
illimitées. On leur donnait à manger des textes et ensuite on appuyait
sur un bouton et on avait tous les exemples du mot 'capitaine' à
travers les âges, avec le contexte ou avec tel segment de contexte.
J'ai organisé un colloque à Strasbourg, avec en particulier Imbs sur la
possibilité de mettre en place une entreprise de ce genre. J'avais,
avec une abominable malice, invité à ce colloque Robert, qui avait lui
fait son dictionnaire tout seul et qui a gagné de l'argent. Il venait
de sortir son premier volume. Je lui ai demandé de venir dire aux
autres qui faisaient de la recherche lexicologique comment il avait
fait là-bas en Afrique du Nord pour monter une opération pareille. De
ce colloque, il est finalement sorti le projet Imbs d'installer le
'Trésor de la langues française' (TLF) à Nancy. J'ai eu beaucoup de
peine d'ailleurs avec le Directoire: au bout d'un temps assez court,
avant qu'on ait nourri toutes ces mémoires, il voulait déjà à l'autre
bout avoir des produits et ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait
tout le matériel avant d'écrire le premier mot du premier volume, ça
n'a pas de sens autrement. J'ai dit au Directoire : quand vous plantez
un olivier, vous ne récoltez pas d'olives l'année suivante, ni la
deuxième année, ni la troisième année. Et bien, c'est un olivier qu'on
a planté à Nancy! J' ai eu du mal à refreiner les impatiences du
Directoire qui avait fait une grosse mise de fond et qui voulait voir
sortir les choses tout de suite à l'autre bout.En même temps il y avait
un autre laboratoire de recherche à Besançon et il a fallu essayer de
mettre tout ça d'équerre. Il y a eu un assez grand gaspillage
d'efforts. Dans ces cas là où on ne peut rien supprimer, on essaye
d'harmoniser. En général vous ne partez pas de zéro, il y a déjà des
petits noyaux qui existent, et il faut tenir compte des gens, même si
ça gauchit la structure et si ça ralentit les résultats.
De votre point de vue, qu'a apporté le CNRS au cours de son histoire ?
Je suis incapable de répondre à une question comme celle-là! Le CNRS
n'a pas créé de discipline, il en a développé, il a aidé à se
développer des disciplines qui même autrement étaient déjà en
croissance et en popularité, c'est à dire qui attiraient, intéressaient
l'opinion. Je ne discute pas de l'aloi de cette popularité, mais
l'intérêt plus ou moins général est un fait! La sociologie intéressait
l'opinion beaucoup plus que l'assyriologie, il n'y a pas le moindre
doute! Des disciplines étaient déjà portées, on leur a donné un certain
nombre de moyens. Le CNRS n'a jamais été le seul pourvoyeur de moyens,
l'Université l'était aussi. Je n'ai jamais compris qu'il y ait une
espèce de conflit, d'animosité entre l'Université et le CNRS : ce sont
les mêmes gens. Pour moi, ça me semble d'une absurdité absolument
complète! Je dirais que c'est très heureux qu'il y ait les deux, pour
alimenter le financement de la recherche, car avec deux sources, on a
toujours plus qu'avec une seule. Le jour où un seul de ces organismes
alimentera la recherche, quelque soit celui des deux qu'on choisira, il
y aura moins de crédits. L'existence de deux sources permet beaucoup
plus de souplesse et un résultat total supérieur.
Ca vous est déjà arrivé d'être malade ? J'espère que non, un petit peu quand même ? Le médecin vous dit "vous allez prendre de ceci et vous allez prendre de cela" au bout de quinze jours vous étes guéri, lequel des deux médicaments vous a guéri ? C'est ça la question que vous me posez! Je ne peux pas vous répondre. Je peux bien sûr vous dire qu'il y a des petites choses que les ressources de l'Université permettent de faire, parce qu'elle est tout de même moins riche que le CNRS et ne peut, ne pouvait pas du moins, faire des grosses opérations comme le Trésor de la Langue Française, par exemple. L'université n'aurait pas mis en place un Service de l'Architecture Antique, mais il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur l'action de l'un ou l'autre des participants à l'opération recherche, j'appelle les deux participants:le CNRS et l'Université, dans mon secteur cest ça. Il y a des choses que l'une peut faire et que l'autre ne peut pas faire et inversement! L'Université peut donner des moyens de vivre à un tas de chercheurs qui sont en même temps des enseignants, et le CNRS peut faire lui des opérations Labo que l'autre ne peut pas faire. Finalement ce sont les mêmes gens qui sont des deux côtés. C'est pourquoi j'ai toujours considéré, du point de vue des sciences humaines comme une stupidité sans nom de rattacher comme ça le Ministère de la Recherche à l'Industrie par exemple. Le CNRS est fait pour rester dans le même ministère que l'université. Ca me semble à moi une évidence même!, seulement vous me direz que je ne suis pas préoccupé de science appliquée, ce n'est pas mon métier.
Le CNRS a donc eu un rôle crucial en matière d'organisation de la recherche
C'est là qu'il peut mieux agir que l'université. Je me plaignais
tout à l'heure qu'on nous ait toujours alignés sur les gens d'à côté,
scientifiques, mais un personnage comme René Descartes, qui travaillait
dans son poële, comme on dit, n'aurait jamais été admis au CNRS parce
qu'il ne faisait pas parti d'une équipe. On n'est pas pestiféré quand
on n'est pas au milieu d'une équipe de douze personnes. Il y a des cas
où il est absurde de travailler tout seul, des cas où le nombre autour
de vous ne change rien à la question. Dans des cas comme ça l'optique
faculté des sciences nous a quelquefois gênés. Il nous est arrivé de
faire des équipes fanntômes, qui n'avaient pas d'homogénéité, parce
qu'on voulait absolument que les gens soient groupés. On a plus d'une
fois fait des rattachements pro forma pour prendre des gens et on s'est
retrouvé gêné aux entournures par des exigences qui ne répondent pas à
la réalité des choses. Inversement, quand nous avons eu à faire des
opérations labo, cela nous a été très utile d'avoir l'expérience et la
référence des gens qui eux avaient déjà l'habitude de travailler comme
ça.
Est-ce que ceci n'amènerait pas à envisager deux CNRS, l'un pour les sciences exactes, l'autre pour les SHS ?
Il n'y a jamais eu dieu merci de division entre deux classes.
Traditionellement, rue d'Ulm, à l'Ecole Normale, il y a un directeur
littéraire, un directeur scientifique, il y deux classes, et le
directeur général est alternativement l'un et l'autre directeur
adjoint. Si cette situation existait au CNRS, il y aurait eu, je pense,
d'avantage la tentation de le couper en deux. Au niveau de la
direction, ça a été coupé en trois et non en deux. Ce qui change tout
le problème. Il n'y a jamais eu de structurs binaire, mais une
structure au moins ternaire dès le début. Dans un des autres tiers, il
y avait des gens qui pensaient exactement comme nous : les
mathématiciens. Ceux-ci travaillaient comme nous. C'est une des raisons
pour lesquelles on n'était pas isolés, un secteur à part, des gens à
part qui s'occupent de pigeons. Même chez l'ennemi, si j'ose
dire, on avait des alliés. J'ai toujours été d'accord avec des gens
comme Lichnérowicz. Ceci est une raison de plus pour qu'il n'y ait pas
cette espèce de fissure, de pointillé le long duquel on aurait pu
vouloir découper le CNRS. Dans la réalité, cette fissure n'existait
pas, au niveau des services non plus. Au Service des missions il n'y a
pas une personne qui s'occupe des missions de ceci et une autre des
missions de cela. Le CNRS n'est pas bâti de telle façon qu'on puisse
dire un jour : tout ce qui est de ce côté on l'enlève. On peut
leur dire que les recherches diffèrent entre elles, mais que nous, les
SHS, nous représentons les secteurs qui avec le moins de moyens
financiers assurent la place de la France dans le monde. Le rapport
qualité prix est en notre faveur : avec 10% des moyens du CNRS, nous
tenons notre place de la façon la plus honorable dans un grand nombre
de disciplines. C'est un placement qui rapporte, un point de vue
qu'aucun gouvernement n'a le droit de négliger.