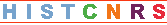En cas d'usage de ces textes en vue de citations,
merci de bien vouloir mentionner leur source (site histcnrs), ses auteurs et leurs dates de réalisation
Entretien avec Bernard P. Lécuyer
Elisabeth Pradoura, le 11 septembre 1986 (source : https://www.histcnrs.fr/temoignages.html)
Je suis historien de formation, une spécificité parmi les sociologues. Je suis entré à l'Ecole Normale Supérieure (ENS) rue d'Ulm en 1955 en section d'histoire. J'aurais préféré celle de philosophie, mais l'hégélianisme régnait en maitre et la philosophie sous son aspect de logique formelle n'était pas très développée. Pour ces raisons et par goût pour des études plus concrètes, j'ai préféré la section d'histoire qui ouvrait davantage de possibilités. J'ai donc fait un diplôme d'études supérieures d'histoire économique avec Ernest Labrousse sur un sujet d'histoire sociale : 'La disparition de la catégorie des salariés agricoles durant la période du Second Empire'. Ce sujet n'était pas documenté, on savait juste qu'entre 1860 et 1880 cette catégorie disparaissait pratiquement des campagnes. On savait aussi qu'il existait des enquêtes agricoles décennales, mais on ne savait pas où les trouver. Les contraintes du travail étaient assez fortes puisqu'il s'agissait de faire une recherche en six ou huit mois. Labrousse m'avait dit : "je ne sais pas où sont les sources, cherchez les" et j'ai eu la bonne fortune d'en découvrir en Haute Marne. C'est ainsi que j'ai pu reconstituer un certain nombre de mécanismes de la disparition du salariat agricole. Simultanément, je participais aux séminaires d'Alain Touraine et de Georges Balandier rue d'Ulm grâce auxquels, sous l'impulsion de son directeur, le philosophe Jean Hyppolite, l'ENS commençait à s'ouvrir aux sciences sociales. A l'époque la sociologie ne débouchait pas sur l'agrégation. En tant que normaliens, comme nous étions ligotés par une obligation de service à l'Education nationale, on pouvait passer l'agreg, mais au titre des Beaux-Arts par exemple.
J'étais alors vice-président de l'UNEF (Union nationale des étudiants de France), chargé des questions d'organisation de l'enseignement supérieur. J'avais poussé l'UNEF à prendre une position un peu restrictive sur la licence de sociologie, d'ailleurs en contradiction avec les souhaits de Raymond Aron. Je souhaitais que ne puissent se présenter que des étudiants ayant déjà une formation dans une discipline fondamentale, philosophie, histoire, psycho ou ethnologie, il me semblait que le corpus de connaissances sociologiques n'était pas suffisant pour assurer une formation de base. Plusieurs de mes collègues pensaient d'ailleurs qu'il fallait considérer la sociologie davantage comme une méthode de travail plutot que comme une science en soi. J'ai donc passé l'agrégation en 1961 où j'ai été reçu premier, mais l'histoire ne débouchait que sur l'enseignement secondaire et comme il y avait crise du recrutement d'enseignants, une fois que l'on était engagé là dedans il n'était pas sur que l'on puisse en sortir. Des maitres reconnus de la Sorbonne ou du Collège de France réclamaient bien à cors et à cris des jeunes chercheurs qu'ils souhaitaient comme assistants, mais l'Inspection générale ne voulait rien savoir. Touraine trouvait idiot que je parte dans le Secondaire et il m'a suggéré de me présenter au CNRS, ajoutant qu'il soutiendrait ma candidature. C'était le mouvement ouvrier qui m'intéressait à l'époque. Mais comme il vaut mieux étudier ce qu'on connait déjà et que j'avais fait du militantisme syndical, il m'a proposé un projet de recherche sur les mouvements étudiants. Ca, c'est du Touraine ! D'où le titre du projet envisagé : 'La portée sociale des mouvements révolutionnaires étudiants mondiaux depuis le début du XIXème siècle'. Au début des années 1960, c'était une belle prescience de sa part. L'UNEF dont j'avais été membre était l'équivalent de ce qu'est la CGC (Confédération générale des cadres) à un niveau beaucoup plus modeste. C'est-à-dire une association revendicative, mais sans ambition révolutionnaire. Sur une population étudiante de moins de 20 000 étudiants en 1957, l'UNEF fondée à la Libération avait une représentation de près de 80%, un taux de syndicalisation pratiquement équivalent à celui des professeurs du second degré. Certes, on faisait de la politique, notamment à propos de l'Algérie et j'ai fait partie de l'équipe qui avait pris le contrôle de l'UNEF sur le problème de l'indépendance. Mais, nous étions tout de même loin de ce que sont devenus les mouvements étudiants par la suite. Cela a duré un an et demi et a un peu pénalisé ma carrière parce que ça impliquait une activité à plein temps, du temps qu'il fallait ensuite récupérer pour passer les examens. Mais nous avions tout de même une belle efficacité. On a réussi à faire aboutir pas mal de revendications importantes, les bourses, les restaurants universitaires, la cité universitaire d'Anthony.
En fait, la sociologie était la meilleure manière d'entrer au CNRS, une véritable fusée pour le recrutement dans l'ensemble du secteur humanités sciences sociales. Les intégrations commençaient début avril avec l'écrit et duraient jusque mi-août. Les dossiers devaient être déposés au CNRS avant le premier mai. Je vois Touraine vers le 5 ou 6 septembre et aussitôt, en ma présence, il téléphone à Georges Gurvitch, le président de section du Comité national. "Monsieur le président, j'ai devant moi quelqu'un d'absolument exceptionnel, une occasion qu'il ne faut absolument pas manquer (Il présentait tout le monde comme ça, il n'y avait rien de très personnel là dedans). Premier à l'agrégation d'histoire, etc., est-ce que vous m'autorisez à déposer son dossier?" Gurvitch donne son accord et téléphone directement à Madame Niéva, la secrétaire du Comité National. C'est comme cela que ça se passait à l'époque. Puis Touraine m'a dit de revenir le voir avec mon projet, la section se réunissant le 15 du mois . J'ai donc fait ce que je n'ai plus jamais fait de ma vie, la rédaction en une nuit d'un projet de recherche qui devait faire péniblement huit pages. Il y avait quatre postes à pourvoir et j'ai été classé cinquième, finalement, ce n'était pas plus mal, il valait mieux remettre ça et me représenter l'année suivante. Aron avait dit à Touraine que mon papier n'était vraiment pas fameux. Celui-ci s'était marré et lui avait répondu : "si on vous disait en combien de temps il a été fait... En une nuit!" et celui-ci avait bien voulu reconnaitre que dans ces conditions, "c'était plutôt pas mal". En tout cas, j'avais réussi à éviter le Secondaire, à la cérémonie qui se tient après les résultats du classement à l'ENS, ce qu'on appelle 'la confession', j'y étais allé au flan en déclarant à l'Inspecteur général (René Clozier) que monsieur Labrousse voulait que je fasse un troisième cycle avec lui. Par conséquent je préférais ne pas prendre de poste, le premier disponible étant le lycée de Blois (avec un changement de train à l'époque), alors que l'on proposait Lille à ma femme. Là encore j'ai bénéficié d'un arrangement non bureaucratique qui je crois n'existe plus. Il existait un accord tacite entre le directeur des enseignements secondaires et la direction de l'ENS selon lequel le premier de chaque agrégation obtenait un sursis d'intégration d'un an. Je savais qu'Ernest Labrousse était aux eaux à Evian et, connaissant le style de l'inspecteur général, un géographe d'une soixantaine d'années qui écrivait encore à la plume sergent major, j'étais sûr qu'il n'allait pas lui télégraphier à Lausanne pour savoir si ce que je lui racontais était vrai. C'est ainsi que j'ai passé une année un peu chaotique à enseigner la littérature en classe de troisième, y compris le français médiéval pour un tiers-temps au collège Sévigné. J'ai aussi écrit plusieurs chapitres du 'Clémenceau' de Gaston Monnerville (le pdt. du Sénat d'origine guyanaise), ce qui donnait lieu à une fine plaisanterie, j'étais devenu le nègre du nègre! J'avais rédigé deux ou trois chapitres sur les rapports de Clémenceau avec les artistes de son temps. Il n'était pas seulement le briseur de grèves que Jacques Julliard a décrit (à juste titre), il était aussi l'un des rares hommes politiques de l'époque à avoir une très bonne connaissance du monde des arts. Clémenceau avait un gout très sur, il connaissait très bien les impressionnistes, il était l'ami de Claude Monet. Monnerville a sabré tout ça, dommage. J'ai donc re-rédigé mon projet d'intégration, en tenant compte des diverses objections de la commission. En mai 1962, j'ai présenté la deuxième mouture du projet, beaucoup plus argumentée. La reformulation très 'planétaire' supposait des qualités qui étaient précisément celles qui m'avaient fait renoncer à la philosophie. Il fallait être capable de schématiser, en tout cas interpréter la relation entre les révoltes d'étudiants à Vienne en 1848 et le mouvement étudiant latino-américain du vingtième siècle.
Je suis donc entré au CNRS comme attaché de recherche (AR). C'était l'une des premières fois que l'on recrutait quelqu'un au plus haut échelon de ce grade, un précédent qui a servi aux collègues par la suite. Ainsi, l'année suivante, Jacques Lautman qui revenait d'un tour du monde a conforté ce précédent. C'était la première fois que des normaliens se présentaient au CNRS dans cette section et dans les humanités en général. A l'époque, contrairement aux sciences exactes, aucune carrière n'était prévue au CNRS dans ces disciplines. Certes, il y avait eu une première vague, très courte, à la Libération avec Alain Touraine et Jean-Daniel Reynaud au Centre d'études sociologiques (CES). Mais au début des années 1960, Touraine venait juste de passer à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). L'historien Fernand Braudel l'avait nommé directeur d'études parce qu'il était l'un des poulains les plus brillants de Georges Friedmann le fondateur du CES en 1945. Reste que j'ai toujours été reconnaissant à Touraine de m'avoir fait connaitre les possibilités de travailler au CNRS. Labrousse qui n'y connaissait rien, parlait encore de bourses de recherche dans les années 1960, il en était resté à la caisse des sciences !
En 1962, le sociologue Paul Lazarsfeld est nommé professeur associé à la Sorbonne pour une année universitaire. Jean Stoetzel le directeur du CES avait beaucoup fait pour qu'il vienne à Paris exposer ses projets dans une série de séminaires auxquels assistait mon condisciple Raymond Boudon qui revenait de l'université Columbia où il avait été son étudiant. Lazarsfeld voulait faire un séminaire de méthodologie générale qui lui permette de préparer une version française de son livre 'The language of social research. A reader in the methodology of social research' (Glencoe, The Free Press, 1955) alimentée par des contributions de chercheurs après discussions publiques. Mais ce séminaire n'a pas aussi bien marché qu'il l'aurait souhaité. Chez nous, les chercheurs et les professeurs ont eu une très forte résistance à voir leurs textes discutés en public. Finalement il a préparé avec Boudon une édition française de ce qui est devenu le vocabulaire des sciences sociales, l'analyse de la causalité et des processus sociaux (trois volumes publiés chez Mouton). Quand une communauté est très petite, il est difficile de s'exposer à des critiques réciproques s'il n'y a pas une sorte d'éthique professionnelle forte comme c'est le cas dans les prépas aux grandes Ecoles. L'autre séminaire de recherche était consacré à l'histoire des sciences sociales en Europe et aux Etats-Unis. Là, il s'agissait moins de discuter de sociologie théorique que des pratiques sociologiques. Axé sur la méthodologie, il a attiré le plus de monde parce qu'il était dans le vent et qu'on avait besoin d'une culture absente dans l'enseignement de la sociologie. Ni Gurvitch, ni Aron n'étaient attentifs à ces questions. Seuls les psychologues faisaient un enseignement de méthodologie, mais celle-ci n'était pas adaptée aux questions sociologiques. En effet, le contrôle de données, d'expérimentation, ne sont pas toujours pertinentes en sociologie. Donc, le séminaire historique de Lazarsfeld n'a pas eu le succès de foule escompté, mais j'ai trouvé qu'il convenait mieux à ma formation et à ma façon de travailler que le projet sur les étudiants que j'avais déposé pour ma candidature au CNRS. Je ne niais pas pas son intérêt, mais il me paraissait trop vaste pour être maitrisable.
En 1962-63, comme chargé de conférences aux Hautes Etudes, j'ai donc continué à animer un séminaire sur l'histoire des recherches empiriques et en 1964, avec son accord, j'ai quitté son labo où je ne voyais pas bien comment mettre en applications ses théories ésotériques. Comme j'avais en poche une invitation pour aller à New York chez Lazarsfeld, j'ai demandé mon rattachement au CES et je suis parti à Columbia. Là, j'ai eu deux activités différentes. Comme j'avais raté une attribution de bourse et qu'il fallait que je vive, j'ai accepté des charges d'enseignement, ce qui s'est avéré extrêmement positif. Les boursiers sont un petit peu flottants dans une société étrangère, même très ouverte comme la société américaine où il vaut mieux avoir une fonction précise. J'ai fait deux années d'enseignement, l'un d'introduction à la sociologie pour des étudiants d'âge avancé, la 'School of General Studies', qui avaient un travail salarié et qui ne pouvaient étudier qu'à temps partiel. On leur enseignait évidemment la sociologie américaine et cela m'a permis de la connaitre. Il n'y avait pas de cours magistral, on leur assignait seulement un certain nombre de lectures. Il fallait préparer avant chaque semestre la liste des textes, les distribuer semaine par semaine, bien spécifier ce qu'ils devaient lire. Pour les Américains, l'enseignement universitaire est un contrat. Comme les étudiants ont payé des droits de scolarité élevés, ils sont en droit d'attendre la meilleure qualité et la plus grande précision dans l'enseignement qu'ils reçoivent. Il fallait donc lire aussi soi-même ce sur quoi on était supposé les interroger. Il y avait donc facilement 150 à 200 pages à avaler par semaine. J'avais à peu près une demi-journée d'avance sur eux et cela m'a permis d'avaler une littérature considérable. En plus, ça m'a donné une solide pratique de l'anglais car les étudiants américains posent des questions tout le temps, ils interrompent leur prof sans arrêt, c'est tout à fait comme les classes de prépas, mais pas du tout comme les amphis universitaires que j'avais connus.
Au département graduate de l'université, j'étais aussi chargé d'organiser un séminaire de recherche commun avec Robert K. Merton et Paul Lazarsfeld. Il portait sur les problèmes d'histoire des sciences sociales aux Etats-Unis et en Europe. Pour Lazarsfeld qui était de formation germanique, Columbia était d'ailleurs la plus européenne des universités américaines, la sociologie a des racines extérieurs, autrement dit ses précurseurs. Merton lui était davantage préoccupé par la défense et illustration de la sociologie stricto sensu et le débat était constant entre eux pour savoir s'il valait la peine de parler des origines de la sociologie ou pas. Moyennant quoi, l'organisation des séminaires n'était pas toujours facile entre ces deux personnalités très marquées, opposées sur les finalités. Merton craignait que l'on ne dilue la sociologie dans la démographie ou d'autres sujets qui lui paraissaient un peu suspects, alors que Lazarsfeld voulait l'ancrer dans son passé culturel, les deux approches n'étant d'ailleurs pas contradictoires. La division du savoir a évolué selon les époques, ce que l'on désigne aujourd'hui sous le terme de sociologie n'a rien à voir avec ce que l'on qualifiait ainsi sous Auguste Comte. Ce séminaire a eu des résultats intéressants si l'on considère la qualité des contributions, mais il n'a pas attiré autant de monde car il ne débouchait pas sur des applications directes. Mais les universités américaines de très haut niveau ne s'arrêtent pas à cet aspect quantitatif. Si le sujet est valable en lui-même, il y a un dicton qui dit : "tant que ça n'intéresse même qu'un seul étudiant, il faut maintenir l'enseignement". Comme les universités américaines organisent leur enseignement huit à dix mois à l'avance et comme le CNRS mettait du temps à répondre pour renouveler mon détachement, j'ai prolongé mon séjour une deuxième année. On m'a donc transféré de la 'School of General Studies' (SGS) au Columbia College qui est l'équivalent d'une classe de préparation, d'une khâgne de très haut niveau. On y enseignait un sujet qui s'appelait 'civilisation contemporaine', une sorte d'histoire sociale au sens large. Ca m'apprenait moins de choses que lors de ma première année, mais c'était plus facile car cela portait sur des auteurs classiques que je connaissais mieux, Condorcet, Comte et évidemment Marx. Karl Marx avait d'ailleurs une grande place dans l'enseignement du Columbia College, à la fois l'héritage de C. Wright Mills, mort peu auparavant, et de Daniel Bell qui avait pris la suite comme chairman du département de sociologie. Mais il y avait une forte tension entre le département de sociologie où les études doctorales étaient dominées par Merton et le fonctionnalisme et le College davantage inscrit dans une tradition marxisante qui mettait l'accent sur l'histoire des conflits sociaux. Au College, les étudiants étaient plus agressifs, mais plus conventionnels que les salariés que j'avais eu auparavant à l'université et j'avais préféré le premier auditoire plus frais, plus spontané.
Je suis revenu à Paris au CES en septembre 1966 dans des circonstances un peu difficiles. Un certain nombre de ténors étaient étaient partis. Robert Pagès, un des pionniers fondateurs du CES l'avait quitté pour le Laboratoire de de psychologie sociale, Henri Lefebvre qui faisait parti du groupe de Gurvitch sur la sociologie de la connaissance et de la vie morale était parti à Strasbourg. Touraine venait de fonder le laboratoire de sociologie industrielle rue Monsieur le Prince, J-D Reynaud était à l'Institut des sciences sociales du travail et Michel Crozier venait de fonder le 'Centre de sociologie des organisations' (CSO) au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Fernand Braudel avait vu le vivier que représentait le CES et il les avait réorienté vers la VIème section de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) afin d'apporter à sa dimension historique une ouverture vers la sociologie. Friedmann a également joué un rôle dans cette affaire puisque Touraine et Crozier gravitaient autour de son séminaire. Tous ont formé leurs équipes autour d'une forte spécification, des équipes fortement intégrées dans le domaine des organisations comme chez Crozier ou de la pensée sociologique chez Touraine. Ils estimaient que le CES pâtissait d'un niveau de réflexion théorique insuffisant et qu'en plus ce labo était de trop grosse taille, victîme d'une politique de recrutement incohérente. De fait, les équipes qui quitté le Centre ont également connu des crises, le laboratoire de Touraine à l'EHESS et celui de Crozier au CNAM n'ont pas connu d'évolution paisible. Ils ont beaucoup misé sur l'intégration soit thématique, soit théorique, mais cela a posé autant de problèmes que la non intégration.
De fait, il n'y avait pas d'équipe constituée au CES, à l'exception du groupe de sociologie des religions, de celui de sociologie rurale d'Henri Mendras (qui avait décidé de rester rue Cardinet, mais je pense qu'il postulait implicitement pour la direction du CES) et celui de sociologie de l'éducation de François Isambert qui avait une certaine consistance. En dehors de ça, il n'y avait que des individus ou des petits paquets d'individus. Le groupe de sociologie des religions n'était d'ailleurs qu'une collection d'individualités. Il n'y avait guère que le groupe de sociologie rurale à avoir une certaine consistance. Il y avait eu un groupe de sociologie du travail, mais Friedmann était parti à l'EHESS. Quant à Pierre Naville, il avait théoriquement un groupe de sociologie de l'automation, mais qui ne fonctionnait pas réellement comme groupe. Au CES, on prenait des gens qui paraissaient intéressants, mais ça tirait un peu dans tous les sens. Cela pouvait être utile dans certains cas, pour moi par exemple où ça a été une plate-forme assez commode, mais c'était plus un conglomérat que quelque chose de vraiment constitué. Peut-être aussi avait-on déjà dépassé le seuil numérique raisonnable. Au delà de trente et même de vingt personnes, ça commence à devenir trop gros (quand ma femme est arrivée au CES dans les années 1950, Maximilien Sorre professeur à la Sorbonne en était directeur. C'était une petite famille, tout le monde se connaissait et ça fonctionnait assez bien). Pourtant, quand je suis arrivé au CES, j'avais constaté qu'il y avait des séminaires internes du plus grand intérêt dirigés par Edgar Morin ou François Isambert par exemple qui portaient sur des problèmes de méthodologie. Il y avait une activité intellectuelle incontestable, mais bizarrement elle n'a pas fait souche. Cela tient peut être à la personnalité énigmatique de Stoetzel et de ses trois chapeaux, titulaire de la chaire de psychologie sociale à la Sorbonne, directeur du CES et enfin directeur de l'IFOP. Mais il n'a jamais établi de lien entre son enseignement à la Sorbonne et le CES. Cela tient peut être à une ambigüité entre son image de marque et les chercheurs du CNRS qui le taxaient d'une épouvantable réputation d'homme d'affaires. Il y a eu des frictions. Il avait le souci de faire connaitre son laboratoire à des membres du gouvernement Debré, il avait invité Pierre Guillaumat, le ministre de la Recherche, à visiter le CES. Comme on était en pleine campagne de la gauche contre le programme atomique du Général, les chercheurs s'étaient mis en grève sans le prévenir. Je pense que ça a dû le marquer et qu'il en est venu à considérer que sa direction était assez nominale. C'était un libéral, à la limite peut-être trop, et il n'interférait pas exagérément dans le fonctionnement de l'organisme.
Le point commun dans toute cette sociologie des années soixante, c'est la mise en cause appuyée de la vulgate marxiste. Pas de la pensée marxiste, mais de la vulgate telle que véhiculée par le PCF et ses compagnons de route. Crozier par exemple avec l'importance du phénomène des organisations qui n'a rien à voir avec la lutte des classes, un thème sécant. Touraine avec sa réflexion sur la conscience ouvrière et le mouvement ouvrier remettait vivement en cause le schéma classique, puisque appréhender le mouvement paysan dans une structure de classe sociale est un casse-tête considérable. Quant à Aron avec son Centre de sociologie européenne, il mettait l'accent sur la spécificité de la pensée politique, Tocqueville notamment, vis-à-vis du concept de luttes de classes. Edgar Morin, lui était très lié à Friedmann, un ancien stalinien qui avait rejeté ses précédentes croyances et était de ce fait honni de l'intelligentsia communiste. D'ailleurs, dans la mesure où la mouvance communiste présentait la sociologie comme une invention américaine, il n'y avait pas nécessairement contradiction. Je me souviens des problèmes soulevés par le congrès mondial de sociologie organisé à Washington en 1962. Pour entrer aux Etats-Unis, il fallait déclarer qu'on n'était pas membre d'une organisation communiste. En France, certains sociologues qui avaient fait des voyages ou des stages aux Etats-Unis se sont vus exclus d'un syndicat de chercheurs ou d'une section de le FEN (Fédération de l'Education nationale) ou du SNES (Syndicat national de l'enseignement supérieur). D'ailleurs, on peut noter que l'ouverture à la sociologie américaine dans les années soixante s'est faite davantage sur le plan des méthodes que sur celui des théories ou des modes de raisonnement. Crozier a peut-être été le seul qui ait importé des modes de pensée américains ici pour saisir le phénomène organisationnel. Pour les autres, on pouvait très bien faire cohabiter avec un anti-américanisme de principe contre des théories du style fonctionnalisme qu'on accusait de conservatisme, tout en montrant un intérêt très vif pour les méthodes d'enquête. Il n'y avait pas de contradiction. Il y a même un triple aspect dans le cas de Touraine qui lui n'était pas du tout méthodologue, mais qui afin d'expier ses péchés passés a développé les enseignements de méthodologie. Il sentait que lui-même en avait besoin et qu'il était nécessaire que les autres ou ses successeurs en bénéficient, tout en restant par ailleurs très réservé ou même opposé à certains aspects dominants de la théorie sociale américaine. Notamment Talcott Parsons avec lequel il avait l'ambition de rivaliser sur le plan théorique, en fait il estimait que Parsons généralisait indument l'aspect relationnel et fonctionnel de la société en ne mettant pas suffisamment l'accent sur l'étage supérieur, c'est-à-dire sur l'action volontaire, sur les valeurs de l'action collective.
Pour en revenir au CES, dans les années 1967-68 l'organisme portait son âge, mais il n'était pas dépourvu d'intérêt et on y faisait des choses valables. Mais il avait ce double handicap de la taille d'abord et d'une localisation excentrée pas optimale. Le lieu avait été choisi parce qu'il n'était pas très loin de l'IFOP et que c'était commode pour sa direction. Mais il n'y avait pas beaucoup d'étudiants et il y avait aussi un trop grand éclatement des thèmes et des sujets. Dans les années cinquante où l'université officielle et surtout les sections de philosophie qui demeuraient adeptes d'un idéalisme assez exsangue refusaient le marxisme, beaucoup de collègues qui avaient la cinquantaine au début des années soixante et étaient marxistes n'avaient trouvé d'issue qu'au CNRS. Mais par un effet de ricochet, il se produisait alors une certaine pesanteur de la vulgate marxiste contre laquelle la nouvelle génération, les Touraine, Crozier, etc. se révoltait, d'où une forme d'intolérance réciproque. Et puis, il y avait un problème de locaux. A New York, bien que logé petitement, le laboratoire de sociologie était un véritable lieu de vie où les gens venaient, comme ici (à la Maison des Sciences de l'Homme) où la plupart des gens passent un temps respectable ou appréciable de leurs journées. Au CES rue Pouchet, pour des raisons d'espace, d'encombrement, ce n'était pas possible. On était obligé de se partager les bureaux ce qui est la meilleure manière de ne jamais se rencontrer. On vient quand les autres ne sont pas là ! Il ne pouvait pas y avoir ces séminaires hebdomadaires ou bihebdomadaires que j'avais vus à Columbia où chacun à tour de rôle exposait ce qu'il était en train de faire et où tout le monde en discutait qu'il soit de la partie ou non.
La fragilité de l'institution s'est révélée en 1968, mais j'y étais présent et je dirais qu'il ne faut pas exagérer l'ampleur de la crise. Comme le CES était 'Le' laboratoire de sociologie du CNRS, il était dans le collimateur des autres directions scientifiques. La crise a été brève, mais elle a révélé un malaise latent. En gros, il n'y a eu cessation des travaux de recherche ou de rédaction de la mi-avril à la mi-juin, deux mois seulement. A l'Université, ça a été plus long, aux Hautes Etudes aussi. La rentrée s'est faite au CES en septembre tant bien que mal, mais elle s'est faite. Dans les universités ça a été bien pire. En fait, je n'avais aucune sympathie pour le mouvement des étudiants de Nanterre, Cohn-Bendit ou pas, d'autant que j'aimais bien les enseignants qui y étaient nommés, Touraine, Crozier, etc. Ses étudiants avaient la chance d'avoir des enseignants de premier ordre et ils allaient mettre en danger le progrès acquis en sciences sociales. Pour moi, 68 est une régression; ce n'est pas une révolution culturelle, c'est une régression culturelle... Revenant des Etats-Unis j'avais internalisé, intériorisé devrais-je dire, cette éthique de la professionnalisation des sciences sociales juste au moment précis où elle commençait à être remise en cause à Berkeley. Mais c'était de l'autre coté du continent (sur la côte Ouest). Jean-Pierre Worms qui y était l'a vécu. Mais à Columbia, on en restait sur l'éthique des années 1950-60, c'est-à-dire des sciences sociales qui doivent prendre modèle sur les sciences naturelles. Elles peuvent avoir une capacité d'explication aussi puissante à condition de respecter certains impératifs méthodologiques, théoriques et organisationnels, voire de discipline personnelle. Pour moi le mouvement des étudiants, la critique de la société de consommation, n'avait aucun sens. D'ailleurs le niveau de consommation en France n'était pas si élevé que ça à l'époque. Ces thèmes étaient complètement importés de la gauche allemande et, à mon sens, n'avaient aucun rapport avec la situation réelle de notre pays. C'est pour cela que le mouvement a capoté. Il n'était pas en prise avec les forces sociales profondes, trop loin en avant aurait dit Lénine, ou à coté de la réalité.
Ce qui a eu un rôle important dans la crise du CES en 68 (et ça personne ne l'a dit), c'est un lien étroit avec Nanterre par le biais d'un nombre important de vacataires et de contractuels embauchés par le groupe de sociologie rurale de Mendras. C'est eux qui nous ont amené la pensée situationniste diffusée sur le campus nanterrois, moins en tout cas que les étudiants ou les assistants qui étaient groupés autour de Lefebvre. Ce groupe a joué un rôle par le biais de ces jeunes gens parmi lesquels Carnoux, mais Mendras lui-même s'intéressait davantage aux discussions qui avaient lieu à la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) où il était professeur et on ne l'a guère vu au CES. Les interruptions de cours qui avaient lieu soit chez Touraine ou chez Crozier étaient généralement le fait des assistants de Lefebvre. Pour moi, ce type de pensée reste du chinois. L'autre point à rappeler est le rôle de Pierre Naville qui avait été nommé directeur adjoint du CES par Stoetzel l'année précédente et cela sur des critères de pure forme. Il était le chercheur le plus éminent et le plus ancien. A dire vrai autant ses talents d'écrivain sont éclatants, autant ses capacités d'organisateur étaient loin d'être évidentes. C'est une personnalité tout à fait fascinante, il a une culture considérable, simplement il est très impérieux de caractère et il est assez difficile d'arriver à se faire écouter de lui. C'est un esprit indépendant, très créatif, plus qu'un leader et il avait beaucoup de problèmes avec les chercheurs. Il n'est pas impossible aussi qu'il ait essayé de devenir directeur du CES. La semaine où Daniel Cohn-Bendit et ses camarades ont été transféré de Nanterre à la Sorbonne pour le fameux jury d'honneur qui devait les juger était un jeudi. C'est le jour où les premiers incidents ont éclatés au Quartier Latin. On m'avait proposé de signer une pétition de soutien au mouvement étudiant. J'avais refusé, pour moi c'était un mouvement insurrectionnel. Le lundi suivant le CES était fermé avec un avis affiché sur la porte, 'le CES est en grève, signé Pierre Naville'. Ont suivi des assemblées générales auxquelles je ne participais pas, du moins au début. Stoetzel a sollicité un congé de maladie et a quitté ses fonctions. Naville participait à ces assemblées générales. J'ai reçu un coup de fil de la bibliothécaire, Lucienne Thomas, que je connaissais bien parce que j'étais rédacteur en chef adjoint de la 'Revue Française de Sociologie' (RFS) publiée par le CES. Il fallait absolument que je vienne, on votait en assemblée des motions demandant l'autonomie à l'égard du CNRS...! Je suis donc venu participer à ces assemblées générales qui étaient à peu près quotidiennes. En fin de compte, on a perdu énormément de temps et au bout de deux mois on n'avait guère ramené les choses dans ce que j'appellerais des voies plus sensées. D'un autre côté, des questions parfaitement légitimes étaient posées et c'est vrai que ces AG ont joué un certain rôle de communication qui manquait auparavant. Mais on y débitait aussi beaucoup d'absurdités.
Mon rôle consistait à rappeler un certain nombre d'évidences ou d'exigences concernant l'insertion de la recherche dans une société démocratique. Je me souviens d'avoir fait des topos sur les mécanismes de planification de la recherche (quelles priorités? Qui décidait quoi?) à destination de jeunes chercheurs qui n'en avaient pas la moindre idée. On leur aurait fait quelques stages de formation là-dessus, cela aurait évité bien des illusions. L'un des débats était de savoir si le CES pouvait continuer tel qu'il était? J'ai essayé de proposer un modèle de laboratoire plus cohérent en le dotant d'un conseil scientifique. Avant 1967, même dans le cas des laboratoires propres du CNRS, il n'y avait pas d'instances de consultation obligatoire. C'était une décision du directeur général qui les a créées et on appelait ça le 'conseil de la couronne'. Mais n'y venaient que les gens qui acceptaient d'être nommés. J'avais donc fait le plan d'une sorte de laboratoire, cohérent dans ses orientations, avec un comité de gestion quotidienne et un conseil scientifique qui pourrait recenser les offres de programmes, de contrats, guider les chefs d'équipe qui le souhaiteraient, les coordonner, harmoniser les propositions, etc. Je me suis toujours intéressé aux formes d'organisation de la recherche. D'ailleurs le directeur des SHS, Pierre Bauchet m'avait demandé de faire un questionnaire pour un des groupes de la section du VIème Plan qu'il dirigeait concernant la recherche. Un autre modèle avait été proposé par les gens d'extrême gauche, curieusement très 'américain', aboutissant à diminuer le rôle du laboratoire pour le transformer en lieu d'accueil, avec un directeur quand même parce qu'il faut bien représenter le labo à l'extérieur, mais fonctionnant avec des équipes autonomes dans leur financement.
Il y a eu aussi des choses délirantes à propos de la 'Revue Française de Sociologie'. Le statut de la revue était un peu ambigu puisqu'elle avait été créée en 1960 par Stoetzel pour stimuler les chercheurs du CES et offrir un débouché à leurs écrits. C'était un peu comme le rapport de 'Population' avec l'INED ou celui de 'La Revue Française de Sciences Politiques' (RFSP) pour les différents groupes de la rue Saint Guillaume. Ce rapport était moins étroit parce que 'Population' et la 'RFSP' ont réussi à obtenir de la part des chercheurs hébergés ou concernés la fourniture d'un minimum de compte rendus d'ouvrages et de notices signalétiques, ce que l'on n'a pas réussi à obtenir des chercheurs du CES. Il y avait une tension permanente qui consistait à renverser les termes du jeu autour de l'argument "étant chercheur au CES, j'ai le droit d'être publié dans la RFS", ce qui revenait à court-circuiter les fonctions du comité de rédaction. Or, ce n'est pas l'auteur qui a le droit d'être publié, c'est le lecteur abonné qui a le droit d'attendre la meilleure qualité possible de sa revue. Si on peut publier les collègues, tant mieux, sinon tant pis! Je me souviens d'une assemblée générale où un ordre du jour impromptu avait posé la question des rapports de la Revue et du CES, avec cette motion merveilleuse selon laquelle "l'on ne devrait publier qu'au service du peuple". Le peuple ne se définissant pas lui-même, mais par ceux qui prétendent parler en son nom. J'avais dit qu'il était impossible de discuter de cette formule et on l'a modifiée, en mettant revue publiée 'avec le concours' et non plus 'par' le CES afin de couper court à toute ambigüité. Puis on a resserré le comité de rédaction et diversifié l'origine des manuscrits. Il ne s'agissait pas d'exclure les collègues du CES, mais d'avoir une plus grande quantité de choix.
Au cours de cette période, il y a eu une sorte de lutte pied à pied pour rétablir ce que je considérais comme les garanties minimales de la démocratie formelle. Par exemple, si une seule personne dans l'assemblée demande un vote à bulletin secret, on doit y faire droit. Du jour où on a obtenu ça, tout a changé dans la physionomie des débats. Finalement, je pense que la crise du CES n'a pas été aussi dramatique que cela. Bien des centres de l'EHESS ont été en crise aussi longtemps et même davantage. J'ajouterais que son appartenance au CNRS a peut-être ramené les chercheurs au sens des réalités. Le SNCS et d'autres syndicats ont organisé une consultation sur la prolongation de la grève vers la fin du mois de juin au moment où ça s'essoufflait et la réponse s'est révélée être à 95% contre sa prolongation. L'exemple est venu des laboratoires de sciences exactes et surtout biologiques où il y a des contraintes que les sciences sociales ignorent, les animaleries, les manips en cours, etc... A l'époque, je mettais sur pied une recherche sur les laboratoires de sciences exactes pour la Direction générale du CNRS, donc je connaissais un peu ces problèmes. Je me rappelle la stupéfaction de collègues, des gens qui faisaient de la sociologie d'enquête sans ordinateur (des machines que l'on ne peut laisser sans surveillance, ne serait ce que pour leur réfrigération) en découvrant les contraintes qui pesaient sur les sciences naturelles. Il est vrai que les jeunes sociologues avaient suivi une formation purement sociologique et je retrouvais donc mes impressions initiales contre la sociologie conçue comme discipline formatrice. A mon avis, ces jeunes vivaient dans l'empyrée, aveugles aux contraintes de la réalité, du financement et même de leur propre existence. Leur salaire dépend du produit intérieur brut, ils ne sont pas directement producteurs de richesse. En revanche, ils avaient remarquablement assimilé ce qu'on avait pu leur apprendre dans le domaine de la conduite des organisations et en matière de comportements collectifs. Ils avaient une science des assemblées tout à fait remarquable. C'étaient des jeunes gens très brillants, astucieux, mais déconnectés de la réalité. Le mouvement a d'ailleurs fini par se heurter à certaines résistances. En février 1970, lorsque la 'Société française de sociologie' a tenu une réunion au Musée des arts et traditions populaires sur le thème de l'intervention sociologique, un certain nombre de jeunes sociologues, assistants, maitres assistants ou étudiants de Nanterre sont venus l'interrompre. C'est vrai, le terme choisi n'était pas très bon, l'intervention des sociologues, ça fait manipulatoire. Il y avait même des gens des Hautes Etudes venus avec leurs gosses, un orchestre pop était venu dans la salle de réunion pour empêcher les gens de parler, certains chercheurs prévus comme orateurs sont devenus contestataires de leur propre prestation. Mais lorsqu'ils ont commencé à s'en prendre au matériel de la cantine, immédiatement le personnel d'entretien est intervenu. A partir de là, ça s'est réglé de façon rapide. Quelques chercheurs ont provoqué une AG à laquelle s'est rendu le tout nouveau conservateur du musée, Jean Cusenier. Il a déclaré que la manifestation n'était pas régulière et il a appelé tous ceux qui désapprouvaient cette action à sortir avec lui. Tout le corps des ouvriers d'Etat a suivi d'un bloc. Ces derniers sont des gens très fiers de ce qu'ils sont, de leurs traditions. Evidemment, le prolétariat, vu sous cet angle, c'est un peu déconcertant. Là aussi, c'était un retour à la réalité pour certains sociologues de fraiche date.
Après 1968 au CES, il y a eu la période de la direction de Raymond Boudon, jusqu'au début des années 1970. Voyant comment ça tournait, je n'étais pas sûr qu'il resterait et j'avais pris des contacts avec Crozier pour venir chez lui. Mais je connaissais Boudon de longue date puisqu'on avait été à l'ENS presque en même temps et j'ai pensé que s'il venait il valait mieux que je reste. Durant cette époque, je me suis surtout occupé de la 'Revue Française de Sociologie' en collaboration avec J-D Reynaud, F. Isambert et Jean-Claude Chamboredon. On a constitué une sorte de petite cellule d'orientation. J'ai publié notamment un numéro spécial en 1970-71 sur l'analyse des systèmes en sciences sociales assez souvent cité et qui a été réédité. En même temps, je me suis occupé avec Gérard Lemaine d'une action spécifique sur les modes d'organisation et de succès des laboratoires de recherche fondamentale. Le directeur des SHS, Bauchet, avait émis l'idée de s'intéresser à l'organisation de la recherche. En fait l'idée avait été lancée en 1967 dans la perspective du lancement du VIème Plan, mais les crédits avaient été gelés à la suite des évènements. Dans l'esprit de la direction des SHS, je pense qu'il s'agissait d'une sorte de mise à l'épreuve de l'organisme, voir si le CNRS était capable de répondre à une demande de sa direction générale. Il s'était adressé à Madame Isambert qu'il connaissait de longue date (il est bien possible qu'ils aient fait de la Résistance ensemble), tous deux venant du mouvement chrétien. Bauchet c'était un peu la partie du MRP devenue gaulliste, Madame Isambert étant plus nettement PSU, mais ils continuaient de se rencontrer. Finalement ce projet a été répercuté vers Lemaine qui travaillait déjà sur ce thème chez Pagès. Bien sur, j'étais intéressé. Cette action spécifique a donné lieu à l'installation du 'Groupe d'études et de recherches sur la science' devenu une unité associée sous la direction de Lemaine et a produit un rapport intitulé 'Les voies du succès'.
En 1971, Boudon voulait constituer en groupe chargé d'étudier les méthodes d'analyses sociologiques. Le projet était d'installer un centre d'analyse secondaire des enquêtes, à la fois banque de données et service d'analyse. Il s'agissait de procéder par trocs puisqu'on n'avait pas de crédit pour acheter des enquêtes réalisées en Europe ou aux Etats-Unis. Il s'agissait d'échanger des bases de données informatisées d'enquêtes françaises contre des données américaines ou étrangères que les chercheurs auraient pu exploiter plus à fond. Mais l'affaire s'est heurtée à certaines difficultés. Notamment au fait que les enquêtes françaises n'étaient pas faites de façon suffisamment rigoureuse pour supporter leur stockage, du moins sans un gros travail de mise en forme. En fait, il s'est produit le même phénomène que pour le séminaire de Lazarsfeld, les gens résistaient à exhiber le produit de leur recherche. C'est dommage, le CES disposait à l'époque de mathématiciens très astucieux (A. Degenne, R. Bassoul) capables de traiter ces données (Flavigny) et il était en contact avec le CIRCE, le centre de calcul du CNRS qui venait d'être créé. Mais les informaticiens capables de dialoguer avec les chercheurs lambda en SHS manquaient cruellement. Les organismes de sondage avaient ces gens là, mais pas la recherche publique. D'autre part, il existait des objections à ce type d'opérations. On peut estimer que les données ne sont pas vraiment neutres, puisqu'elles ont été collectées dans une perspective théorique donnée et qu'une illusion méthodologique veut croire qu'on puisse les reprendre pour les traiter dans une perspective différente. C'est vrai qu'il y avait une philosophie un peu néo-positiviste dans cette affaire. On y voyait un moyen d'obtenir plus rapidement des données d'enquêtes qu'en fabriquant au coup par coup des enquêtes qui ne circulent pas. Il s'agissait de donner au CES une fonction de services, mais cela n'a pas marché. En définitive, Boudon a quitté la direction du Centre pour installer le GEMASS à Paris IV comme unité de recherche associée. Après le départ de Boudon le CES n'a plus eu de directeur pendant quelque temps jusqu'à l'arrivée de Renaud Sainsaulieu. Je le rencontrais régulièrement à un comité de recherches sociales d'Elf-Aquitaine où son directeur de l'innovation (De La Palme) avait le projet de développer les recherches sociales au sein de l'entreprise. Il m'avait parlé de ses efforts pour trouver d'autres locaux que ceux de la rue Cardinet. Il me semble qu'il a voulu faire une direction très active du CES. Mais finalement lui non plus n'a pas réussi à provoquer un sursaut suffisant et il a jeté l'éponge estimant que l'expérience était trop couteuse.
Pour expliquer l'échec du CES, je pense qu'il tient essentiellement à sa politique de recrutement. Dans les études que nous avons faites avec Lemaine on s'était aperçu que ce qui était capital dans la constitution d'un groupe de recherche était de recruter des chercheurs de façon cohérente. C'est ce que Lautman souligne dans son article de 'Commentaire', lorsqu'il évoque les difficultés provoquées l'intégration des hors-statuts dans les années 1970. Cette vague d'intégration avait été décidée par les politiques afin de préserver la paix sociale sur le dos des organismes de recherche. Mais personne n'avait pensé que le CNRS serait le seul organisme à supporter tout le poids de cette mesure. Pour former des équipes de recherche, la question de taille est très importante. C'est vrai même dans les sciences exactes. Dans les sciences biologiques par exemple, ils ont de toutes petites équipes de trois quatre personnes qui ne durent que deux ans deux ans et demi. Ensuite, ils changent de sujet et se redéployent en fonction de nouveaux sujets. De même, il y a des équipes de physique instrumentale très légère de cinq à six personnes, notamment à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles. Ces petites équipes passent autant de temps à chercher ce qu'ils vont faire qu'à faire quelque chose. Il faut dépouiller beaucoup de littérature et ce qui est payant dès que l'on a écrémé l'essentiel, est de ne pas trainer sur un sujet et de passer à autre chose. Mais dans les sections ou les comités du Conseil supérieur des universités, voire dans les instances d'évaluation du CNRS, on apprécie que les gens et même les sujets s'inscrivent dans une spécialité reconnue et que l'on sache où sont les gens, voire qu'ils n'en changent pas trop.