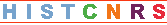En cas d'usage de ces textes en vue de citations,
merci de bien vouloir mentionner leur source (site histcnrs), ses auteurs et leurs dates de réalisation
Entretien avec Michèle Ferrand
J-F Picard, texte revu et amendé par M. F., 20 juin 2019 (source : https://www.histcnrs.fr/temoignages.html)

DR
Pourrais-tu commencer par rappeler ton cursus universitaire?
J'étais en deuxième année d'économie à la fac de Nanterre en 1968 après avoir raté une fois une année à cause de la naissance de ma première fille. On peut dire que les événements de 1968 ont non seulement changé la fac de Nanterre, mais qu'ils ont tout simplement changé la vie, du moins ma vie ! Jusque-là je ne me voyais pas beaucoup d'avenir dans mes études et ces événements m'ont ouvert des perspectives extraordinaires. J'ai changé de filière. En dernière année d'économie, j'ai fait deux UV de sociologie, ce qui m’a permis de découvrir que cette discipline était autrement plus intéressante que l'économie. Je suivais aussi le cours d'anthropologie économique d'Eugène Enriquez et les deux cours de socio, dont l'un de sociologie rurale, passionnant, avec Marcel Jollivet. J'ai alors profité d'une équivalence pour m'inscrire en licence de sociologie, tout en préparant un D.E.S. en économie de la santé. On était en 1971, au début du mouvement féministe et j'ai proposé un sujet de mémoire sur l'avortement dans une démarche plus ou moins militante. Mais pour faire accepter ce sujet, j'ai proposé une approche RCB (rationalisation des choix budgétaires) sur le bilan coût-avantage de la contraception pour laquelle j'ai obtenu une bourse du ministère des Finances. J'ai pu montrer qu'il y avait tout bénéfice à libéraliser complètement la contraception et, pourquoi pas, autoriser l'avortement ! Cela en minorait les coûts pour la société, les avortements clandestins lui coutant très cher en termes de morbidité voire de mortalité.
C'étaient les débuts d'une discipline nouvelle, l'économie de la santé
A Nanterre, avec ma copine Martine Bungener, nous avons préparé notre
mémoire de D.E.S dans cette spécialité. Elle bossait avec Emile
Lévy, notre prof. d'économie de la santé qui recrutait des
jeunes chercheurs pour son 'Centre de recherche en économie sociale',
le futur LEGOS (Laboratoire d’Economie et de Gestion des organismes de
Santé). Lévy était un type fantastique. Pour nous aider, il nous
donnait des opportunités de petits boulots. C'est ainsi qu'avec
Martine et quelques autres (dont Dominique Strauss-Kahn !), nous avons
été chargées des travaux dirigés d'économie à l'Ecole Centrale où il
assurait le cours magistral, un boulot pas terrible, mais royalement
payé. Le LEGOS s'est installé à Dauphine en 1973, l'année où Lévy a
obtenu une ATP sur 'une comparaison entre l’hospitalisation publique et
l’hospitalisation privée' sur laquelle il m’a embauchée pour deux ans
comme chercheuse contractuelle, j’y ai rencontré Anne-Marie Devreux
avec laquelle nous avons inauguré un binôme qui a duré de nombreuses
années. On a fait plusieurs semaines d'enquêtes en province et à Paris
et j'ai beaucoup appris sur le tas. La recherche était menée de façon
très collective, on était huit ou neuf, des économistes, des
sociologues, des médecins épidémiologistes. Ça a été ma première
confrontation avec le traitement informatique. Quand ce contrat est
arrivé à terme en 1975, on a décidé, avec Anne-Marie et Chantal
Lafarge, une autre sociologue de l’équipe, de répondre à un appel
d'offre de la DGRST en proposant une recherche sur l'avortement, avec
la bénédiction d’Emile Lévy qui nous laissait carte blanche. Il
s'agissait d'évaluer les effets de la loi Veil qui venait d'être
adoptée. Nous ne doutions pas de l’intérêt de notre proposition
et d’ailleurs, nous avons obtenu notre financement pour deux ans,
renforçant notre position de chercheuses contractuelles.
Comment as-tu été recrutée au CNRS?
En 1977, j'ai proposé au CNRS le plan de mon projet de thèse sur la
médicalisation de la procréation sous la direction d’Emile Lévy.
L'optique était très foucaldienne, la médicalisation du corps des
femmes, le contrôle social, etc. Mon dossier n'a même pas été pris en
considération ! Le rapporteur qui était un économiste
syndicaliste du SNCS (François Germe) m'a rencontrée et expliqué en
quoi consistait un projet CNRS. Il fallait prévoir une enquête de
terrain sur plusieurs années, une problématique, faire une
bibliographie et surtout présenter ses publications. Or, le problème
est que je n'en avais pas. Au LEGOS, les chercheurs ne faisaient pas
d'articles, éventuellement ils participaient à la publication de
livres, comme 'Le coût de la santé' et d'autres chez Dunod (puis
Economica), mais Lévy ne nous poussait pas à faire des articles. Ni
Gérard Duménil, ni Francis Fagnani qui étaient des chercheurs déjà
confirmés ne publiaient d'articles à l'époque. On rédigeait un rapport
de fin de contrat, on rendait sa copie et c'était tout. Ces rapports,
donnaient lieu à ce que l'on appelle de la 'littérature grise',
c'est-à-dire des publications relativement diffusées dans les
administrations concernées. Nous étions alors invités à les présenter
dans différents endroits, à l'Inserm chez Claude Rumeau-Rouquette par
exemple, en province, dans différents colloques etc. J'ai donc remanié
mon projet pour en faire une sorte d'article que j'ai envoyé à la
'Revue Française de Sociologie' où l'on m'a d'ailleurs répondu qu'il
était impubliable, mais qu'il y avait matière à faire. Mon copain
syndicaliste m'avait dit que mon dossier passerait beaucoup mieux si je
me présentais dans deux commissions du CNRS, celles de sociologie et
d'économie. En 1978 j’ai complètement remanié mon projet et j’ai été
prise en considération par la commission de sociologie (mais toujours
pas par la commission d’économie). Ce qui était déjà remarquable, mais
ne voulait pas dire grand-chose, car il n’y avait que deux ou trois
postes pour une trentaine de prises en considération et mon dossier
n’avait pas été classé. Pourtant, je suis entrée au CNRS l’année
suivante, en 1979, comme attachée de recherche (en même temps
qu'Anne-Marie) ! Grâce à la recherche sur l’hospitalisation qui
prouvait que nous étions payées en décembre 1975 sur ‘l’enveloppe
recherche’, nous pouvions bénéficier du plan d'intégration des
hors-statuts. Martine qui avait plus d'antériorité que nous était
d’ailleurs entrée l'année précédente lors de la première vague de ce
plan. J'ai alors été rattachée au 'Centre d'Anthropologie Economique et
Sociale' (CAESAR) de Paris X - Nanterre où nos anciens professeurs,
Eugène Enriquez et André Nicolaï, nous avait demandés à Anne-Marie et
moi de venir compléter une petite équipe en vue de créer un D.E.A.
d'anthropologie économique.
Tu t'es syndicalisée très tôt, est-ce en rapport avec cette entrée au CNRS?
Je me suis syndiquée à la CFDT avec Anne-Marie en 1976 et nous sommes
devenues responsables du processus d'intégration des hors statuts au
nom du SGEN-CFDT. Le bureau national du SGEN-CNRS comprenait beaucoup
de sociologues (mais aussi beaucoup de physiciens !), en particulier,
le secrétaire général Georges Benguigui et les membres élus de la
section sociologie du comité national qui nous ont en quelque sorte
pris sous leurs ailes : Sonia Dayan, Sabine Erbès-Seguin, par
exemple. La pratique dans ce petit microcosme était de faire confiance
et de donner des responsabilités, même à des néophytes. La
responsabilité qu’on nous a confiée résidait dans la défense des
dossiers des chercheurs contractuels pour vérifier leurs droits à un
poste au CNRS. Ce qui signifiait pour nous deux, de passer des jours
entiers, quai Anatole France, face à l'administrateur des
finances du CNRS, Charles Gabriel, avec lequel on négociait pied à
pied, lui pour limiter le nombre de postes, nous pour obtenir le
maximum. Cela nous a permis aussi de rencontrer nos futurs collègues du
syndicat adverse, le SNCS (le syndicat national des chercheurs
scientifiques), où comme par hasard, c’était essentiellement des
sociologues qui défendaient les dossiers avec nous : Janine Pierret,
Christian Topalov, les Pinçon-Charlot. Il faut dire que la majorité des
chercheurs hors statut étaient des sociologues… on se partageait les
dossiers et nous nous battions ensemble pour tous !
Le SGEN semble avoir été plus ouvert que le syndicat des chercheurs (SNCS )?
Le SGEN-CNRS, sans doute en raison de sa petite taille, était très
dynamique, très ouvert aux nouveaux arrivés. A tel point que l'on m'a
proposé de me présenter à l'élection du Comité national en 1981 alors
que je n'étais qu'attachée de recherche (AR), ce qui est exceptionnel.
Et j’ai été élue dans une vraie commission « à l'ancienne », la section
34 (Sociologie - démographie) du Comité national, avec des mandarins en
face de moi, Henri Mendras, Jean Cusenier ou Jean Baechler. La
première session de recrutement à laquelle j'ai participé, il y avait
cent dossiers de candidatures, pour deux postes à pourvoir. A cette
occasion, je me suis rendue compte que mon dossier perso était loin
d'être aussi bon en termes de publications que celui de bien d'autres
candidats qui n'ont jamais été recrutés ! Les places étaient
extrêmement rares, mais j’ai eu le plaisir de voir reconnue la valeur
d’une chercheuse qui est depuis devenue une amie, Nadine Lefaucheur.
Elle a été recrutée dans ce qui était quasiment à l’époque la seule
équipe qui s’intéressait aux femmes, celle qui était dirigée par Andrée
Michel (Equipe de recherche sur la famille, le rôle des sexes et le
développement humain). Ma position, en tant que simple attachée de
recherches, à l’intérieur de la commission, n’était pas très
confortable : à l’époque, on était recruté comme 'attaché' pendant
quatre ans, au bout desquels, si on avait fait ses preuves, on devenait
'chargé'. Si le travail était jugé insuffisant, on pouvait être
licencié (simple fin du contrat de 4 ans). En fait, le plus souvent, on
était rétrogradé dans le corps des
ingénieurs-techniciens-administratifs (ITA). Je trouvais ça anormal et
je le disais en commission : "arrêtez d'insulter les ITA !
D'ailleurs si vous faites passer des chercheurs dans le corps des ITA,
la commission perdra tout contrôle sur eux".
Et tu t'es prise au jeu de cette syndicalisation...
J'ai adoré cette responsabilité syndicale et la position qu’elle
me donnait. Elle permettait de dire vraiment ce qu’on pensait, voire de
tenir tête à la hiérarchie, le tout sans grand risque puisque c'était
pour le bien commun ! En commission, j'ai appris ce que c'était qu'un
bon chercheur en écoutant les rapports des uns et des autres. Et
l’examen des dossiers de chercheurs ainsi que les rapports sur les
laboratoires m’ont donné une vision fantastique de ce qu'était la
sociologie. La commission était plus 'tourainienne' ou ‘boudonienne’
que 'bourdieusienne' à l’époque, ce qui m’agaçait un peu. Lorsque Alain
Touraine a quitté son labo des mouvements sociaux (CEMS) avec quatre
chercheurs, dont Michel Wieviorka, pour fonder le 'Centre d'analyse et
d'intervention sociologiques' (CADIS), il réclamait la moitié des
moyens du CEMS (en budget et en personnels ITA). Je me souviens de la
discussion qui s'en est suivie. L'un des rapporteurs disant, "c'est
fantastique, Touraine repart à zéro..." et moi intervenant : "il ne
repart pas à zéro tout de même, il veut récupérer la moitié des moyens.
Donc, je propose qu'on lui offre une subvention 'jeune équipe'". Ça
avait beaucoup fait rire et évidemment, Touraine a obtenu satisfaction.
J'ai eu des frittages avec certains directeurs scientifiques. Je me
souviens de Jacques Lautman, un insupportable dictateur ! J'ai eu
l’occasion de le traiter de menteur en pleine commission : il nous
avait promis une chose la veille, lors d'une rencontre avec les
syndicats et le lendemain, il affirmait le contraire devant la
commission. Ma réaction, ici encore, l’a fait beaucoup rire et il n’a
pas modifié sa position, mais cela prouve malgré tout qu’on avait une
réelle liberté de parole.
A l'époque, la commission s'occupait beaucoup des dotations budgétaires
aux équipes, et les échanges pouvaient être féroces, ça a changé par la
suite, cette fonction lui a échappée. En 1982, après l’élection de
Mitterrand, le Comité national a été dissous et réformé. Comme je
n’avais pas effectué un mandat entier, je me suis représentée pour
faire la jonction et j’ai découvert une commission complètement
différente dans son esprit et dans son fonctionnement. Il faut dire que
l’opposition traditionnelle entre membres nommées et membres élus avait
quasiment disparu : nommés et élus étaient tous de gauche ! Cette
commission a été remarquablement présidée par Sabine Erbès-Seguin et
j'ai regretté de la quitter au bout de deux ans, comme je m'y étais
engagée car l’ambiance était vraiment fantastique et le travail
passionnant.
Comment vois-tu le début des recherches féministes ?
Au CAESAR, j'avais rencontré deux chercheuses qui allaient également
bénéficier du plan d’intégration des hors statuts, Danièle Chabaud et
Dominique Fougeyrollas. Elles m’ont mise en contact avec quelqu'un qui
allait jouer ensuite un grand rôle dans l’implantation de la recherche
féministe, Danièle Kergoat, sociologue au 'Centre d'études
sociologiques' (CES). Elle était en train de monter une équipe sur la
division sociale et sexuelle du travail qui allait se transformer en
laboratoire propre quelques années après, le GEDISST. Avec elle, avec
une autre sociologue universitaire, Martine Chaudron, (que j’avais
connue durant mes années de lycée, sociologue doctorante de J-C
Passeron), et un certain nombre d’autres chercheuses, nous
allions poser les premiers jalons des recherches sur le genre au CNRS.
Ce fut l’aventure du ‘sexe du travail’, j’y reviendrais après avoir
évoqué les débuts de l’institutionnalisation des recherches féministes.
En 1981, au moment des 'Assises de la recherche', des chercheuses sont
allées manifester au ministère de la Recherche : il n'y avait rien de
prévu pour les recherches sur les femmes ! A la suite de cette
protestation, nous avons obtenu l'hiver 1981-82, une demi-journée à
Polytechnique pour rendre compte des recherches féministes, d'où il est
sorti le financement du premier colloque féministe français qui a eu
lieu à Toulouse en décembre 1982. L'ethnologue Maurice Godelier venait
de prendre la direction des SHS et il a présidé la séance d'ouverture.
Godelier, qui travaillait lui-même sur la domination masculine, a
d’emblée soutenu les études féministes. Certaines de nous étaient
en contact avec lui, notamment Anne-Marie Daune-Richard qui l’avait
rencontré à Madagascar. A Toulouse, on a pu se compter : six cent
femmes réunies pour un véritable point de départ des recherches et
études féministes. Il y avait là une bonne vingtaine de sociologues
CNRS, les historiennes venaient plutôt de l'Université, autour de
Michelle Perrot à Jussieu ou d’Yvonne Kniebhieler à Aix. Il faut bien
reconnaitre que la commission histoire du CNRS était très peu féministe
! Il y avait aussi des chercheuses de l'EHESS et du côté des sciences
expérimentales, essentiellement des biologistes de l'Inserm et du CNRS
comme Joëlle Wiels. Mais il y avait surtout des chercheuses féministes
de toute la France : Lyon, Nantes, Grenoble ou Lille…
Quels étaient vos rapports avec les sciences sociales?
Le colloque de Toulouse a proposé une forte critique des sciences
sociales qui, pour le moins, ignoraient complètement les femmes. Par
exemple Pierre Naville dans son fameux bouquin écrit avec Georges
Friedman (Traité de sociologie du travail, 1961 + nombreuses
rééditions) qui faisait autorité dans le domaine, parle des
ouvriers du textile, alors qu'il s’agit à 95% d'ouvrières ! Autre
exemple, dans 'Prime éducation et morale de classes' (EHESS 1969) Luc
Boltanski qui voulait étudier comment se diffusait l'idéologie
hygiéniste dans les milieux populaires est encore plus androcentré
! Je cite un extrait d’entretien : "je le mets au sein trois fois
par jour, parce que plus ça me fatigue" avec entre parenthèse 'Limours,
ouvrier plâtrier'. La femme interviewée par Boltanski était ramenée à
la catégorie socio professionnelle de son mari. Ainsi, un ouvrier
donnait le sein ! Ce type d’analyse amusait beaucoup Godelier! L’autre
critique que l’ensemble des travaux faisaient aux sciences sociales
portait sur l’approche qui consistait à considérer les femmes comme une
sous partie des hommes, être femme étant une particularité par rapport
aux hommes. D’où l’exigence de statistiques systématiquement sexuées.
Il vous a donc fallu développer une problématique spécifique
A Toulouse, on s'est rendu compte qu'au-delà de la volonté de faire
sortir la catégorie femme de l’invisibilité, il fallait aussi
développer des outils théoriques pour analyser la nature des rapports
sociaux qui existaient entre les hommes et les femmes. Il s’agissait de
dépasser l’analyse de la société qui se faisait, dans le meilleur des
cas, en termes de ‘rôles de sexe’. Cette première approche, dont Andrée
Michel était le fer de lance, faisait la critique de la conception de
la famille de Talcott Parsons, en dénonçant l’inanité de
l’opposition entre le rôle instrumental de l'homme qui travaille pour
nourrir les siens, du rôle affectif, de la femme qui se consacre au
foyer et à l’élevage des enfants. Elle montrait que ce partage des
rôles, cette division du travail ne correspondaient plus à notre
société dans laquelle de plus en plus de femmes étaient actives
professionnellement. En sociologie, notre critique spécifique portait
aussi sur les découpages de la discipline : la sociologie de la famille
ne parlait que des femmes, très peu des hommes (la loi du père à la
rigueur et un peu à propos du divorce). La sociologie du travail, elle,
comme je le soulignait plus haut, ne s’intéressait qu’aux hommes. Mais
dans toutes les disciplines, nous voulions mettre en évidence ce qui
rapprochait toutes les femmes, c’est à dire l’oppression des femmes, la
domination masculine et nous voulions montrer son caractère historique,
construit, afin de sortir de la vision biologique des inégalités entre
les sexes.
Le colloque de Toulouse avait donc montré qu'il y avait une vraie
dynamique des recherches féministes et dans tous les domaines. Le CNRS
reconnaissant qu’il y avait une réelle potentialité, nous a suggéré
d’envisager la création d’un 'groupe de recherche coordonnée' (GRECO).
Mais ça n'a pas marché, le principe du dispositif étant d'être
pluridisciplinaire, les forces étaient beaucoup trop inégales selon les
disciplines et surtout manquait l’intermédiaire d’équipes de recherche
déjà constituées. Maurice Godelier nous alors proposé de lancer une
'action thématique programmée' (ATP) 'Recherches sur les femmes et
recherches féministes', cofinancé par le CNRS et le nouveau ministère
des droits des femmes du gouvernement Mauroy. J'ai fait partie de
ce comité d'ATP qui ne comptait que des femmes, à l'exception d'un
homme, Philippe Barret, le représentant du CNRS. La présidente de ce
comité d'ATP était l'historienne Rolande Trempé. On y rencontrait
beaucoup de jeunes féministes : Christine Delphy, Michèle Kail, des non
CNRS : Hélène Rouch, des universitaires, Michelle Perrot, Michèle
Bordeaux, avec une sur représentation de la sociologie et de
l’histoire. Les thèmes proposés étaient très ouverts et avaient été
exclus les champs du travail et de la famille dont le comité pensait
qu’ils étaient largement traités ailleurs.
Ne peut-on parler de recherche militante?
Si bien sûr. D’ailleurs, dans ce comité d’ATP il y avait la volonté de
financer des recherches militantes avec des groupes de femmes. Mais ça
n’a pas vraiment marché. En fait, la recherche est une véritable
activité professionnelle et il s'est avéré que la relation entre
chercheuses et simples militantes ne s’improvise pas. Et ce
reproche de militantisme nous a vraiment collé aux basques.
Ainsi, on a rencontré nombre de réticences dans les autres commissions
où les recherches féministes étaient considérées puisque militantes
comme non scientifiques. Cependant, petit à petit, notamment grâce à
l’appui des Nord-Américaines, on a réussi à démontrer que ces études
n'étaient pas moins scientifiques que l'androcentrisme qui avait
prévalu jusque-là. En montrant que tout chercheur parlait à partir d'un
point de vue situé.
Autrement dit, nous justifions scientifiquement le fait de parler de
notre position de femmes en sortant de la confusion homme/être humain.
Pour évoquer l'androcentrisme des positions scientifiques antérieures,
on s’appuyait par exemple sur le sexisme involontaire d’une réflexion
de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss dans l'un de ses écrits: "...
un matin nous nous réveillâmes, le village était vide". Il voulait dire
que les hommes étant partis pêcher et qu'il ne restait au village que
les femmes et les enfants… L'ATP a donc réussi faire entrer les
recherches féministes dans le milieu académique, au CNRS comme dans
certaines universités. En témoignait par exemple la parution de revues
scientifiques comme Questions féministes qui a bénéficié d’une
subvention CNRS. Devant la multiplication de nos travaux, la
commission de sociologie du Comité national a d’ailleurs été obligée de
reconnaître que nous faisions d'aussi bon travail que les autres. La
fin de l'ATP s’est concrétisée par un colloque, suivi d’une publication
majeure : 'Sexe et Genre' (Editions du CNRS) qui a permis
une large diffusion de ses résultats.
Nous commençions à avoir une certaine visibilité mais la bataille pour
une réelle reconnaissance de la validité de nos avancées fut longue, la
France accusait un vrai retard par rapport aux autre pays
européens. La publication de l'article de Pierre Bourdieu sur la
domination masculine (ARSS, 1990), puis de son ouvrage du même nom, a
beaucoup aidé à la visibilité des analyses féministes, même certaines
d’entre nous ont souligné qu’il nous avait beaucoup emprunté sans
jamais nous citer. Cependant, le succès de cette publication a malgré
tout renforcé la légitimité de notre approche. C’est dans cette période
relativement faste qu’a été créé au CNRS, le GDR (Groupe de Recherche)
MAGE (Marché du travail et genre), sous la responsabilité de Margaret
Maruani, l’une des membres fondatrice de l’APRE. Ce GDR a été
créé dans le nouvel institut fédératif que le CNRS venait de fonder en
1986, rue Pouchet, l’IRESCO (Institut de recherches sur les sociétés
contemporaines), institut auquel était rattaché le CSU (centre de
sociologie urbaine) que j’avais rejoint avec mon alter ego Anne-Marie
Devreux, justement dans la perspective de participer à l’initiative que
représentait la création de l’IRESCO.
N'avais-tu pas déjà tentée d'aborder la question de la domination masculine?
Nous n’utilisions pas encore ce terme, mais lorsque nous étions au
CAESAR, avec Anne-Marie nous avions voulu interroger la place des
hommes dans la famille en proposant à la Caisse nationale de
allocations familiales une recherche sur la paternité. Notre projet a
été accepté et nous avons démarré notre enquête. Mais s’est produit un
événement curieux. Nous voulions étudier des trajectoires de pères en
les différenciant le plus possible, pour voir si la paternité de
l'homme que l'on interrogeait variait selon le type de couple et selon
le milieu social. Nous voulions notamment opposer les couples homogames
où l'homme et la femme faisaient le même métier, aux couples où la
femme ne travaillait pas, en passant par des couples où la femme était
active mais à temps partiel par exemple. On avait déjà fait une
vingtaine d'entretiens, lorsque l'on a assisté à ce que j'ai appelé
'l'irruption des nouveaux pères' : la diffusion d'un feuilleton
télévisé (Papa poule) et la sortie d’un film américain, de Robert
Benton (Kramer contre Kramer) qui a profondément modifié la donne. On a
continué à faire notre enquête, mais les entretiens réalisés après ce
déferlement n'étaient plus comparables avec ceux fait avant. Impossible
de saisir la spécificité de chaque cas : la première chose que nous
disaient les hommes interrogés, c'était 'je suis' ou 'je ne suis pas un
nouveau père' ! Auparavant personne ne parlait de cette notion. On
était donc confrontées à des réponses stéréotypées, caractéristiques
d'un phénomène d'induction de la recherche par un déferlement
médiatique. Cette recherche nous a pourtant permis de faire notre place
dans le champ des études féministes en train de se construire.
Tu parlais tout à l’heure de l’aventure du sexe du travail ?
Si le colloque de Toulouse de 1982 a été une réussite, c’est
parce
qu’il avait permis la rencontre de nombres d’initiatives locales,
spécifiques, qui avaient pu ensuite être mises en commun. C’est dans ce
cadre-là qu’il faut inscrire le travail collectif du ‘Sexe du travail’
et de sa suite, le séminaire de l’APRE. Martine Chaudron et
Dominique Fougeyrollas avaient découvert lors du Congrès mondial de
sociologie à Uppsala que l'on pouvait proposer la constitution d’un
groupe ‘ ad’hoc’ qui se réunirait au prochain congrès prévu à Mexico en
août 1982. Nous avons donc tout simplement proposé un
groupe croisant la sociologie de la famille et la sociologie du
travail, dans une approche féministe. Ce groupe ‘ad’hoc’ s’intitulait
'Articulation de l'institution familiale et des structures
productives'. Danièle Kergoat a participé dès l’origine et nous avons
fait appel à nos réseaux personnels d'Aix-Marseille, de Bordeaux, de
Toulouse mais aussi de Paris et le groupe ad’hoc s’est tenu avec un
certain succès grâce aussi à des collègues étrangères, notamment
québécoises et brésiliennes. Puis, après un travail collectif très
efficace de relecture et de critiques, nous avons réussi à publier la
quasi-totalité des communications dans 'Le sexe du travail' (PUG,
1984). Nous avons décidé de poursuivre ce travail collectif en
l’élargissant dans un séminaire bimensuel, l’APRE (Atelier
production-reproduction). Il se proposait d’approfondir les résultats
du ‘Sexe du travail’ avec toujours l’objectif d'analyser simultanément
la place des hommes et des femmes dans la famille et dans le travail,
en essayant de mettre en œuvre de nouveaux outils d’analyse. Il
s’agissait de prendre la mesure des évolutions en cours, notamment le
grand tournant début années 1970 où le nombre de couples à deux actifs
a dépassé celui des couples où seul l’homme est actif. Les femmes
entraient en nombre sur le marché du travail, et nouveauté, s’y
maintenaient même quand elles devenaient mères.
C’est aussi à cette période, en 1984, qu'Anne-Marie et moi avons quitté
le CAESAR pour le CSU, nos co-chercheuses, Danielle Chabaud et
Dominique Fougeyrollas rejoignant de leur côté le laboratoire que
Danielle Kergoat venait de créer à l’IRESCO. Nous hésitions entre le
'Groupe de sociologie du travail' à Jussieu (Sabine Erbes-Seguin) et le
CSU (Paul Rendu), où nous voulions travailler avec Danièle Combes et
Françoise Imbert que nous avions rencontrées justement lors du '
sexe du travail'. Le CSU était un labo très ouvert qui était devenu un
laboratoire propre du CNRS à la fin du plan d’intégration. Son
fonctionnement était très collectif, ce qui me convenait très bien. La
direction était assurée à tour de rôle par un chercheur, remplacé au
bout de quatre ans un autre sous l'étroit contrôle de l’assemblée
générale du labo.
Revenons à ce séminaire 'APRE' qui interroge la relation rapports sociaux - rapports de sexe
Ce séminaire a réuni une quarantaine de chercheuses pendant deux
ans. On invitait toutes les étrangères de passage,
essentiellement des brésiliennes et des québécoises et quelques
italiennes. Ont été invités quelques hommes, Rémi Lenoir qui
travaillait sur la politique familiale, François De Singly qui avait
fait une thèse avec une approche féministe. Le séminaire était financé
par le PIRTTEM (programme interdisciplinaire de recherche technologie,
travail, emploi et modes de vie) après qu'Alain d'Iribarne, directeur
des SHS au CNRS nous ait donné son accord. Comme le séminaire était
fermé, nous avions décidé de diffuser très vite et largement ses
résultats sous forme de cahiers trimestriels. Nombres de concepts ont
été élaborés dans ce cadre, par exemple Monique Haicault y a, pour la
première fois, évoqué le concept de ‘charge mentale’ qui, après avoir
été un peu oublié, a resurgi récemment dans une bande dessinée diffusée
sur le Net ! Ces deux années se sont conclues par une table ronde
internationale en 1987, réunissant une centaine de chercheuses (et
quelques chercheurs !) qui faisait le point sur l’apport d’une approche
en termes de 'rapports sociaux de sexe'. Elle établissait
clairement la base d’une analyse matérialiste féministe de la société.
Nous nous inscrivions clairement dans l'héritage du marxisme, en
montrant comment ces rapports étaient antagoniques, bicatégorisants
(hommes/femmes) et dynamiques (historiquement construit).
Il s'agissait donc de marier rapports de sexe et lutte des classes
Tout individu nait dans un contexte caractérisé par des rapports de
sexe qui lui préexistent mais en même temps il participe à leur
reproduction en les confortant ou en les subvertissant. Ces rapports
s’articulent avec les autres rapports sociaux et particulièrement les
rapports de classe. Danièle Kergoat parlait, à propos de cette
articulation, de consubstantialité, dans un article novateur intitulé
'ouvrier = ouvrière?'. Elle y montrait que naître femme ouvrière, ce
n'était pas la même chose que de naître femme bourgeoise, et même chose
pour les hommes. Autrement dit, on est socialisé en même temps dans sa
position de classe et dans sa position de sexe. Selon la classe sociale
où l’on nait, on est socialisé différemment quand on est un garçon ou
quand on est une fille, même s’il y a des points communs. Le destin
sexué est davantage marqué dans les classes populaires ou dans la
grande bourgeoisie que dans les classes moyennes intellectuelles, par
exemple, où les filles bénéficient de beaucoup plus d’ouvertures
éducatives et scolaires. On aurait pu aussi penser l’articulation des
rapports de sexe avec les rapports de ‘race’, oubli que nous reprochent
aujourd’hui les jeunes féministes ‘intersectionnalistes’, mais c'était
totalement invisible à ce moment-là où c’était moins la différence
ethnique que l’appartenance de classe qui, par exemple, caractérisait
les immigrés.
Comment expliquer ton évolution vers les histoires de vie, a priori éloignées du marxisme?
Eloignées, pas tant que ça ! Dans ce travail sur la paternité que j'ai
évoqué, on avait opté pour la technique des histoires de vies. Mais en
tant que néophytes, nous étions confrontées à certains problèmes
méthodologiques. L’approche biographique était très utilisée par des
collègues, c’est pourquoi nous avons décidé de lancer un séminaire
mensuel dans une salle que nous prêtait la 'Maison des Sciences de
l'Homme'. On a sollicité le sociologue Daniel Bertaux qui était
alors considéré comme un spécialiste et j'ai fait, à cette
occasion, la connaissance de sa femme Isabelle Bertaux-Wiame, qui
travaillait sur les boulangères (ou plus exactement sur les femmes de
boulangers). Participaient aussi Janine Pierret qui travaillait sur les
histoires de malades, Annie Borzeix sur les femmes en grève et bien
d’autres. Nous étions une vingtaine et nous nous sommes beaucoup
apportés. C'est à cette époque également que j'ai rencontré Alain
Courgeau de l'INED qui était responsable d’une enquête quantitative
dite ‘enquêtes trois 'B', recensant les biographiques résidentielles,
professionnelles et familiales des individus. Ce qui nous
aidé pour répondre à un appel d'offres lancé par la MIRE (la mission
recherche du ministère éponyme) Isabelle Bertaux-Wiame, Françoise
Batagliolla, Françoise Imbert et moi. Cet appel d’offre visait à
éclairer, par des approches qualitatives les résultats d'une vaste
enquête quantitative de l'INSEE sur les conditions de vie, le cumul des
handicaps dans les familles, tout ce que l'on appelle les accidents de
vie. Les statisticiens de l’INSEE avait mis au point un questionnaire
biographique rétrospectif posé à des individus tirés au sort au sein
des familles enquêtées. Nous avons mis en place une méthodologie qui a
fait plus ou moins école, ensuite, dans les séminaires de sociologie.
Nous étions quatre : l'une faisait l'entretien oral de l'individu
sélectionné, une autre l'analysait pour en proposer un portrait
récapitulatif, la troisième traitait les éléments collationnés par
l'INSEE pour en tracer également un portrait à partir des données
statistiques et la quatrième comparait les deux portraits. De cette
manière nous étions capables de connaître finement tous nos enquété.e.s
On avait fixé notre panel dans les endroits où l'on avait des points de
chute, en Dordogne, dans le Rémois, le Tarn et Garonne et au pays
basque. Là encore, nous nous sommes appuyées sur nos avancées
collectives de l’'APRE' pour comparer trajectoires professionnelles et
familiales. La partie la plus difficile de la recherche a été de
retrouver les individus retenus par l’INSEE, puis de les convaincre de
nous recevoir (ils avaient en principe donné leur accord lors du
passage de l’INSEE) ; nous avons réussi à rencontrer environ 90
personnes. En est issu un ouvrage collectif « Dire sa vie » et
plusieurs articles méthodologiques sur la comparaison des approches
qualitatives et quantitatives dans les biographies. Mais je commençais
à en avoir marre des études sur la famille et c'est à ce moment que
j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait du côté de l'école.
Avec les normaliennes, tu abordes la question de la féminisation de l'Enseignement supérieur
Oui mais pas seulement ! Aux yeux des chercheuses féministes,
l'école n'était pas un domaine qui posait problème, nous avions toutes
poursuivi des études supérieures. Nous n’avions pas vraiment conscience
de discriminations genrées. Ce n’est qu’à la suite de la réforme
Haby et la généralisation de la mixité dans tous les établissements
d’éducation (et notamment les Grandes Ecoles) qu’on a pu observer la
meilleure réussite des filles dans le secondaire. Personne ne l’avait
vue venir, par exemple, l'historien Antoine Prost avait fait une
analyse de la corrélation classes sociales - réussite scolaire dans
laquelle il montrait que les enfants des classes populaires continuent
d'être peu présents en seconde C, filière d’excellence, mais il n’avait
pas vu, y compris quand cela apparaissait dans ses propres tableaux,
que les filles des milieux populaires réussissaient mieux que leurs
homologues masculins. La première à avoir relevé cette réussite des
filles est Marie Duru-Bellat dans son bouquin 'L'école des filles :
quelle formation pour quels rôles sociaux ?' (L'Harmattan, 1990),
suivie peu après par Christian Baudelot et Roger Establet dans 'Allez
les filles !' (Seuil, 1992).
Afin de pouvoir investir ce nouveau champ de recherche, pendant trois
mois, j'ai avalé toute la littérature sociologique que je souhaitais
sur l'éducation, chose que permettait alors le statut de chercheur.
Grâce à Dominique Le Quéau, normalien astrophysien et responsable dans
ces années-là du concours de recrutement de l’ENS d’Ulm en physique,
j’ai été amenée à m’interroger sur la place des filles dans ces écoles
de l’élite. En 1986, l’ENS d’Ulm a fusionné avec son homologue
féminine de Sèvres, pour répondre aux exigences de la
mixité, c’était la dernière grande école à le faire, (après
Polytechnique où, rappelons-le, une fille, Anne Chopinet, fut reçue
major la première année de mixité !) le recrutement se faisant à
travers un concours unique. Et le résultat immédiat a été une
diminution drastique du nombre de filles reçues aux concours Maths et
Physique. Or avant la fusion des concours, 'Ulmiens' et 'Sévriennes', -
après un concours séparé qui fonctionnait de fait comme des quotas -
poursuivaient ensuite leurs études en commun et les filles se
révélaient souvent meilleures que les garçons. D’où l’idée, avec l’aval
de la direction de l’ENS, d’une enquête auprès des uns et des autres,
élèves avant et après la fusion, pour comprendre ce qui était en jeu
dans cette quasi-disparition des filles. Pour me lancer dans cette
aventure, j’avais l’appui de Françoise Imbert, et surtout d’une
nouvelle connaissance, Catherine Marry qui, de Marseille, avait
rejoint le LASMAS, autre labo de l'IRESCO. La collaboration de
chercheurs de différents labos était une des exigences du CNRS lors de
la création de cet institut fédératif. Catherine qui travaillait sur
les ingénieures, avait auparavant analysé les trajectoires de filles
’transfuges’, c’est-à-dire inscrites dans des filières très peu
féminisées comme celles des 'BTS' masculins de mécanique. C’est elle
qui nous a mises en contact avec Christian Baudelot, enseignant à
l’ENS, qui nous a invité à participer à son séminaire de DEA. J’avais
aussi l’appui d’anciennes sévriennes, Michèle Leduc ou Claudine
Hermann, qui ont été d’un grand conseil dans l’élaboration de la
problématique de l’enquête. Mais pour ouvrir ce champ de recherche, le
CNRS n’était pas prêt à nous aider. Le directeur des SHS de l’époque,
l'historien André Kaspi auprès duquel je siégeais au Conseil
scientifique (où j’avais été élue syndicale) n’était absolument pas
intéressé par les recherches féministes. Le PIRTTEM était terminé,
ainsi d’ailleurs que les ATP. Il fallait trouver notre financement
ailleurs.
Comment avez-vous investi ce champ de recherche?
Nous avons dû présenter notre projet plusieurs fois, et nous avons
obtenu un premier financement, en détournant en quelque sorte un appel
d’offre de la DEP, du ministère de l'Education nationale, qui
s’intéressait surtout à l’échec scolaire. Nous avons proposé
d’étudier le rôle des familles dans la réussite exceptionnelle, en
avançant l'argument : "si on veut comprendre l'échec scolaire, il faut
d'abord comprendre la réussite". Ce qui signifiait d’ailleurs, dans un
premier temps de minimiser l’approche comparative femmes/hommes. Et
nous avons obtenu un premier financement qui nous a permis de lancer
une enquête quantitative auprès des normaliens-normaliennes, puis dans
un second temps un financement supplémentaire a permis une campagne
d’entretiens auprès d’anciens élèves et de leurs parents, en nous
focalisant sur les parents des normaliennes. Si nous avons pu montrer
l’importance du rôle des familles (et notamment des mères) dans la
réussite des enfants, mis à part le rôle de modèles d’identification à
des femmes scientifiques dans l’entourage des normaliennes, le résultat
de notre recherche était un peu décevant, filles et garçons étant
finalement fort peu différents et rien n’expliquait vraiment ce petit
nombre de filles. (L’excellence scolaire : une affaire de
famille. Le cas des normaliennes et normaliens scientifiques,
L’Harmattan, 1999). Toutefois, nous pensions qu’une certaine évolution
allait quand même se produire en faveur des filles. Or, ce qui est
incroyable, c'est que trente ans plus tard, on constate qu'à l'ENS, il
y a toujours moins de mathématiciennes que de mathématiciens, de
physiciennes que de physiciens. Une équipe de l'ENS-Lyon travaille
là-dessus en ce moment avec des hypothèses un peu différentes. Affaire
à suivre, donc…
Avec l'étude sur les conditions d'avortement et de contraception dans les années 1990, tu renoues avec tes débuts...
Je pensais en avoir terminé avec ce sujet après avoir publié avec
Maryse Jaspard notre 'Que sais-je ?' (L’interruption volontaire de
grossesse, PUF, 1987). Cette publication m’avait permis de solder tout
le travail engagé pour ma thèse, thèse que j’avais abandonnée selon les
conseils de mon directeur pour ce type de travail académique. Il ne
correspondait pas au profil d’un chercheur CNRS, car il se faisait au
détriment de vraies recherches (ce qui m'a valu quelques difficultés
ensuite quand les critères du Comité National ont changé !).
Donc, Nathalie Bajos une jeune chercheuse socio-démographe de l'Inserm,
qui voulait relancer les recherches sur l'avortement est venue me voir
sur les conseils d'Henri Léridon, un chercheur de l'Institut national
d'études démographiques (INED). Nathalie avait précédemment travaillé
comme coordinatrice dans l’équipe d’Alfred Spira en 1991 lors de la
première enquête sur la sexualité des Français (ACSF). En fait, j'étais
très contente de renouer avec mes premières recherches, dans une
nouvelle approche, notamment en travaillant avec des chercheuses de
l’Inserm. C'est ainsi qu'en 1998, nous avons réalisé une première
enquête qualitative, dite GYNE, financée par la MGEN. Les premières
analyses des entretiens nous ont permis d’élaborer le questionnaire de
l'enquête COCON (cohorte contraception). Enquête quantitative effectuée
par téléphone, et dès les premiers résultats, nous avons pu constater
la convergence entre les deux approches. Ces deux enquêtes ont mis en
évidence ce que nous avons appelé « la norme contraceptive, articulée à
la norme procréative » : avoir un enfant au moment choisi grâce à
la pratique contraceptive, avec l’avortement comme recours en cas de
grossesse due à un échec de contraception. (l’enquête qualitative a été
publiée : Sociologie des grossesses non prévue, Editions de l’Inserm)
et l’enquête quantitative fait l’objet de nombreux articles. Ces
recherches qui nous ont permis de mettre en évidence le paradoxe
contraceptif : au moment du vote de la loi Veil, le gouvernement avait
prôné la contraception comme bonne pratique (d’ailleurs elle était
prise en charge par la sécurité sociale) qui devait, à terme, entrainer
la disparition de la mauvaise pratique, juste tolérée, celle de
l’avortement. Il y avait autour de 350 000 avortements par an au moment
de la loi Veil. Or, dix ans plus tard, on en comptait entre 200 et 220
000 et ce chiffre semblait désespérément stable alors que le nombre de
femmes utilisant la contraception ne cessait d’augmenter. Ce paradoxe
s’expliquait par le fait que les femmes, adhérant de plus en plus à
l’idée contraceptive (un enfant seulement quand je veux) n’admettaient
pas l’échec et recourraient alors systématiquement à l’avortement
lequel apparaissait comme la phase ultime de la contraception. Ces
conclusions ont fait l’objet d’un Population et société de l’INED sur
ce thème.
Les études féministes sont-elles exportables en Afrique?
En janvier 2000, Michel Bozon et Thérèse Locoh m'ont
demandé de participer à la création d'une nouvelle unité de
l’INED, 'Démographie, genre et sociétés'. C'est ainsi que j'ai
été associée six ans à cette équipe. J'avais pu constater que l'Inserm
fournissait à ses chercheur.e.s des moyens supérieurs à ceux dispensés
par le CNRS, mais avec l'INED, j'ai découvert l’existence des missions
outre-mer et c'est ainsi que j'ai découvert l'Afrique où l’INED avait
beaucoup de terrains de recherches. J'ai effectué plusieurs missions à
Dakar, en liaison avec Pierrette Koné qui était enseignante à l’Ecole
Normale, avec l’idée de mener une enquête sur la scolarisation des
femmes et sur les femmes diplômées, mais ces enquêtes n’ont pas été
très productives. Cela m’a permis cependant d’entrer en contact avec
des chercheurs de l’IRD, démographes et sociologues, Philippe Antoine,
Agnès Adgamagbo, avec lesquels j’ai engagé des rapports de travail qui
se sont concrétisé ultérieurement.
D’où l’idée, avec Nathalie Bajos à la tête du projet, de lancer une
recherche sur la contraception au Sénégal, en saisissant l’occasion de
l’innovation qu’était la diffusion de la pilule du lendemain. Mais nous
n’avons pas trouvé de financement. Alors nous avons décidé d’élargir la
recherche dans une démarche comparative, en cherchant un financement au
niveau européen : nous (chercheuses INSERM, INED, CNRS et IRD) nous
sommes associées avec des chercheuses de la 'London School of
Economics' et de l'Université de Louvain, pour réaliser une étude
comparative dans quatre capitales africaines Dakar, Ouagadougou, Accra
et Rabat. Cette recherche a été à la fois passionnante et très
compliquée à mener à son terme. L’enquête s’appuyait sur des entretiens
effectués par des étudiants de chaque capitale, étudiants de master
qu’il fallait former et encadrer. Sur le sujet concerné, la sexualité
et la procréation, dans ces pays, seules des femmes pouvaient
interviewer des femmes et pareil pour les hommes. J’ai beaucoup aimé
cette partie de la recherche, et j’ai passé un certain temps au Burkina
et au Maroc notamment pour encadrer le recueil de l’information.
Ensuite, j’ai continué à travailler avec Nathalie. Quand elle s’est
lancée avec Michel Bozon dans l’opération Inserm-INED qui consistait à
refaire l’enquête sur la sexualité des Français, j’ai accepté avec
enthousiasme d’y participer, avec la perspective d’y introduire un
questionnement axé sur rapports sociaux de sexe. Cette approche se
distinguait donc très nettement de la précédente très centrée sur le
sida et les pratiques homosexuelles. Ce fut la dernière recherche à
laquelle j’ai activement participée. Mais elle correspond encore tout à
fait à ma conception du travail de recherche : le collectif est à mes
yeux, la manière à la fois la plus efficace et la plus intéressante de
travailler. L’ouvrage, là encore résultat d’un énorme travail commun de
recherches, d’analyse puis d’écriture et de relecture a été publié aux
Editions de la découverte (La sexualité en France).
Comment vois-tu la question des publications, si importante en SHS?
Si je regarde mon parcours de recherche, j’ai mené quelques recherches
solitaires comme certains travaux sur l’articulation entre sociologie
et biologie ou sur la littérature enfantine et son rôle dans la
reproduction des rapports de sexe, mais j’ai toujours regretté de ne
pas avoir en face de moi quelqu’un avec qui partager, par exemple, le
plaisir d’une trouvaille inattendue dans l’œuvre de la comtesse de
Ségur montrant, sinon son féminisme, du moins son modernisme…
Travailler avec les autres semblait me donner davantage de force et
d’audace.
Pour écrire également, je me sentais plus forte et plus précise quand
j’avais un ou plutôt une co-rédactrice. En fait, je n'aime pas écrire !
J'ai toujours détesté la page blanche, l'écriture était le moment le
plus pénible de la recherche. C'est ainsi que j'ai pris l'habitude de
m'enregistrer quand je faisais des conférences car je n'avais aucun
problème à l'oral. Je n'ai pas fait beaucoup de livres, mais un livre
n'est pas un bon critère d'évaluation pour les commissions du CNRS. Les
instances ne retenaient que les articles passés sous les fourches
caudines des comités de rédaction de revues reconnues. En plus il y a
le problème des publications collectives qui n’étaient jamais aussi
estimées que des productions individuelles. Cela a ralenti ma carrière
et pour passer directrice de recherche (DR) j’ai dû publier un ouvrage
de synthèse seule. Il s’agit de ‘Féminin, Masculin’ à La Découverte.
Les premières années ont été les plus difficiles, mais je partageais
mes difficultés d’écriture avec d’autres jeunes chercheuses et nous
compensions nos angoisses par un travail collectif sur les articles des
unes et des autres, notamment en nous partageant les résultats de nos
recherches collectives et en effectuant des relectures plurielles.
Ensuite, j’ai fini par m’habituer et l’écriture est peu à peu devenue
plus facile, en même temps d’ailleurs qu’évoluait le système
d’évaluation.
Les publications sont un critère d'évaluation incontournables dans les
sciences humaines et sociales (SHS) (comme ailleurs !). Mais cela prend
aujourd’hui des proportions complètement aberrantes. J'ai été frappé
par cette évolution quand Nathalie Bajos est allée passer un an à
Cambridge et qui m’a expliqué que la technique la plus courante était
de publier un article chaque fois que l'on avait un petit résultat, par
exemple un article sur tel ou tel aspect de la question analysée et
dans un seul pays, puis un autre article, quasiment identique mais dans
un autre pays. Alors que dans notre équipe, nous essayons plutôt
de faire une synthèse, de faire des comparaisons entre pays. Nathalie
est rentrée d'Angleterre assez désenchantée et a pu constater que
l'Inserm était en train d’adopter cette manière de faire. Moyennant
quoi, on voit désormais des chercheurs publier le même article
plusieurs fois, simplement en changeant quelques bricoles. Tout cela
est d'ailleurs en train de se transformer complètement encore avec le
développement de l'informatique, l''open access'. A ce propos, je me
souviens de mon désaccord avec Emmanuelle Picard, ma fille, maitresse
de conférences à l'ENS-Lyon, concernant les subventions aux revues.
Personnellement j'étais d'autant moins favorable à l'open access que
j'étais devenue responsable de 'Sociétés Contemporaines', une revue
éditée grâce au soutien du CNRS. Mais aujourd’hui, je reconnais que
c'est probablement elle qui a raison.
Comment les recherches féministes ont elles évolué jusqu'à aujourd'hui?
Si j'ai été une chercheuse heureuse, ce qui m’a le plus réjouie c’est
sans aucun doute la reconnaissance de la démarche féministe à travers
la déferlante actuelle du genre et son institutionnalisation. Surtout
avec sa spécificité française : à l’inverse des anglo-saxonnes qui
prônaient des cursus comme les Women’s Studies ou les Gender’s studies,
les françaises ont affiché leur préférence pour le maintien des cursus
disciplinaires ( y compris en revendiquant une approche
pluridisciplinaire des objets) où les démarches féministes devaient
systématiquement avoir leur place. La reconnaissance a été longue à
venir, mais, aujourd’hui le succès semble assuré, comme le montre par
exemple, la création d'un 'Institut du genre' à la MSH Paris-Nord en
2012 ou l’existence de postes colorés 'genre' ouverts au CNRS. La
multiplication des enseignements d’études féministes, dans toutes les
universités et dans toutes les disciplines (la science politique qui
avait longtemps résisté n’est plus à la traîne, comme le montre la
filière récemment créée à Sciences-Po) souligne la fécondité de nos
apports. Reste que la situation est devenue en même temps très
complexe. Ce qui marquait les recherches féministes en France était une
approche matérialiste héritée du marxisme et d'une conception
universaliste de la société. Or avec une nouvelle génération de
féministes se sont développées les études post-coloniales,
l'introduction de la dimension de la ‘race ‘ et d'inter-sexualité, ce
qui est une bonne chose. Mais, en même temps, il me semble que la
catégorie 'femmes' risque de se dissoudre dans les
'approches queer', ces nouvelles théories sociologico-philosophiques
qui postulent que le genre d'un individu n'est déterminé que par son
environnement socio-culturel et par des choix personnels. Ces nouvelles
approches sont à la fois prometteuses et risquées comme l’ont montré
les débats intenses qui ont animé le dernier CIRFF (Congrès
International de recherches féministes dans la francophonie) à Nanterre
en août 2018. Voilà la preuve qu’il reste encore beaucoup à faire.