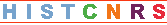En cas d'usage de ces textes en vue de citations,
merci de bien vouloir mentionner leur source (site histcnrs), ses auteurs et leurs dates de réalisation
|
|
 |
Cela s'est produit en 1936, alors que jétais encore étudiant,
à l'occasion d'une mission que je voulais faire au Cameroun.. Je
venais de terminer ma licence et faisais un certificat d'ethnologie en
lettres et en sciences avec Marcel Mauss et Rivet. J'avais mis en place
un groupe d'études ethnologiques pour les étudiants auquel
j'avais invité Marcel Griaule, Lévi Strauss et quelques autres
et je souhaitais organiser une mission rapidement après les examens
d'ethnologie. Jai parlé de cette idée à Mauss et à
Rivet qui étaient d'accord sur le principe. Griaule, à qui
j'avais demandé de m'aider, a accepté de me fournir des documents
de la mission Dakar-Djibouti et m'a conseillé de m'orienter vers
la recherche des populations du Nord-Cameroun, qui formaient un groupe
très intéressant ; puis, il a accepté de prendre la
direction de cette mission. Le CNRS nous a fourni une aide modeste, mais
néanmoins très utile, à la suite de contacts avec
Jamati. Et c'est donc sous couvert dune mission CNRS dirigée par
Griaule que nous sommes partis.
Par la suite, Rivet m'avait proposé de partir dans le nord du
Tonkin et en Chine du Sud étudier les populations Miao sur lesquelles
il avait un certain nombre de documents et voulait plus d'informations.
J'avais accepté d'organiser cette seconde mission. Pour des raisons
personnelles (j'ai été malade), je n'ai pas pu la faire tout
de suite et ne l'ai mise sur pieds qu'en 1939. Le CNRS m'a alors permis
d'organiser une mission assez importante, avec un camarade que je devais
emmener avec moi, pour deux ans. Je devais partir le 15 octobre 1939...
Il se trouve que pendant la guerre, j'ai été aviateur
et j'ai acquis un certain nombre de connaissances dans ce domaine. Au retour,
j'ai retrouvé Rivet qui voulait me faire repartir pour l'Indochine,
ce que j'ai refusé étant donné les conditions militaires
qui régnaient sur place ; je ne voulais pas faire de l'ethnographie
à l'ombre des baïonnettes ! Rivet l' a très bien compris,
naturellement, et il m'a fait entrer au CNRS officiellement comme chercheur
en 1945. Je n'étais pas encore démobilisé et j'ai
été nommé attaché de recherche.
Comment s'est passée cette entrée au CNRS ?
C'est Rivet qui s'en est occupé entièrement. Comme j'avais
connu cinq ans d'interruption de carrière avec la guerre, il était
normal qu'il y ait en quelque sorte une compensation. Comme Rivet me connaissait
et que j'avais déjà organisé une mission avant-guerre,
je n'étais pas inconnu dans les milieux du CNRS. Mais je ne sais
pas comment cela sest fait, s'il y a eu une commission qui m'ait nommé
; j'étais toujours mobilisé lorsque j'ai appris cette décision.
Jai été affecté au Musée de l'Homme. C'est
là que j'ai monté un petit atelier de photographie aérienne
tout en moccupant du Centre de formation des chercheurs avec Leroi-Gouran.
Dans ce centre, jai développé deux idées principales
: la photographie aérienne et l'exploration des villages. En effet,
j'avais réalisé un plan d'analyse du village en France pendant
la guerre, avant de partir pour l'Afrique du Nord, par l'Espagne.
à cette période, j'ai monté une mission en Afrique,
avec l'aide du CNRS, mais sans appui financier, car j'avais des moyens
par d'autres voies, dont l'armée de l'air. Il sagissait dune petite
mission de photographie aérienne et d'études des populations
de Béni Abbès. Par la suite, toujours au Musée de
l'Homme, j'ai voulu m'intéresser à l'ethnographie française
et à l'étude de la classe ouvrière. J'ai alors été
obligé de m'intéresser à des problèmes de géographie
et de sociologie urbaines, pour pouvoir situer les études que je
voulais faire sur les familles ouvrières. J'ai monté à
cet effet un petit centre de recherche au Musée de l'Homme, qui
s'est appelé le "groupe d'ethnologie sociale" et qui
a débuté en 1949 dans des locaux extrêmement éprouvants
pour le travail, la photothèque du Musée de l'Homme. Je n'avais
alors du CNRS que mon traitement, sans moyens pour cette étude qui
était inhabituelle, à une époque où lon faisait
très peu d'études sur la France ; et encore moins sur les
villes ou sur une classe sociale.
Je me suis inscrit en thèse d'état avec Gurvitch et j'ai
commencé à travailler avec Friedman et Lucien Febvre. à
cette période, j'étais soutenu par des gens comme Lévi
Strauss, sous directeur du Musée de l'Homme. Mais il m'était
impossible d'obtenir des fonds sur ces sujets si je restais en ethnologie.
Lévi-Strauss ma conseillé de passer en sociologie où
il me recommanderait.
Pourquoi ne pouvait-on pas obtenir des moyens pour mener ce type de recherche
en ethnologie ?
Parce qu'il y avait trop peu de crédits et qu'ils n'étaient
pas destinés à des questions de ce type. Tout l'argent disponible
était utilisé pour financer des recherches en anthropologie
physique, en ethnologie de l'Afrique, de l'Amérique ou de l'Asie.
Et ce que je faisais paraissait vraiment hors norme.
Je suis passé à la commission de sociologie également
sur la demande de Jamati qui s'intéressait beaucoup à cette
étude et qui m'avait dit que, pour lui, j'étais d'abord un
sociologue. Je lui ai répondu que peu m'importait l'étiquette,
sociologue ou ethnologue, si je pouvais faire le travail qui m'intéressait.
Le CNRS me soutenait sans m'attribuer de grands moyens. J'ai pu obtenir
un peu d'aide de l'Institut National d'Hygiène, grâce à
Jacques Trémolières qui m'a beaucoup aidé pour les
recherches sur les familles. Nous faisions alors des études sur
les budgets des familles, la santé, les pratiques quotidiennes,
les comportements et les besoins et aspirations des familles. C'était
un travail interdisciplinaire.
Quel était le rôle exact de Georges Jamati ? D'après
les archives, on a l'impression que l'interdisciplinarité des débuts
passe par cet homme qui fait le lien entre les commissions ?
C'est en effet le cas. Jamati avait des contacts avec tout le monde,
il avait des qualités d'accueil qui ont rendu beaucoup de services.
C'était un homme très attachant, très séduisant,
qui essayait de comprendre les gens en profondeur. Dans ce milieu qui n'est
pas toujours facile, il faisait certainement le lien entre les personnes.
C'est lui qui a défendu pied à pied les sciences humaines
au CNRS et il a très bien réussi dans ce domaine. Il avait
une passion pour l'administration de la recherche et se donnait entièrement
à cette dimension. Il est mort relativement jeune et je pense que
les efforts qu'il a fait ont du avoir des conséquences sur sa santé,
car il se donnait beaucoup à son travail.
L'interdisciplinarité s'est manifestée d'abord dans l'étude
sur Paris et l'agglomération parisienne à laquelle ont participé
des gens de l'Institut de Statistique, de l'INSEE, de l'Institut d'Hygiène
qui n'était pas encore l'INSERM, des géographes, des ethnologues
donc et des démographes. Cette étude a été
bien reçue et a été publiée aux Presses Universitaires
de France. Cela nous a permis de travailler beaucoup plus efficacement
sur les familles ouvrières que nous avons pu situer dans l'agglomération
parisienne. J'ai travaillé sur ces questions jusqu'en 1953 ou 1954,
date à laquelle j'ai présenté ma thèse de doctorat
et j'ai publié mon livre sur La vie quotidienne des familles
ouvrières aux éditions du CNRS.
Comment s'organisait à l'époque la place
des différentes disciplines ?
Après-guerre, ce sont les commissions qui ont joué un
rôle principal dans leur développement et leur structuration.
J'étais moi-même à la commission de sociologie et de
psychologie, très tôt, puisque j'y siégeais en même
temps que Meyerson en psychologie et Friedman en sociologie. Cétait
un endroit où les tensions étaient très fortes. Les
psychologues étaient mieux organisés que les sociologues
et lorsqu'il y avait des rivalités, les psychologues se débrouillaient
mieux et obtenaient davantage de postes. La commission avait l'avantage
d'être interdisciplinaire, jusqu'au moment où quelques membres
de la commission, dont j'ai fait partie, ont demandé la création
d'une commission de sociologie pour des raisons purement matérielles,
en espérant obtenir plus de crédits et de postes. Le résultat
a bien été là, mais cela a accentué les divisions
entre sociologues et psychologues.
Cette opposition entre les commissions a fait que les psychologues
se sont repliés de plus en plus sur des positions expérimentales
et que la recherche en psychologie sociale, c'est à dire la recherche
interdisciplinaire, a été progressivement éliminée
de la psychologie et de la sociologie. De sorte que la psychologie sociale
a été massacrée. Les sociologues ne voulaient pas
des psychosociologues et les psychologues les renvoyaient également...
J'ai vu des dossiers passer d'une commission à l'autre, au plus
grand dommage des chercheurs. Cela a duré plusieurs années,
surtout après 1960 et cela continue encore.
La création d'une licence de sociologie a-t-elle contribué
au débat ?
Elle a peut-être contribué à diviser. Depuis longtemps,
une pression s'exerçait sur le CNRS, en particulier par le biais
de Jamati, pour que la sociologie soit créée en tant que
discipline, dès avant la guerre. Jamati était un très
chaleureux défenseur de la sociologie et il a toujours plaidé
pour qu'elle soit reconnue. Après la guerre, d'autres ont pris la
relève, Friedman en particulier, Gurvitch bien sûr, Davy,
tous les sociologues qui avaient un certain poids ont milité pour
que la sociologie prenne corps au CNRS.
Vous pensez qu'ils ont réussi ?
Oui,, ils ont réussi à donner à la sociologie une
plate-forme, mais aux dépens de la psychologie sociale qui a été
la parente pauvre de toute cette affaire. Ils ont réussi à
conférer une sorte de cadre à la sociologie industrielle
et à la sociologie urbaine, notamment. En sociologie urbaine, nous
étions les premiers, il y avait eu Halbwachs avant la guerre, mais
ensuite il n'y avait plus rien.
La commission d'ethnologie était couplée pendant un
certain temps avec la préhistoire. Cela ne créait-il pas
quelques tensions ?
Il y avait également l'anthropologie physique dans cette commission
qui tenait une place importante. J'ai moi-même un peu travaillé
en préhistoire, avec Leroi Gourhan dans les fouilles d'Arcy sur
Cure et quelques autres. Ma femme a fait une thèse de psychologie
sociale, mais avec un jury de science, et sa seconde thèse était
une thèse de préhistoire qu'elle a faite avec Piveteau. Elle
avait commencé des études de médecine avant la guerre,
puis elle a été déportée et au retour elle
a repris des études d'ethnologie avec moi, en science ; pour sa
licence de science, elle a suivi des cours de psychophysiologie et de biologie.
J'ai été les suivre avec elle pour que nous puissions avoir
un échange.
L'interdisciplinarité a toujours été très
mal vue au CNRS. Je me rappelle Fraysse disant : "si tu veux faire
de l'interdisciplinarité, libre à toi de faire de l'héroïsme,
mais je te préviens des difficultés vers lesquelles tu vas
".
Pourriez vous citer des organismes où l'interdisciplinarité soit plus facile ?
Les rivalités sont moins fortes à l'école des Hautes
études, mais elles portent surtout sur les postes. On veut qu'il
y ait plus de directeurs d'études en ethnologie ou plus en économie,
mais l'interdisciplinarité y est quand même fondamentale :
vous obtenez une chaire à votre nom et vous pouvez, dans cette chaire,
faire ce que vous voulez. Pour moi, c'était très important
car je pouvais avoir des gens qui travaillaient en sociologie, en histoire
ou en psychologie dans un même laboratoire.
Pourtant ces disciplines viennent d'accéder à une reconnaissance universitaire,
(licence de psychologie en 1947, de sociologie en 1957, d'ethnologie en
1967) et elles recrutent des personnes qui ont une autre formation de base
?
Il y a d'abord des questions de rivalité parce que les crédits
sont faibles, mais il y a aussi une question de compréhension du
langage. Il est vrai que ces différentes disciplines ne parlent
pas exactement le même langage. Je l'ai senti très profondément.
Dans mon centre, au bout de nombreuses années de recherches communes,
je me suis rendu compte que les psychologues et les sociologues employaient
les mêmes mots avec des sens absolument différents et qu'ils
n'arrivaient pas à s'entendre. L'interdisciplinarité est
quelque chose de très difficile et nous en sommes au début.
Il y a encore énormément à faire dans ce domaine.
Ces problèmes de langage sont-ils spécifiques à
l'interdisciplinarité dans les sciences humaines ? On pourrait penser
qu'en biologie où l'interdisciplinarité est très importante
les problèmes de langage se rencontrent moins ?
Je connais très mal ce domaine, mais il se trouve qu'en suivant
les travaux de biologie avec ma femme, j'ai vu les débuts de l'écologie.
L'écologie a eu du mal à faire sa place, parce que justement
elle était à cheval sur différentes disciplines. Elle
avait du mal à se faire entendre, pour des raisons de langage, mais
il est vrai que c'est encore pire en sciences humaines.
Le CNRS et le développement de l'interdisciplinarité en SHS
Le CNRS a joué
et continue à jouer un rôle très important. Je cite
souvent l'exemple suivant. En 1957, je suis parti en mission au Canada
et aux états-Unis en 1957 et j'y suis retourné dans les années
1960. à cette période, on entendait en France de nombreuses
critiques sur le CNRS, on ne cessait de vanter l'exemple américain,
leur efficacité ; et aux états-Unis, on ne cessait de me
répéter combien nous avions de la chance, en France, d'avoir
le CNRS ! Les Américains nous enviaient le fait que les chercheurs
étaient engagés au CNRS uniquement pour la recherche, qu'ils
pouvaient s'y consacrer indépendamment de l'enseignement, ce qui
nétait pas possible aux états-Unis.
Le CNRS a joué ainsi un grand rôle dans le développement
des diverses disciplines de sciences humaines, et encore une fois grâce
à Jamati, dès avant la guerre. Aujourd'hui, le développement
de l'école des Hautes études en Sciences Sociales a relayé
un peu le CNRS, mais je pense que les deux organismes doivent continuer
à travailler en commun. J'ai beaucoup regretté qu'à
mon départ, comme il n'y avait plus personne des Hautes études
dans mon centre, il ait cessé d'être laboratoire associé
et soit devenu laboratoire propre du CNRS. Je crois que c'est une erreur,
les Hautes études auraient dû se défendre, mais elles
n'ont pas cherché à garder le centre. Je trouve que la formule
"laboratoire associé" est très bonne. Un organisme
seul ne peut pas arriver à faire vivre un centre comme ça.
Quels sont les principaux effets ou signes de ce développement?
Le nombre de chercheurs en sociologie a énormément augmenté.
Il y a eu d'ailleurs un malentendu au moment où l'on a intégré
tous les hors statuts. Je dois dire que je suis un de ceux qui ont contribué
à cette intégration, mais elle s'est faite trop brusquement.
J'étais partisan de l'intégration, parce que c'était
une question de justice : j'avais dans mon laboratoire des chercheurs qui
travaillaient depuis cinq ou six ans sans aucun statut et qui pouvaient
disparaître du jour au lendemain. Je trouvais cela injuste d'autant
plus qu'ils étaient aussi compétents, et parfois même
plus, que les chercheurs qui étaient au CNRS. Mais cette intégration
s'est faite trop brusquement et les hors statuts qui sont entrés
au CNRS étaient de valeur inégale. Mais cela a certainement
contribué à développer la recherche en sociologie
et dans d'autres disciplines également.
La question des publications
Nous avons beaucoup utilisé les publications du CNRS. J'avais
une collection au CNRS, qui va probablement disparaître maintenant
avec la nouvelle organisation. Le titre en était volontairement
compliqué, "ethnologie sociale et psychosociologie",
pour marquer le travail interdisciplinaire. On a publié une dizaine
d'ouvrages au moins dans cette collection. Le CNRS a beaucoup aidé
en accordant des crédits, même à des éditeurs
privés. Je pense que cela a été un effort positif,
certainement très heureux. Ces éditions sont peu connues
dans le public, mais connues dans les universités étrangères.
Les rencontres avec l'étranger se sont faites aussi tout naturellement,
puisque le CNRS m'a aidé à créer un Centre et à
publier, ce qui a entraîné des invitations. J'ai été
invité au Canada en 1957 pour faire des cours à l'Université
de Montréal. C'était très positif, car les Québécois
étaient très peu informés de ce que l'on faisait en
France. Puis des professeurs de Montréal et de l'Université
Laval sont venus travailler avec nous. J'ai eu l'occasion d'aller également
aux états-Unis à cette période et de faire une conférence
à Columbia. J'ai été reçu dans plusieurs universités
américaines avec toujours ces compliments adressés au CNRS
!
Pour quelles raisons étiez-vous passé à l'école
des Hautes études ?
Parce qu'il n'y avait aucun enseignement au CNRS et que j'estimais qu'il
y avait besoin d'une liaison entre les chercheurs et l'enseignement de
recherche.
Vous êtes passé par les deux laboratoires du CNRS qui
ont le plus insisté sur la formation des chercheurs : le centre
de formation de Leroi-Gouran et le CES qui a été créé
explicitement avec cette mission...
J'ai participé à cet enseignement au Centre d'études
Sociologiques, mais il n'y avait pas alors la possibilité de délivrer
des diplômes. Tandis qu'à l'école des Hautes études,
des diplômes existaient ainsi que la possibilité de préparer
une thèse. Cela permettait de recruter des jeunes chercheurs et
de renouveler le laboratoire. Pendant une quinzaine d'années, de
nombreux chercheurs du CNRS ont obtenu des charges d'enseignement à
l'école des Hautes études, ce qui était un enrichissement
pour eux. Nous y menions alors six ou sept séminaires.
Je suis resté au Musée de l'Homme jusqu'en 1959 où
nous y étions logés. Mais dès 1949-1950, j'ai développé
des contacts avec le Centre d'études Sociologiques qui venait dêtre
créé. J'y faisais des conférences, j'y avais une sorte
de séminaire, sans jamais y avoir de bureau. En 1959, j'ai quitté
les locaux du Musée de l'Homme et j'ai demandé à entrer
à l'école des Hautes études, qui était encore
l'école Pratique des Hautes études, à la Sorbonne.
J'ai été nommé à l'école Pratique qui
s'est déplacée boulevard Raspail. C'est en 1959 que j'ai
trouvé des locaux dans cet institut à Montrouge où
je suis resté avec le Centre jusqu'à l'année dernière.
Le petit groupe que j'avais monté au Musée de l'Homme
était devenu l'un des groupes du Centre d'études Sociologiques,
jusqu'au moment où Stoetzel a pris la direction du Centre, en 1957
ou 1958 et n'a pas voulu que j'y reste. Il estimait que mon groupe était
trop important, sept ou huit chercheurs, et qu'il fallait que je trouve
une autre solution.
C'est la seule raison qu'il vous ait donnée ?
Oui, je ne sais pas si cela a été un avantage ou un inconvénient,
mais cela m'a obligé à demander la création d'une
unité du CNRS. Mon équipe est donc devenue un laboratoire
de recherche CNRS, alors que jétais toujours personnellement à
l'école Pratique. Le centre est ensuite devenu officiellement un
laboratoire associé, quand la formule a été créée.
Ce laboratoire a fonctionné jusqu'à aujourdhui et il continue
sous un autre nom et sous une autre forme rue Pouchet (IRESCO).
Quelles furent les grandes étapes de la vie du CES ?
Il y eut d'abord Gurvitch, puis Friedman avec lequel les rapports étaient
beaucoup plus faciles et enfin Sorre, un géographe de 80 ans, à
la retraite. L'idée était de rompre avec les discussions
entre sociologues et psychosociologues et de trouver quelqu'un qui était
une personnalité forte et reconnue. Sorre avait été
directeur de l'enseignement supérieur à l'éducation
Nationale et était internationalement connu dans sa discipline.
Il a essayé de faire de son mieux à la tête du Centre,
mais il a été contré par Gurvitch et par d'autres
et sa situation est devenu rapidement intenable.
On a l'impression que le Centre était dirigé de manière
collégiale durant les premières années.
Effectivement, au début, la direction était collégiale,
avec Lévy Bruhl et Gurvitch ; Friedman devait en faire partie, ainsi
que Le Bras dont il faut souligner l'importance. Celui-ci avait un avantage
sur ses collègues : il avait de l'humour ! C'est une arme redoutable
et sympathique. Le Bras a beaucoup milité pour la sociologie. Il
était certainement plus diplomate que d'autres et en même
temps il avait une personnalité très tranchée, très
forte. Il était capable de pousser de grandes colères, mais
toujours avec cette pointe d'humour qui était sa grande force. C'était
un personnage très attachant qui a joué aux Hautes études
aussi un rôle important, avec Lucien Febvre, Friedman, Morazé
et d'autres. Il nous a beaucoup soutenus et défendus auprès
de Gurvitch qui ne nous aimait pas du tout ! Gurvitch a toujours été
très malveillant envers nous, c'est-à-dire les chercheurs
de mon centre qui comportait à cette période une douzaine
de personnes. Friedman aussi nous a défendus, mais Le Bras avait
toute l'estime de Gurvitch, ce que n'avait pas Friedman. Les relations
entre Gurvitch et Friedman étaient épouvantables. Je me souviens
de Naville attaquant Gurvitch, soutenu par Friedman et quelques autres,
la commission se coupant en deux, la moitié de la commission sortant
de la salle ! C'était absolument rocambolesque ! Les dissensions
portaient sur des questions de personnes mais aussi de tendances. Gurvitch
ne pouvait pas sentir les ethnologues, il détestait Lévi
Strauss. Je n'ai jamais compris exactement pourquoi.
C'est pourtant avec Gurvitch que vous vous inscrivez en thèse.
Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Il n'y avait alors que
deux professeurs en Sorbonne pouvant diriger des thèses d'état
en sociologie : Davy et Gurvitch. Quand je me suis inscrit en thèse,
j'ai demandé à Rivet son avis et il m'a conseillé
Gurvitch.
Lorsque je citais Lévi Strauss dans ma thèse, Gurvitch
poussait des colères et voulait me faire enlever ces références.
J'ai été un peu la victime de ces tensions entre les différents
chercheurs. Je pense que chez Gurvitch, des questions idéologiques
entraient en ligne de compte, ainsi que des questions de défense
de la discipline. Mais cette défense de la sociologie était
faite de façon très rigide, alors que Le Bras au contraire
avait beaucoup d'ouverture et était très compréhensif.
Il a joué un rôle très important pour réunir
les gens, leur permettre de faire un travail interdisciplinaire et mettre
d'accord des gens qui n'arrivaient pas à s'entendre.
Meyerson, au moment où la commission était encore mixte
(psychologie-sociologie) a également joué un rôle.
Je pense que la commission de sociologie s'est affirmée progressivement,
avec des personnalités, et qu'elle a joué un rôle dans
la création de laboratoires. J'ai été assez bien soutenu
par la commission de sociologie, avec des moyens insuffisants pour un laboratoire,
notamment pour les locaux et les crédits de recherche, mais nous
avions un certain nombre de techniciens et un secrétariat payés
par le CNRS.
La commission d'ethnologie également s'est assez bien défendue
dans son domaine.
Cest vers le début des années soixante qu'est créée
la DGRST.
La DGRST a été un problème pour nous. Elle avait
plus de moyens, plus de crédits de recherche que le CNRS. La DGRST
ne nous a pas aidés comme elle aurait dû, parce que notre
centre, non seulement était interdisciplinaire, mais était
à cheval sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée.
Depuis les travaux que nous avions faits sur l'agglomération parisienne,
autour de 1950, les urbanistes s'y sont intéressés. On nous
a proposé des contrats de recherche pour faire des travaux sur différentes
villes comme Bordeaux ou Maubeuge. Nous avons commencé par accepter
ces contrats dans notre centre CNRS, puis nous avons pensé que c'était
très lourd pour ce type de structure. Nous avons alors créé
un autre centre qui s'est appelé "Centre d'étude des
groupes sociaux», fonctionnant uniquement sur contrats, avec des
chercheurs engagés par contrat. Ce centre s'est développé
- il y a dû comporter une quinzaine de chercheurs- parallèlement
au Centre d'ethnologie sociale, jusqu'en 1965. En 1965, la DGRST notamment
et d'autres organismes soutenaient le nouveau centre que nous avions créé,
passaient des contrats, donnaient des crédits. Il n'y avait aucune
difficulté. Mais le Centre du CNRS ne recevait rien. J'ai démissionné
du deuxième centre en protestation contre cette inégalité
de traitement. J'ai fait remarquer qu'il était absurde de ne pas
soutenir un centre de recherche fondamentale, puisque c'était de
ce centre de recherche fondamentale qu'était né le centre
de recherche appliquée. C'est un peu l'histoire de la poule aux
oeufs d'or. Cela souligne l'importance du CNRS et montre la nécessité
d'un organisme de recherche fondamentale, non pas coupé de la recherche
appliquée, puisque nous en faisions déjà, mais ayant
la possibilité de se replier sur la recherche fondamentale à
chaque fois que c'est nécessaire. Cet équilibre entre recherche
appliquée et recherche fondamentale est essentiel. Après
l'interdisciplinarité, c'est le second principe que j'ai toujours
défendu.
Y avait-il des liens d'organisation entre ces deux centres ?
Oui, j'étais le directeur des deux. Les deux centres étaient
d'ailleurs dans les mêmes locaux, au début. Le centre de sociologie
appliquée s'étant développé trop rapidement,
on a trouvé d'autres locaux dans Paris. Je suis quand même
resté directeur du Centre jusqu'en 1965. Quand je suis parti, ils
ont changé de nom et sont devenus le Centre de sociologie urbaine.
J'étais resté au Comité du Centre, mais je n'y avais
plus de rôle principal. Ce centre de sociologie urbaine a joué
et joue toujours un rôle important. Il est devenu d'ailleurs tout
récemment un laboratoire du CNRS. C'est très amusant. Ce
Centre a finalement fait de la recherche en grande partie appliquée,
mais avec une partie de recherche fondamentale. Il y a une sorte de chassé-croisé
intéressant entre les deux organismes.
Nous avions fait une séparation entre les deux centres principalement
pour une question de rythmes de travail qui n'étaient pas les mêmes.
Je vais vous donner un exemple : la ville de Bordeaux et le ministère
de la Construction nous avaient passé un contrat très important
pour faire une étude sur Bordeaux parallèlement à
ce que nous avions fait sur Paris. Au départ, les urbanistes nous
ont prévenu qu'ils ne pourraient pas attendre dix ans les résultats
de cette étude. J'ai fait le pari de la réaliser en une année
avec deux chercheurs engagés pour travailler à plein temps
sur le terrain à Bordeaux. Le contrat a été respecté
; ces chercheurs ont fait des choses qui étaient aussi utiles pour
la recherche fondamentale, parce que la recherche appliquée a toujours
des répercussions, mais ils ont travaillé à un rythme
tout à fait différent de celui des chercheurs de notre centre
à Paris.
On avait créé le Centre d'étude des groupes sociaux
très tôt en 1953 sous un autre nom : le bureau d'études
sociotechniques qui est devenu le Centre d'étude des groupes sociaux
vers 1956. Je crois que nous avons été les premiers à
passer des contrats. Les premiers que nous avons passés ont été
avec le CSTB, le Centre du Bâtiment, en 1954.
Vous disiez que vous étiez un peu en difficulté avec
la DGRST...
J'ai protesté contre le fait qu'ils étaient incapables
de s'intéresser à la recherche fondamentale. Le CNRS ayant
moins de crédits ne pouvait pas faire face aux dépenses d'un
centre comme le nôtre et la DGRST tirait les bénéfices
avec le Centre des groupes sociaux, mais sans que cela se répercute
sur la recherche fondamentale. Il y avait là quelque chose qui ne
marchait pas. Cette protestation a été gênante pour
nous et finalement n'a eu aucun effet. Il aurait fallu que je fasse, par
exemple, une campagne de presse, ce que je n'avais pas envie de faire.
Je n'étais pas doué pour ça ! Mais structurellement,
il y a quelque chose qui n'est toujours pas au point entre recherche libre
et recherche engagée. Il vaut mieux employer ces termes que ceux
de recherche fondamentale et de recherche appliquée. L'école
des Hautes études avait d'ailleurs un très bon titre : l'école
"Pratique" des Hautes études. On peut faire des recherches
"pratiques" fondamentales, c'est cela qu'on a oublié
en sciences humaines.
Par exemple ?
Celle qu'on a faite sur les familles ouvrières : nous n'avions
aucun souci d'application. Nous avons fait cette recherche absolument librement,
parce que cela nous intéressait et que nous pensions qu'il était
utile de connaître la vie des familles ouvrières, de connaître
les oppositions entre les classes sociales, les rapports entre ces catégories
sociales et leur répartition dans l'espace. C'étaient là
des problèmes de recherche libre, dite fondamentale. La recherche
que nous avions faite sur Paris et l'agglomération parisienne et
qui a tellement intéressé les urbanistes, était née
du souci de connaître l'agglomération parisienne, point final.
Nous ne pensions absolument pas qu'elle puisse servir à quoi que
ce soit. En revanche, lorsqu'on m'a mis au défi de faire la même
étude sur Bordeaux, en un an, là c'est devenu une recherche
engagée et cela s'est fait avec les urbanistes qui attendaient les
cartes que faisaient les sociologues. Dès qu'il y avait une nouvelle
carte de répartition démographique ou autre, ils se précipitaient
dessus pour l'utiliser pour l'urbanisme. Le rapport entre les deux est
très utile, parce que l'étude de Bordeaux, tout en étant
une étude engagée, nous a apporté des éléments
pour la recherche fondamentale, pour une réflexion sur la transformation
sociale en milieu urbain. Il faut que les gens puissent passer de l'une
à l'autre. Actuellement, c'est difficile car une fois que quelqu'un
s'est engagé en recherche appliquée, on lui demande de rester
dans ce domaine-là ; et s'il fait de la recherche appliquée,
c'est qu'il n'est pas capable de faire de la recherche fondamentale ou
inversement.
Il est vrai que si le CNRS se met à privilégier partout
la recherche appliquée, il n'y aura plus de recherche fondamentale.
Ce que nous avons vécu au plan micro avec nos deux centres, se vivrait
en grand au CNRS. On tuerait la recherche fondamentale au CNRS et cela
se répercuterait profondément sur la recherche appliquée.
Le CES est créé en 1946, en pleine période de
reconstruction du pays. Pensez-vous que ce souci de recherche appliquée
était présent à cette période ?
à ma connaissance, le CES n'a jamais eu l'idée de passer
des contrats ou de faire un travail directement appliqué. On y trouvait
des personnalités comme Pierre George, par exemple, qui était
géographe et qui faisait des séances au CES sur l'urbanisme.
Il s'intéressait déjà à ces questions, mais
pas du tout de la même façon, comme un universitaire et non
pas engagé dans l'action. Nous étions réellement les
premiers à tenter cette approche, soutenus pas Friedman, qui comprenait
très bien cette logique.
Avant-guerre, il y avait eu des recherches sur contrat, notamment
par lintervention de la Fondation Rockefeller...
C'était très différent, il sagissait de sortes
de subventions. Mais le souci de la Rockefeller était surtout d'ordre
politique, beaucoup plus que celui de la Fondation Ford. On m'avait engagé
à me tourner vers eux mais je n'ai pas voulu m'engager dans cette
voie qui me paraissait pleine de problèmes, quand on voit le rôle
que la Rockefeller a joué en Amérique Latine.
Quel serait l'avenir souhaitable pour le CNRS?
Il serait nécessaire que le CNRS soit maintenu. Il est menacé
et je plaide beaucoup pour sa défense. Il faut qu'il soit maintenu
avec des ponts avec l'Université et avec la recherche appliquée,
à condition qu'il y ait toujours une possibilité de repli
sur la recherche fondamentale. Sans cela, on finira par tuer la recherche
fondamentale. Ayant passé un tas de contrats avec un tas de gens,
je peux me permettre de dire que c'est tout de même grâce à
la recherche fondamentale que tout s'est développé. L'autre point est le travail interdisciplinaire qui demande une transformation
du CNRS et de ses structures. On a parlé de commissions interdisciplinaires,
elles n'arrivent pas à voir le jour ; depuis des années,
on en parle et elles ne sont jamais constituées. Il faudrait des
commissions transversales, plus de souplesse et casser les oppositions
entre disciplines, les rivalités de personnes, de chapelles, qui
sont une plaie du CNRS, comme de l'Université d'ailleurs.