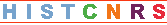La République des savants
revisitée
Le rôle du Nobel Jean Perrin,
figure emblématique
d'une histoire du CNRS publiée il y a quelques années, est plus souvent
évoqué
à l'origine du 'Centre national de la
recherche scientifique' que celui d'André Mayer ou
d'Henri
Lonchambon, deux scientifiques dont le rôle ne fut pas moindres dans la
genèse de cet organisme, voire dans
l'organisation de la recherche
dans la France du XX° siècle. A la fin des années 1920, André Mayer le
titulaire de
la chaire de physiologie au Collège de France participe à
l'installation de l’'Institut
de
biologie physico-chimique' (IBPC), l'organisme qui a directement
inspiré l'organisation du CNRS tout en œuvrant au
rapprochement de la
chimie et de la biologie à l'origine d'une nouvelle discipline, la
biologie moléculaire.
De son côté, nommé doyen de la faculté des sciences de Lyon en 1936,
Henri
Longchambon soucieux d’effacer le clivage entre la
recherche
fondamentale et ses
applications a
organisé le CNRSA, l'organisme chargé d'organiser la
mobilisation scientifique à la veille de la Seconde Guerre mondiale,
inspirant deux Républiques plus tard
l'installation d'une 'Délégation générale à la recherche scientifique
et
technique'. Quant à Jean Perrin, s'il lui revient d'avoir ouvert
au début des années 1930
une caisse
des sciences destinée à soutenir la recherche académique, il a placé à
ses
côtés un Conseil supérieur destiné à gérer les activités de la
communauté
savante.
Devenu 'Comité
national' au lendemain de la guerre, en se présentant comme
l'irréductible
défenseur de la science fondamentale, ce parlement de la science a
certes
professionnalisé
les métiers scientifiques, mais sans jamais réussir à gommer le
clivage institutionnel entre enseignement supérieur et recherche
scientifique. Ainsi doté d'une double vocation de caisse des sciences d'un
côté,
d'institut à vocation finalisée de l'autre, le CNRS écartelé entre la science et ses
applications a dû s'adapter aux injonctions d'une 'Agence
nationale de la recherche'
où le souci de programmation scientifique l'emporte sur
la défense d'un statut des chercheurs.
Fils d’un industriel du textile,
André Mayer est né à Paris en 1875
dans une famille de la bourgeoisie juive d’origine alsacienne. Il
commence ses études médicales à l'âge de 16 ans et passe son doctorat
en 1900. Peu soucieux de s’abriter dans le confort de son milieu aisé,
en pratiquant chaque matin dans une clinique pour indigents des
quartiers populaires parisiens le docteur Mayer manifeste très tôt un
humanisme bienveillant qui ne le quittera pas au cours de sa vie, mais
il est attiré par la recherche. Sous la direction d’Albert Dastre, un
élève de
Claude Bernard
qui l’accueille dans son laboratoire de l'
Ecole pratique des hautes
études (EPHE), il soutient une thèse qui fera date sur les conséquences
physiologiques de la soif, mais aussi psychologiques, un point qui
illustre l'ampleur de ses intérêts multi disciplinaires. Héritier de la physiologie
bernardienne, André Mayer étudie les colloïdes, les suspensions de
macromolécules, première étape d'une recherche pluridisciplinaire où la
rencontre de la biophysique, de la chimie organique et de la
physiologie cellulaire
aboutira quelques décennies plus tard à l'essor d'une nouvelle
discipline, la biologie
moléculaire. Devenu
responsable du laboratoire de physiologie de la Sorbonne, il recrute
des chercheurs qui
resteront auprès de lui jusqu'au CNRS,
Emile Terroine qui travaille sur
les questions de nutrition ou
Emmanuel Fauré Frémiet
sur les ciliés. Engagé volontaire en 1914, la notoriété d'André Mayer
s’élargit au monde scientifique anglo-saxon. Nommé aide-major aux
Armées, il dirige le laboratoire de physiologie des services
chimiques de guerre. En 1915, à la suite de la première attaque aux gaz
asphyxiants menée à Ypres par les Allemands contre les troupes
canadiennes, il organise l’’Allied Chemical Warfare Service’ où il
révèle ses qualités de planificateur. Ses compétences reconnues sur le
plan international, notamment dans le monde anglo-saxon, il
participera à la conférence du désarmement de Washington en 1921 qui
met
la guerre des gaz hors la loi. Au lendemain de la guerre, André Mayer
est nommé
professeur de physiologie à la faculté de Strasbourg où il installe un
institut de
physiologie qu'il confie à son collaborateur Emile Terroine. En 1923,
il est élu au
Collège de France à la chaire de physiologie créée par Claude Bernard.
Le rôle du mécénat scientifique
Le début du vingtième siècle a vu le mécénat scientifique se
développer notamment en Amérique où des fondations sont créées par les
magnats de l’industrie, comme John D. Rockefeller ou Andrew Carnegie. En
1917, à l'entrée en guerre de l'Amérique
la Rockefeller est d’ailleurs intervenue en France, initialement pour développer la lutte antituberculeuse. Au lendemain du conflit,
cette forme de mécénat se développe de manière autochtone lorsque le banquier
Edmond de Rothschild décide de créer une fondation pour le
développement de la recherche scientifique. Après en avoir discuté avec
le recteur de l’université de Paris,
le mathématicien Paul Appell, à
l'été 1921 le baron Rothschild réunit un groupe de sommités
scientifiques, les physiciens
Paul Langevin et son ami
Jean Perrin, le chimiste
Georges Urbain et André Mayer auxquels il confie les destinées de sa fondation. «
C'est
Jean Perrin qui m'a présenté au baron Edmond de Rothschild se souvient l'intéressé.
Je ne savais alors de lui que ce qui était connu de tous,
qu'il continuait la tradition de ces grands banquiers du XIXe siècle
dont nous commençons seulement à mesurer le rôle, banquiers des États,
sans doute, comme leurs prédécesseurs de la Renaissance, mais en vérité
bien plus que cela; au moment où le progrès technique prenait son grand
essor, ils ont permis l’essor économique du monde moderne».
Pour répondre aux vœux du recteur Appell et de Perrin, au lendemain de
la grande guerre la
fondation Rothschild est constituée sous la forme d'une caisse des
sciences censée abonder des chercheurs méritants dans le monde
universitaire. Mais la fondation ne tarde pas à rencontrer des
difficultés
d'arbitrage entre ses innombrables solliciteurs et se retrouve
rapidement
réduite à saupoudrer ses libéralités, une situation qui ne semble pas
avoir répondu aux attentes du mécène.
L’Institut de biologie physico-chimique (IBPC)
A l'initiative d'André Mayer, en 1925 lors d'un séjour à Menton
dans la villa du baron Rothschild, Jean Perrin et son laborantin
Pierre Girard suggèrent alors l'installation
d'un institut
destiné à
réunir des physiciens, des chimistes et des biologistes en vue d'étudier les mécanismes de la vie et leurs applications en
cancérologie (1). L'idée est de permettre à des chercheurs de
différentes disciplines, parfois d'origine étrangère, de mener leurs
recherches dans
un souci d'interdisciplinarité, censé rompre avec les rigidités du
dispositif de chaires universitaires. "
Ayant
accepté la responsabilité de la défense scientifique et ayant mesuré
le danger que le pays avait couru, les hommes de
science qui sortaient de cette guerre ont tous poussés à s'unir pour
alerter le pays et le doter d'une organisation scientifique solide dit Mayer.
Rompant avec les modes de fonctionnement universitaires, il s’agissait
de réaliser cette collaboration des professeurs entre eux, si souvent
désirée, mais jamais organisée jusqu’ici à cause de l’organisation de
notre université en facultés». Grâce à une nouvelle donation de six millions de francs,
un bâtiment moderne est construit et aménagé rue Pierre Curie dans le V° arrondissement parisien.
La direction du nouvel '
Institut de biologie physico-chimique (IBPC)
est confiée à un groupe de 'tétrarques', outre André Mayer
lui-même, les chimistes Pierre Girard et Georges Urbain et évidemment
Jean Perrin, en constituant une matrice du futur CNRS.
Génétique expérimentale...
Antoine Danchin a rappelé comment «
l’IBPC
est né à un tournant de l'histoire de la biologie, lorsque l'étude de
l'organisme a fait place à celle de la cellule et où la cellule
elle-même, commençait à pouvoir être résolue en composants plus
simples, signant le premier pas d'un réductionnisme moderne qui
aboutira à la biologie moléculaire ».
Boris Ephrussi,
un chercheur d’origine russe qui, n’ayant pas trouvé de position à
l’université en tant qu'étranger, a commencé à travailler au laboratoire de cytologie
expérimentale de Fauré Frémiet à l'IBPC. En 1934, grâce à une bourse
Rockefeller, Ephrussi se rend au Caltech chez le pionnier de la
génétique expérimentale, Thomas H. Morgan. C'est là qu'il réalise avec
George Beadle une expérience princeps sur la mouche drosophile qui
démontre
le rôle d’une ‘substance diffusible’ dans la transmission des
caractères héréditaires, première démonstration de la relation génotype
- phénotype, à l'origine de la génétique moléculaire.
Bien informé des développements de la génétique mendélienne, grâce à une bourse Rockefeller, André
Mayer envoie aux Etats-Unis un jeune normalien,
Philippe L’Héritier, s'initier aux arcanes de la génétique mendélo-morganienne, «.
..une
discipline en plein développement aux États-Unis dont il disait combien
il était absurde de la voir ignorée par les naturalistes français ». A son retour en France, L’Héritier initie son condisciple
Georges
Teissier à la génétique des populations et il participera après-guerre
à l’installation de l‘'
Institut de génétique’ du CNRS à Gif s/Yvette.
Dans son laboratoire de l’IBPC,
René
Wurmser, l'ancien préparateur d’André Mayer au Collège de France, s’intéresse aux aspects
énergétique du métabolisme intermédiaire,
mettant à jour le mécanisme
de la biosynthèses par l'assimilation chlorophyllienne. Dans ce
laboratoire un autre boursier Rockefeller,
Louis Rapkine, un biochimiste d’origine russe s’intéresse
avec les pasteuriens
André Lwoff et
Jacques Monod aux phénomènes
d’oxydoréduction dans la division cellulaire.
...et biologie moléculaire
L’historien Michel Morange a comparé le rôle de l'Institut Pasteur et
celui de l'IBPC dans l’essor de la biologie moléculaire en France. Il note que ce n’est que lorsque devient administrateur de l’IBPC à la fin des années 1950 que
l'organisme se réoriente vers la nouvelle discipline. L'historien
conteste aussi le concept d’interdisciplinarité sur lequel fut bâti
l’IBPC. Il ne s’agissait pas d’une coopération égale entre les trois
disciplines, physique, chimie et biologie, mais d’une "
entraide"
dit-il,
un transfert des connaissances des deux premières vers la
troisième. L’argument mérite d'être discuté. Par exemple, la
fondation Rockefeller non plus ne parle d'interdisciplinarité, mais son
président, Raymond Fosdick, évoque le rôle d'une intelligence
collective ('Aristote composite') lorsque
sa 'Natural Science
division' forge le concept de 'molecular biology' au cours des années
1930 (1b). Morange insiste sur les
spécificités de la voie
suivie par les pasteuriens qui délaissent les mouches d'Ephrussi ou de
L'Héritier pour s'intéresser aux "
...micro-organismes qui se sont
révélés bien plus que de simples outils pour la connaissance et la
lutte contre les maladies (puisque) c’est leur étude, en tant que
formes élémentaires de la vie, qui permit l’essor de la biologie
moléculaire » dit-il. Enfin il explique la différence entre Pasteur et
l’IBPC par une question de personnalité.
Autant André Lwoff sut attirer autour de lui un ensemble de
personnalités remarquables, autant l'autoritarisme d'
Ephrussi l'aura empêché de faire école. En évoquant
le singulier destin de la génétique en France
dans
le ‘Journal of the History of Biology’, Richard Burian, Jean Gayon
et Doris Zallen proposent une synthèse de ces deux points de vues. Les trois historiens insistent sur le rôle de la physiologie bernardienne, coincée
entre la
tradition lamarckienne de transmission héréditaire des caractères
acquis et l’absence de tradition génétique mendélo-morganienne, tout en
soulignent le paradoxe d’une hérédité non mendélienne dont les
perspectives, sont partagées dans les deux instituts. Elles sont discutées par
Boris Ephrussi
et André Lwoff au sein d'un informel club de physiologie cellulaire, organisateur en 1948 d’un des premiers
colloques CNRS - Rockefeller
intitulé ‘unités biologiques douées de continuité génétique’.
Quant à André Mayer, avec l'IBPC qui finira par intégrer le CNRS après
la guerre, il lui revient le mérite d'avoir le premier
introduit en France les principes d'une interdisciplinarité
scientifique.
L’apport de l'Institut de biologie physico-chimique ne se
limite
pas à soutenir l'évolution des sciences de la vie - ce qui n'aurait
d'ailleurs pas été négligeable - il a aussi
été le creuset d'une réflexion sur l'organisation de la recherche
publique. Au début des
années 1930, ses responsables imaginent soit l'installation d'une
caisse nationale des sciences demandée par Jean Perrin, soit d'un
service
national de la recherche tel que le suggère André Mayer. La première
option l’emporte, au moins dans l'immédiat.
Né à Lille au
hasard d’une garnison de son père militaire,
Jean Perrin a mené ses
travaux sur la structure discontinue de la matière, le mouvement
Brownien provoqué par l’agitation des électrons qui lui a valu le Nobel
de 1926. Eminent représentant de la 'République des Professeurs'
, Perrin est le membre actif
d’un groupe de normaliens progressistes où l'on trouve le doyen Appell,
le mathématicien
Emile Borel, les physiciens
Aimé Cotton et
Paul
Langevin,
Georges Urbain et le socialiste Léon Blum, tous soudés par des convictions progressistes partagées dans leur jeunesse lors de l'affaire
Dreyfus. En 1930, ils fondent
l’Union rationaliste,
une association
d'inspiration franc-maçonne fondée sur la conviction que l'avancement
des sciences représente le moteur des progrès de l'humanité. Dans une
envolée mystiico-lyrique, Jean Perrin n’hésite pas à évoquer '
...la
science, notre religion' et la règle de la recherche fondamentale,
'l'esprit souffle où il veut'.../ Rapidement, peut être seulement dans
quelques décades, si nous consentons au léger sacrifice nécessaire, les
hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés
jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau.../ Ce sera un
Eden qu'il faut situer dans l'avenir au lieu de l'imaginer dans un
passé qui fut misérable" (2).
Caisse nationale des sciences
En juin 1930, Jean Perrin expose devant
l'Académie des sciences son projet d'organisation de la recherche
publique qui permettrait de fournir des bourses
à de jeunes chercheurs prometteurs. Usant d'une métaphore
agronomique, il affirme le rôle de l’Etat en la matière : "tout
le problème de l'organisation scientifique consiste à trouver les
jeunes esprits qui pourront devenir 'Ampère' ou 'Pasteur'. Le hasard
n'y peut suffire et il faut y aider comme un bon jardinier qui sait
reconnaître et protéger, dans des champs d'herbes folles, les jeunes
plantes qui deviendront des arbres puissants.../ Doit-on continuer à
admettre que l'activité d'un chercheur puisse dépendre de la générosité
d'un mécène? Non. La recherche est un patrimoine national. La prise en
charge des chercheurs est une responsabilité de service public ».
Mais
André Tardieu, le président du
Conseil, demande si avant de
créer un nouveau service avec les couts afférents, il ne conviendrait
pas d'augmenter la subvention de ceux qui existent déjà. Le
projet est donc remanié sous forme de règlement intérieur d’une 'Caisse
nationale des sciences' destinée à regrouper les différents modes
d’intervention existants jusqu'alors, une ‘Caisse nationale de
recherche (1901), la ‘taxe Borel’ (1925),
une caisse de retraite des vieux savants. La 'Caisse nationale des
sciences' (CNS) créée le 16 avril 1930 dispose dès lors d'un budget de 5
millions de francs (env. 300 M€ 2020) prélevé sur celui de la ligne
Maginot. La fonction de cette caisse rebaptisée 'Caisse nationale de la
recherche scientifique' en 1935 sera de permettre à ceux
«qui
se distingueront dans la recherche scientifique, de poursuivre cette
activité, sans avoir d'autre obligation que précisément de continuer à
s'y dévouer entièrement» dit Perrin en s'appuyant sur l'exemple de l'IBPC (3).
Le Conseil supérieur de la recherche scientifique
La bonne utilisation des ressources destinées à
la recherche doit reposer sur une instance
représentative estime Jean Perrin qui obtient l'installation en 1933 d'un ‘
Conseil supérieur de La recherche scientifique’ (CSRS) destiné à fonctionner comme «.
..un
jury à l'autorité incontestable, constitué de personnalités éminentes
(...) qui devaient accepter de faire des propositions dont elles ne
pourraient en aucun cas profiter», autrement dit de promouvoir la vocation de chercheurs prometteurs.
Ce
conseil représentera
l'ensemble des disciplines scientifiques et non des institutions comme
le Conseil supérieur de l'Instruction
publique. Il est divisé en sections dont le découpage est inspiré de
celui des chaires universitaires (mathématiques, mécanique et
astronomie, physique, chimie, biologie, sciences naturelles, histoire
et philologie, philosophie et sciences sociales) et il est prévu que ses
membres seront nommés pour un tiers par l'Académie des sciences et les
sociétés savantes, les deux autres élus par un collège électoral
d'universitaires, dont un quart réservé aux chercheurs de moins de
quarante ans. A
l'Education nationale, ces dispositions sont admises sans
réserve par le directeur des enseignements supérieurs, Jacques
Cavalier. "
Quel que soit son effort,
l'Etat ne croit pas devoir intervenir pour imposer un programme ou des
directives précises. L'orientation de la recherche, c'est aux savants
qu'il appartient de la faire et ce principe de liberté (sera) à la base
de l'organisation de la recherche scientifique en France"
estime ce dernier (4). On
verra comment le 'CSRS' devenu 'Comité national de la recherche
scientifique' une dizaine d’années plus tard tiendra une place prépondérante dans le fonctionnement du CNRS.
Front populaire et politique de la science
En 1936, le Front populaire concrétise un projet emblématique de Jean Perrin, l'ouverture du
Palais de la Découverte, tandis que dans un geste symbolique, Léon Blum le président du Conseil installe un
sous-secrétariat d'Etat à la recherche scientifique qu’il confie à
Irène Joliot, l’épouse de
Frédéric Joliot avec qui elle a obtenu l'année précédente
le
Nobel pour la découverte de la radio-activité artificielle. Plus déterminant, selon une disposition imaginée par André Mayer dès 1930,
Jean Zay le
ministre de l’Education nationale installe un 'Service de la recherche' dont il donne la
responsabilité au
physiologiste Henri Laugier. Il s'agit de développer les moyens des laboratoires en recrutant un corps d'aides
techniques, les futurs ingénieurs-techniciens-administratifs
(ITA) du CNRS. Au printemps 1938, confronté aux ".
..querelles de savants, si redoutables à arbitrer"
que n'ont pas manqué de provoquer la hausse du budget de la recherche (26 MF en 1937), Jean Zay convoque le Conseil
supérieur de la recherche scientifique à la Maison de la chimie (5). A
cette occasion, le ministre évoque la nécessité d'une politique
scientifique,
un
terme que Jean Perrin n'a pas fait sien, mais dont on
relève la première utilisation dans un discours officiel, «.
..lorsqu’il s’agit d’établir un projet
d'extension et de développement de la recherche scientifique en France.
En effet, il est indispensable que soit mis au point un programme de
réalisation qui recueille l'assentiment du corps savant dit le
ministre.../ J'ajoute que l'existence d'un tel programme sera d'un
poids considérable au Parlement lorsque le Gouvernement aura à défendre
ses futures propositions» (6). Lors de cette réunion du 'CSRS',
André Mayer préside une commission chargée d’élaborer un programme
d'extension du Service de la recherche : «
il est singulier que
lorsqu'on évoque l'idée d'une collaboration entre chercheurs, on se
heurte encore à un certain scepticisme. En fait, jamais des
collaborations n'ont été plus nécessaires qu'en ce moment où toutes les
sciences sont en mouvement.../ Aujourd'hui, qui peut être spécialiste
en tout? Réunions, colloques, symposiums, le service de la recherche
doit se faire le tuteur de groupements de ce genre quand il s'agit
d'explorer un domaine particulier de la science ou de réaliser un
programme de longue haleine
» (7). Par le biais d'André Mayer, le concept de programmation fait son
entrée dans l'organisation de la recherche scientifique. Les liens
entre les questions d’alimentation et la
santé humaine n’ont d'ailleurs jamais quitté les préoccupations. La
crise de 1929 avait montré qu’une mauvaise distribution alimentaire
liée à la baisse du pouvoir d’achat avait provoqué des surplus
et non l’inverse, comme on l’imaginait alors, ce qui l’avait amené,
avec sa collaboratrice
Lucie
Randoin de l’EPHE, à participer à la première grande
enquête de la sur les questions d'alimentation humaine menée à la SDN par
Ludwik Rajchman et
Edouard J. Bigwood. Lors de
la mobilisation de 1939, il installe une commission pour
l'étude des problèmes de l'alimentation en temps de guerre. Une recherche
sur le stockage et la conservation des foies de poisson est demandée à
un professeur de médecine à la faculté de Marseille
, André Chevallier,
le fondateur de l’Institut national d’hygiène (INH), l'ancêtre de l'Inserm. A la
Libération, le ‘Centre national de coordination des études et
recherches sur la nutrition et l'alimentation’ dirigé par son ancien collaborateur
Emile Terroine
sera l’un des premiers laboratoires
propre du CNRS (8).
Exil
En 1940, la défaite de la France a
conduit Mayer et Perrin sur les routes de l’exil. Alors que le
physicien nobélisé décéde à
New-York (8 bis), le physiologiste est rayé des
cadres dirigeants de
l’IBPC en
catimini. C'est la conséquence des mesures d’aryanisation exigées par les
autorités d’occupation alors que l’Institut est menacé de
réquisition
par la
fondation pour l’étude des problèmes humains d’Alexis Carrel.
Installé aux Etats-Unis avec les siens, André Mayer participe à la
mission scientifique du mouvement ‘Free French’ animée par Rapkine. Fort
de ses contacts avec les physiologistes anglo-saxons, il rencontre
Eleonor
Roosevelt à laquelle il demande de soumettre à son président de mari le
projet d’une organisation internationale sur l’alimentation et
l’agriculture. En 1943, il participe à la conférence de Hot Springs où
est décidé l’ouverture de l’‘United Nations Refief and Rehabilitation
Administration’ (UNRRA), un organisme appelé à tenir un rôle majeur dans
l’approvisionnement alimentaire de l’Europe d’après-guerre. En
octobre
1945, il est élu premier président de la ‘
Food &
Agriculture Organization’ (FAO) établie sous l’égide de l’ONU. De cette position, il est amené à intervenir en
France pour épargner au directeur de l’INH, André Chevallier, les
foudres des comités d’épuration mis en place à la Libération. Le
ministre communiste François Billoux ayant déclaré que quatre années
d’occupation avaient laissé «
…les trois quart de la population
française en état de grande détresse alimentaire »,
André Mayer met en garde le Gouvernement provisoire contre le risque de
leurrer les Alliés sur l’état réel du pays en matière
d’approvisionnements. D’autant souligne t-il, que les services
sanitaires de l’US Army ont procédé à des enquêtes sur les conditions
de vie dans les régions libérées dont les résultats corroborent celles
menées par l’INH sous l'occupation et tendent à conclure qu'en France la situation fut
loin d’avoir été aussi dramatique que dans d’autres pays occupés. Devenu septuagénaire, André Mayer retrouve la direction de
son laboratoire du Collège de France et il donne sa démission
officielle de l’IBPC qu’il ne reprendra qu’en 1953,
trois ans avant son
décès survenu au retour d’une mission d’étude qui l’a conduit au
Sénégal.
Henri Longchambon est le cadet de
trois frères normaliens dont le père,
modeste employé d'octroi, avait réussi à accéder au poste d'appariteur
à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand rappelle son biographe Gwenael Kropfinger. A l’âge de 17 ans, il
intègre une prépa au lycée Saint-Louis. Engagé en 1915, il fait une
belle guerre comme commandant d’une batterie de mortiers, puis il est reçu aux concours de
Polytechnique et de l’École normale supérieure. Mais il choisit la
seconde selon un penchant qui le pousse vers l’enseignement plutôt
que le métier d’ingénieur qu'il ne dédaigne pas pour autant, comme le
révélera son souci de lier la recherche scientifique à ses
applications.
Préparateur dans le laboratoire de minéralogie de Charles Mauguin à la
Sorbonne, Henri
Longchambon développe les techniques nouvelles de radiocristallographie
par rayons X. Avec l'aide de Jean Wyart, un condisciple formé à l'analyse des images de diffraction qui le suivra au CNRS, il
soutient une thèse sur la rupture des réseaux cristallins à l’origine
du phénomène de triboluminescence.
Université et industrie
En 1927 Longchambon est nommé à la chaire de minéralogie de
la faculté des sciences de Lyon où les relations avec l'industrie n'ont rien
d'exceptionnel à l'époque. Il travaille sur l'exploitation des pyrites nécessaires
à la fabrication de l'acide sulfurique pour le compte de la ‘
Société des Terres Rares’ de Georges Urbain.
Il bénéficie du soutien de la nouvelle 'Caisse nationale
des sciences' pour dresser avec le minéralogiste
Pierre Lapadu-Hargues
la
carte des gîtes métallifères de Lozère. L’historienne américaine
Mary-Jo Nye a analysée cette caractéristique des facultés provinciales, au moins
au début du vingtième siècle, consistant comme à Lille, à Lyon, à
Toulouse ou à Nancy, à entretenir des liens étroits avec les milieux
industriels (9).
Elles ont permis à certains universitaires d’atteindre une notoriété
internationale, comme Paul Sabatier à Toulouse et Victor Grignard à
Lyon, tous deux récompensés par le Nobel de chimie 1912. Or, si les
Usines du Rhône, Saint-Gobain ou Berliet n’hésitent pas à financer des
chaires et les laboratoires de la faculté des sciences lyonnaise, ces
pratiques sont jugées sans aménité dans le monde académique
parisien.
L’historien Christophe Charle signale les
réticences du doyen Appell à propos de la formation d'ingénieurs
chimistes à l’université de Lyon : «
…en
substituant au diplôme de chimiste qu'elle délivrait d'abord, celui
d'ingénieur chimiste, non seulement on ne voit pas où cela va la mener,
mais en agissant de la sorte, on fait tort aux enseignement élevés"
(10). Malgré les réticences du monde
universitaire vis-à-vis du monde industriel, en 1936 à quarante ans,
Longchambon est
nommé au décanat de la
faculté des sciences lyonnaise où il succède à
Victor Grignard. Le plus
jeune doyen de France caresse le projet de réaliser une liaison plus
étroite de la science et de la technique. Convaincu du rôle que doit tenir l’université
dans la formation des ingénieurs, il installe une école destinée à
former des cadres pour l’industrie. Accompagné de Georges
Villiers, le futur président du Centre national du patronat français (CNPF),
il étudie les méthodes d’orientations professionnelles utilisées en
Suisse. En même temps, comme responsable de la section lyonnaise de
l’'Union rationaliste', il noue des liens d’amitié avec
Henri Laugier qui le convie à visiter le centre de formation professionnelle des chemins de fer de l'Etat à Viroflay. Cette dernière relation va mener le jeune
doyen lyonnais aux manettes d’un organisme scientifique national.
Le CNRSA(ppliqué)
Au printemps 1938, la conjoncture
politique suscite le rapprochement du CNRS et de la recherche
industrielle. Alors que l'Anschluss a levé l'ambiguité sur les visées expansionnistes
du troisième Reich, le ministre Jean Zay
se préoccupe de préparer
la mobilisation scientifique du pays.
L’installation d'un ‘Centre national des recherches scientifiques
appliquées’ (CNRSA) est décidée afin de remplacer un
’Office national
de la recherche scientifique et des inventions’ (ONRSI) créé par le
sénateur Jules-Louis Breton à Meudon-Bellevue au lendemain de la Grande Guerre. Cet office issu de la transformation d’un
Service des inventions intéressant la défense nationale
s’était
surtout préoccupé de développer les Arts ménagers, au prix d’une
gestion jugée opaque par la Cour des comptes. A ce propos, responsable d’une
commission des offices instaurée en 1935 pour réduire les dépenses de
l'Etat, le conseiller Pierre de Calan écrit : «
on
peut regretter qu'il n'existe pas encore en France, auprès du Président
du Conseil, une véritable organisation administrative à laquelle
puissent être rattachés certains services généraux..../ Tel pourrait
être à l'avenir le cas des services de la recherche scientifique. Il
est essentiel que dans la répartition des crédits affectés à la
recherche scientifique, la voix des représentants qualifiés de l'Etat
soit toujours sûre d'être écoutée…/ (A l'avenir), cette aide devrait
répondre à un plan, à un but national…». Ainsi, en
1938 l’ONRSI de Jules Breton cède la place au 'Centre nationale des recherches
scientifiques appliquées' (CNRSA). A sa tête, Jean Zay souhaite
placer un homme apte à concilier les milieux scientifiques et
industriels. Il rencontre Ernest Mercier (Union d'Électricité),
Raoul
Dautry l'ancien directeur des chemins de fer de l'Etat, Auguste Detœuf
(Alsthom) du groupe X-Crise, mais sur la recommandation
d’Henri Laugier, le poste revient à Henri Longchambon. L'intéressé
quitte Lyon pour s’installer au quatrième
étage d’un immeuble du Quai d'Orsay, le futur siège du CNRS. Il est
assisté de quatre chargés de mission,
Jean Wyart,
Georges Champetier et
Felix Trombe, auxquels revient d'abord la tâche d'un inventaire des
laboratoires français. L'enquête du CNRSA révèle l’état léthargique de la
recherche universitaire, «
un
flot de chercheurs individuels et de laboratoires plus ou moins
officiels, tous en quête fiévreuse d’un complément de subvention,
s’offrant à entreprendre n’importe quel problème, mais prêts le plus
souvent à aucun » commente Longchambon (11).
La recherche programmée
Pour remédier à cette situation, des
émissaires sont envoyés à l’étranger pour investiguer des modes
d'organisations de la recherche scientifique.
Jules Guéron, un futur
directeur de
la chimie au CEA, va étudier le fonctionnement du ‘
Department of
Scientific and Industrial Research’ (DSIR) britannique dont veut s'inspirer Longchambon : «
si
on veut bâtir une organisation économique réfléchie et judicieuse, la
base de départ la plus rationnelle pour l’organisation des recherches
scientifiques appliquées est le problème à résoudre ». Ainsi, l’un des premiers programmes du CNRSA concerne
le ‘Laboratoire d'analogies électriques’ où le mathématicien Joseph
Pérès est convié à développe des méthodes de modélisation destinées à l'industrie
aéronautique à l'origine après la guerre de l’'
Office national d’études et
de recherches aéronautiques' (ONERA). De même, pour combler le retard
français en matière de radionavigation, le CNRSA confie au
physicien
Yves Rocard qui
travaille avec la
Cie. générale de télégraphie sans Fil' (CSF), envisage l'utilisation d'hyper-fréquences pour le radioguidage des
avions.
Une commission chimique cherche à compenser le retard dans le domaine
des matières plastiques dont la France ne représente alors que 4% de la
production mondiale. Les sciences sociales ne sont pas oubliées, une
commission d'économétrie créée par François Divisia du groupe X-crise
tiendra un rôle pionnier dans le développement de cette discipline.
Enfin, le
physicien Pierre Auger se voit confier le soin d’installer un service de documentation censé fournir à la
communauté scientifique les microfiches de publications scientifiques
étrangères, y compris allemandes. Sous la direction de Jean Wyart celui-ci
deviendra le '
Centre de documentation scientifique et technique' du CNRS.
La mobilisation scientifique
A l'automne 1939, au lendemain de la déclaration de guerre,
Jean Coutrot du groupe X-crise propose une réforme susceptible de «
tirer un rendement plus élevé de la recherche scientifique»
(12), autrement dit de 'coordonner', selon le terme utilisé à l'époque,
l'activité de l'ensemble des laboratoires français. Dans la plus grande discrétion,
un décret publié au
Journal Officiel du 19 octobre 1939 annonce la fusion du Service de la
recherche, de la Caisse nationale de la recherche scientifique et du
CNRSA sous le sigle de ‘Centre national de la recherche
scientifique’ (CNRS). Cet organisme est chargé de la coordination de la recherche dans un
contexte de mobilisation scientifique. Le CNRS est
alors animé par une direction
bicéphale,
Laugier pour la recherche fondamentale, Longchambon pour ses
applications : «
ce duo était très amusant tant leur caractère était
différent se souvient Jean Wyart, autant
l’un (Longchambon) était un fonceur qui provoquait les réactions
parfois violentes de ceux qu’il bousculait, autant l’autre (Laugier)
était un arrangeur qui manœuvrait tout en finesse politique».
Dans l'immédiat, cette disposition répond aux contraintes de l'heure
et, dans les faits, Longchambon est devenu le patron d’un CNRS
bicéphale auquel revient la tâche d'organiser la réquisition des
laboratoire et
de leur personnel, d'ailleurs non sans provoquer les protestations des
milieux
universitaires. Le
physicien Louis Néel spécialiste du magnétisme se souvient de la manière dont Longchambon le charge d’évacuer la faculté de Strasbourg; «
(il)
envoyait des avis de réquisitions absolument magnifiques, sans se
préoccuper de la moindre hiérarchie, sans s'occuper de l'avis des
doyens des facultés des Sciences, ce qui avait donné lieu à des
frictions considérables. Il m'avait expédié à Strasbourg sans en
référer à l’astronome André Danjon, le doyen de la faculté des sciences
dont je dépendais. Mais ni le recteur de l’université de
Clermont-Ferrand où celle de Strasbourg s’était repliée, n'avaient été
prévenus, moyennant quoi le CNRS s’était retrouvé accusé de
cambriolage. Nous avions forcé les bureaux des professeurs pour ramener
tout ce qui était dans les armoires que l’on avait chargé dans trois
wagons de marchandise destinés à Meudon Bellevue ». Une commission des affectés spéciaux
propose aux Armées la liste des scientifiques dont la présence est
estimée plus utile derrière leur paillasse que dans les casemates de la
ligne Maginot. Si on ajoute à un total de 228 affectés spéciaux, les
650 requis non déplacés de leurs laboratoires, les effectifs mobilisés
sous l'autorité du CNRS atteignent 1200 personnes, ceux d'un régiment
note le journal 'Paris-Midi' (13). Une question délicate se
pose à propos de l'emploi des scientifiques fraîchement immigrés.
Emile
Terroine suggère la création d'une légion étrangère scientifique,
mais qui ne pourra voir le jour avant la débâcle. Ces requis sont
affectés dans les 139 laboratoires mobilisés, 11 en mathématiques, 45
en physique, 36 en chimie, 33 en sciences naturelles et 14 en biologie
médicale, réunis dans 20 groupes régionaux, dont 6 à Paris. Parmi ces
derniers, le 'GR 1' dirigé par Frédéric Joliot regroupe
le cyclotron au Collège de France, le
Laboratoire de synthèse atomique du CNRS et
l'Institut du radium.
De l'énergie atomique aux moteurs à gazogène
La recherche atomique représente une réalisation majeure à porter au
crédit du tout jeune CNRS, notamment grâce aux travaux menés au
'Laboratoire de
synthèse atomique' installé à Ivry s/Seine par
Frédéric Joliot et sa petite équipe. Dans l'immédiat avant-guerre, les expériences réalisées avec deux
chercheurs
fraichement naturalisés,
Hans Halban et
Lew Kowarski, un diplômé de
l’École de chimie industrielle de Lyon,
confirment la possibilité de provoquer
une réaction en chaine, autrement dit d'
exploiter la réaction de fission nucléaire.
Selon l’historien
Dominique Pestre, l’équipe Joliot bénéficie alors
d’environ 2% de l'ensemble des crédits alloués à la recherche
française, tandis que son collègue
Spencer Weart place les publications
des
atomistes français au deuxième rang dans le monde, derrière les
Etats-Unis (14). Au printemps 1939, trois brevets sont déposés au nom
du
CNRS, le premier sur un dispositif de production d'énergie, un autre
sur la stabilisation du dispositif précédent et le troisième sur des
perfectionnements aux charges explosives,
autrement dit une bombe atomique.
Raoul Dautry, le ministre de l’Armement
qui soutient ce programme
finance l’achat d’oxyde d’uranium et
de l’eau lourde,
le modérateur de la réaction en chaine, tandis qu'une
convention notariée passée avec le CNRS donne naissance à une ‘Société
anonyme pour l'exploitation de l'énergie atomique’. En juin 1940,
les atomistes sont évacués vers Clermont-Ferrand ou Henri Longchambon
propose d'installer une pile expérimentale (15). Mais la défaite coupe
court à ce premier programme atomique lancé dans le monde. Une semaine
avant la signature de l’armistice, Halban, Kowarski et Longchambon
s'embarquent pour l'Angleterre avec le stock d’eau lourde, tandis que
Joliot qui a décidé en rester en France reprend ses activités
scientifiques dans le
Paris de l'occupation. Après avoir délégué la direction du CNRS
au
doyen de la faculté des sciences de Bordeaux (J. Mercier), Laugier et
Longchambon sont accueillis à Londres par le DSIR. Au lendemain de
l'armistice,
tandis que
Laugier gagne les Etats-Unis et rejoint le mouvement 'Free French',
Longchambon informe ses interlocuteurs qu'il met un terme
à la mission du CNRS installée en Angleterre. En
juillet 1940, il embarque avec
le personnel de l’ambassade pour être rapatrié en France via Lisbonne.
Il est reçu à Vichy par
Marcel Déat son condisciple normalien devenu député qui vient
de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Celui-ci plaide en
faveur de ce "
...transfuge manqué ou gaullistes en puissance"
(sic) et le physicien regagne la faculté des sciences lyonnaise. Peu après entré en Résistance
aux côtés d’
Yves Farge, Longchambon
accueille les jeunes réfractaires du STO dans les bois de
Chapdes-Beaufort, un berceau des maquis d'Auvergne, où il a fait
installer des fours de carbonisation du bois pour les moteurs à
gazogène destinés à paller le manque de carburants.
IV - Les années 1940, l’improbable coordination
scientifique
Malgré les menaces pesant
sur l’existence d'un CNRS fustigé comme une émanation du Front populaire, en août 1940
le géologue Charles Jacob est nommé à la tête d'un organisme dont il plaide à Vichy l’utilité dans un pays occupé. Non
sans des difficultés liées à l’émigration de chercheurs, au souci de
préserver son personnel des mesures antisémites et aux
pénuries
de matières premières, le CNRS assure son
soutien aux recherches suscitées par les difficultés de l'heure,
ersatz alimentaires,
conservations des aliments, carburants de substitution, etc. Mais aussi
développement des radio-isotopes à usage médical, physique des
ultra-hautes pression, cristallographie par rayons X, étude des rayons
cosmiques, voire
archéologie métropolitaine (16). A la Libération alors que la directeur du CNRS nommé par Vichy est remercié et dans une
capitale en pleine insurrection,
Frédéric Joliot est
nommé
directeur du CNRS par ses camarades du 'Front national universitaire'
d’obédience communiste. Comme ses prédécesseurs, Longchambon et
Jacob, Joliot est persuadé de l'intrication nécessaire
de la recherche
fondamentale et des applications. Ostracisé par les Américain
du fait de ses contacts avec les Allemands installés au Collège de France (17), il confie à
Louis Rapkine qui s'était occupé des scientifiques français
exilés pendant la guerre, le soin d'organiser à Londres un '
Groupe de recherches
opérationnelles’. Ce groupe doit s'informer des travaux menées par les Alliés en
matière d’électronique, de fabrication de pénicilline ou de plasmas
sanguins. Le CNRS patronne aussi une mission de
récupération de chercheurs et de matériel
scientifique
dans les zones d’occupation françaises en Allemagne et en
Autriche, un radar Würzburg de détection aérienne est affecté aux
astrophysiciens de l’observatoire de Meudon, une soufflerie
aéronautique saisie dans les Alpes autrichiennes est remontée à Modane,
tandis que l'industrie accueille des ingénieurs allemands.
Incertitudes tutélaires
A la libération, le CNRS se voit
assigner le rôle que lui avait confié le décret d'octobre 1939, à
savoir coordonner l'ensemble de la recherche française, autrement dit
le soin de mener une politique scientifique nationale. Or Joliot se
trouve d'emblée confronté à la
double mission désormais dévolue au CNRS, d'un côté celle d'une caisse des sciences dédiée au
soutien de la recherche académique, de l'autre celle d'un opérateur de
recherche chargé de grands programmes technico-scientifiques dont le '
Manhattan project' représente l'archétype. Lorsqu'il
évoque la
mission de coordinateur du CNRS, Joliot se heurte à un front d'universitaires soucieux de
maintenir l’organisme dans le giron de l’Education nationale. Ainsi, le
biologiste Marcel Prenant
se fait l'avocat de la
liberté nécessaire à la recherche fondamentale dont lui et ses
collègues s'estiment avoir été indûment spoliés lors de la
mobilisation de 1939. De même, les universités de province font
remonter leurs inquiétudes vis-à-vis des initiatives mobilisatrices prises par
Longchambon au début de la guerre. Les
archives du CNRS ont gardé les procès-verbaux d'une réunion du comité
directeur tenue au mois de septembre 1944 (18). La proposition de nommer
Maurice
Ponte dans cette instance, le patron de la
CSF, est récusée par
Paul Langevin au prétexte ".
..qu'il (serait) temps que le CNRS cesse de faire des cadeaux à l'industrie".
En octobre, Joliot rend compte au comité directeur d’un entretien qu'il
vient d'avoir avec
le ministre de l'Education nationale,
le juriste René Capitant,
lequel lui a
confirmé l'intention de maintenir le CNRS sous la tutelle de
l’Education
nationale. «
Je pense dit Joliot,
que le CNRS aurait dû dépendre
de la présidence du conseil plutôt que de l'éducation nationale.
- La présidence du Conseil est le
pôle auquel veulent être rattachés la recherche, les archives et les
sports" rétorque
le psychologue Henri Wallon, l'universitaire qui l’a
porté à la tête du CNRS deux mois plus tôt. "
Je me demande s'il n'y a pas quelques
illusions sur l'efficacité d'une telle mesure!
- J'ignorais que Matignon était le
pôle en question répond Joliot,
mais je sais que nos labos sont
pauvres parce qu'ils n'ont pas suffisamment de relations avec
l'industrie. Il vaudrait mieux alors transformer le CNRS en commissariat ". Intervient alors le
philologue Mario Roques : «
Je
suis d'accord avec Wallon, la présidence du conseil, c'est trop
politique. De plus, imaginez que les sports prennent le pas sur la
recherche!». Une ordonnance de novembre 1944 confirme donc le CNRS comme l'une des directions
du ministère de l'Education nationale aux côtés de
l'Enseignement supérieur. Dèjà sous l'occupation, la tutelle de la rue de Grenelle avait provoqué en réaction l'installation
de divers organismes à l'initiative d'administrations techniques
soucieuses de disposer de leurs moyens de recherche.
L'
Institut national d’hygiène', l'ancêtre de l'
Inserm, est installé par le secrétariat d'Etat à la Santé en 1941,
l’Office des recherches scientifiques coloniales en 1942 (ORSC, puis ORSTOM et aujourd'hui
Institut de Recherche pour le Développement) malgré les protestations de Charles
Jacob, le directeur d'un CNRS théoriquement chargé de coordonner la recherche publique. Quant au
'Centre national d'étude des télécommunications' (CNET)
inauguré en mai 1944, il est placé d’emblée sous tutelle
interministérielle. D'autres organismes sont créés à la Libération tels l''
Institut national de recherche agronomique' (INRA) à l'Agriculture ou
l'’Institut national d’études démographiques' (INED) qui fait suite à la 'Fondation Carrel’ et le
'Commissariat à l’énergie atomique' (CEA) en octobre 1945, directement rattaché au chef du gouvernement, le général de
Gaulle,
qui place Frédéric Joliot et Raoul Dautry à sa tête (18b).
Le Comité national et la recherche fondamentale
En janvier 1946, le généticien
Georges Teissier
succède à Joliot à la direction du CNRS. Ce cévenol austère,
universitaire
tôt entré en Résistance, avait été placé à ses côtés par le Parti
communiste. Cette nomination marque le retour de l’organisme à sa
fonction de caisse des sciences telle que voulue par Jean Perrin quinze
ans plus tôt. Prenant le contrepied de ses
prédécesseurs qui prônaient le rapprochement de la recherche et de
l'industrie, Teissier affirme la priorité qu’il compte donner à la
recherche fondamentale : "
Un
reproche souvent fait aux scientifiques français est d'avoir résolument
ignoré la science appliquée. Mais il ne faudrait pas que, tombant d'un
excès dans l'autre, on sacrifie au bénéfice de la recherche technique,
la recherche pure qui, seule, prépare l'avenir.../ Certains songeaient
qu'une assimilation à l'industrie eût été préférable, dit-il. Il
est fort heureux que cette opinion, qui n'a d'ailleurs jamais eu que
peu de partisans, n'ait pas prévalu. Elle eût séparé définitivement les
chercheurs de l'Enseignement supérieur…/ Il faut sans aucun doute
développer la recherche technique redoutablement déficiente chez nous,
mais il ne faut pas que son développement ait priorité sur celui de la
recherche scientifique. Il ne faut pas qu'une politique stupidement
utilitaire prétende discriminer parmi les disciplines scientifiques,
celles qui sont rentables et celles qui ne le sont pas. Il ne faut pas,
enfin, que le contrôle nécessaire de ces activités de recherche soit
abandonné aux financiers ou aux économistes" (19). Pour ce faire,
le nouveau directeur entend s'appuyer le Comité national de la recherche
scientifique issu du CSRS d'avant-guerre. Mais comme ce dernier, son rôle principal sera de former et de suivre la carrière d'un
corps de chercheurs attachés au CNRS. En l'occurrence, le principal changement est d'ordre sémantique : "
le
nom de boursier ne nous plaît pas, avait dit Joliot,
(ils) deviendront
des 'attachés'. Les candidats chercheurs ne doivent pas avoir
l'impression qu'ils sollicitent une faveur, mais que leur rémunération
est la contrepartie d'une activité primordiale au point de vue national".
Une nomenclature calquée sur celle de la hiérarchie universitaire est
adoptée, attachés et chargés de recherche', 'maîtres' et
'directeurs de recherche', correspondant aux chargés de cours,
maîtres de conférence et professeurs de l'enseignement supérieur.
Teissier prévient que le comité national devra procéder à l’évaluation
des chercheurs, une disposition dont l'absence avait été déplorée
avant-guerre, la qualité hétérogène des huit cents premiers boursiers
du CNRS ayant nourri la critique : "
en
contrepartie du soutien que le CNRS accordera aux chercheurs, nous
avons la ferme intention de manifester envers eux moins de complaisance
que par le passé» prévient-il (20). Véritable parlement de la science
élu par la communauté académique,
le comité national est divisé en trente
sections correspondant à la nomenclature des chaires
universitaires. A partir des années 1950, il sera renouvelé tous les
quatre ans. Il se réunit deux fois par an, d’abord en session de
printemps pour examiner les candidatures et évaluer l'activité des
chercheurs, à l’automne pour l’affectation des moyens
budgétaires et du personnel d'ingénieurs, techniciens et administratif
(ITA) aux laboratoires. Compte tenu de ses
liens avec l'Enseignement supérieur décrits par Christophe Charle, l'
attaché de recherche sera souvent le thèsard d'un universitaire remarque Jean-Christophe Bourquin, c'est-à-dire souvent le patron du laboratoire auquel il est
attaché.
V - Les années 1950
Recherche & Développement
A la Libération, du fait de sa réorientation vers la recherche
fondamentale les relations d’Henri Longchambon avec le CNRS se sont
distendues. Commissaire de la République de la région Rhône-Alpes à la
succession d’Yves Farge, au printemps 1946 il est nommé
ministre du
Ravitaillement. Élu au Sénat l’année suivante pour représenter les
Français de l'étranger, il s’inscrit au groupe du Rassemblement des
gauches républicaines. Toujours professeur à l’université de Lyon, il
est
aussi administrateur d’une filiale de ‘Thann et Mulhouse’, une
entreprise chargée de l’extraction de titane. Sous l'influence du
modèle de développement importé des Etats-Unis par les missions de
productivité dépéchées outre-Atlantique, Il
participe avec Henri
Malcor, le patron de
l’’Institut de recherche de la sidérurgie’ (IRSID),
à la commission du deuxième Plan chargée de
la 'Recherche et Développement' (R&D), la nouvelle mantra de la reconstruction et de la modernisation du pays. «
Trop
souvent, on constate l'incompréhension mutuelle des savants et des
techniciens. Trop souvent dans notre pays, la pensée reste séparée de
l'action..../ Or, la recherche doit devenir un des facteurs non
négligeables de l'accroissement du revenu national. Il faut que savants
et techniciens redeviennent des exportateurs d'idées» (15). Mais ces prises de
position en faveur des relations recherche-industrie lui valent l’opprobre de ses collègues universitaires, tel le zoologiste
Marcel Prenant qui n'hésite pas à le qualifier "...
d’homme d'affaires
plus que professeur» (21).
Un sous-secrétariat d’Etat à la recherche scientifique et technique
Quand Pierre Mendès-France devient président du Conseil en juin 1954, il installe
un
secrétariat d'Etat à la Recherche dont, sur les
sur les conseils d’Henri
Laugier, qu'il confie à Henri Longchambon. Lors de l’inauguration du
centre de recherches de Péchiney, celui-ci précise ses intentions
: «
je suis prêt à aider les
entreprises à développer leurs recherches en assouplissant les règles
de la fonction publique, en permettant l'échange de personnel entre le
secteur public et le secteur privé, en définissant avec précision les
recherches d'intérêt national, en adoptant des textes fiscaux
permettant aux entreprises de consacrer une partie de leur
chiffre d'affaires à la recherche fondamentale»
(22). Si ce secrétariat
d’Etat dispose d’une délégation de pouvoirs
théorique sur les établissements publics de recherche, CNRS et autres,
en réalité ses
moyens
d’actions, notamment budgétaires, restent très limités. Afin de
pallier ce handicap, Lonchambon constitue un ‘Conseil supérieur de la
recherche scientifique et du progrès technique’ (CSRSPT), une
instance au rôle de lobbying non négligeable compte de la
présence de personnalités de renoms tels
Louis
Leprince-Ringuet, Louis Néel, Yves Rocard et Jean Wyart, les chimistes Charles
Sadron et Albert Kirmman ou l’historien
Lucien Febvre,
aux côtés de
grands patrons de l’industrie tels Léon Denivelle (Sté Potasse et
Engrais chimiques),
Alfred
Landucci
(Kodak-Pathé), l’actif responsable d’une commission chargée de
de la formation des ingénieurs de recherche, René Perrin (Ugine),
Maurice Ponte (Thomson-CSF) ou
Pierre Piganiol (Saint-Gobain) que deviendra un peu plus tard le premier délégué général à la recherche
scientifique et technique.
1956, le colloque de Caen et ses conséquences
L'idée d'un colloque sur l'université et la recherche naît de la
réunion de quelques grands scientifiques, politiquement proche
des milieux mendésistes, le mathématicien
André Lichnérowicz, les physicien
Alfred Kastler et
Edmond Bauer, les pasteuriens
Jacques Monod et
François Jacob, le professeur de médecine
Jean Dausset ainsi que l’ancien directeur du cabinet Mendès-France devenu le patron de la
Documentation française,
Jean-Louis Crémieux-Brilhac. En octobre 1956, le
discours inaugural de Mendès, auquel a contribué Monod,
évoque l’esprit de la recherche libre dans lequel est organisé cette
manifestation : "
la recherche
fondamentale, source de toute invention s'étiole, se réduit de jour en
jour. Il semble que les progrès décisifs accomplis après la
guerre, en physique nucléaire, en physiologie, en génétique, etc.,
l'aient été en dehors de nous…/ La priorité doit donc être donnée à la
recherche fondamentale, dont le cadre de développement principal doit
être l'Université qui est le substrat naturel d'une recherche libre,
spéculative et désintéressée"
(23). Telle est la position partagée
par Bauer, Monod et Lichnérowicz. Mais la pénurie de scientifiques dont
pâtit la France commande l’adoption d'un programme d'expansion
accompagné d'une profonde réorganisation universitaire qui pourrait, selon Monod, s’inspirer du
fonctionnement de leurs homologues nord-américaines. Par exemple, il
conviendrait de créer un corps d'enseignants-chercheurs facilitant le
passage en souplesse de l'université vers la recherche et vice versa. Or à Caen deux
thèses
s’opposent, dans un rapport où il propose la création
d’instituts dotés d’objectifs spécifiques,
le chimiste Charles Sadron dénonce le risque de faire de la recherche «
…une fonction mineure s'accomplissant à l'ombre de l'enseignement», ce à quoi le physicien Alfred Kastler réplique en arguant de son expérience passée : "
lorsque la recherche et
ses applications furent fondues dans le CNRS de 1939, ce le fut au
détriment de la science pure" (24). En définitive, le colloque se conclura sur le vœu que
la
recherche reste amarrée à l'Enseignement supérieur.
Le colloque de Caen a deux importantes conséquences. La première
concerne les facultés de médecine jusque-là engluées dans un
conformisme stérilisant. Le
rapport présenté par Robert Debré et Jean Dausset
suscite la réunion d’un comité interministériel qui aboutira à la
réforme hospitalo-universitaire de 1958, puis à
l'essor de la recherche médicale au sein d'un nouvel établissement public, l'Inserm. A l'inverse, en sciences, en lettres et en droit, l'unversité se trouve à la veille d'un
phénomène
de massification
qui compliquera ses relations avec le CNRS dont on note d'ailleurs
l'absence dans les débats de Caen. Son directeur, le physicien
Gaston Dupouy
méfiant vis-à-vis d'un Comité national qu'il juge dominé par les
universitaires, a décidé d'installer deux laboratoires propres sans requérir ses avis, celui
d’
optique électronique qu’il dirige à Toulouse et le
phytotron de Pierre Chouard.
La seconde conséquence du colloque concerne la professionnalisation de
la recherche avec l’apparition d’un syndicalisme spécifique. A la suite
d’une
scission au opérée au sein de la Fédération de l'Education nationale
(FEN) et du Syndicat national de l'Enseignement supérieur (SNES'up), le
'
Syndicat national des chercheurs
scientifiques' (SNCS) organisé par le pasteurien
Raymond Dedonder
obtient 63 des 69 sièges
à pourvoir au comité national élu en 1957. La constitution d'un corps
de chercheurs à côté de celui de l'enseignement supérieur est un
événement appelé à peser lourdement dans les relations entre la
recherche et l'université.
L'héritage de la IV° République
En contrepoint de Caen, Henri Longchambon organise à
Grenoble l’année suivante
un colloque ‘recherche et industrie’ pour
lequel il obtient le soutien financier de Raymond Cheradame, le
directeur du
Centre de recherche des charbonnages de France
(CERCHAR). A cette occasion, il rappelle que la production d’ingénieurs
est un élément essentiel du développement économique et social du pays
en citant l’exemple du ‘Massachusetts Institute of Technology’ «
…où
les étudiants sont recrutés sur tests, mais dont nul ne conteste qu'il
ne constitue l’une des meilleurs écoles d'ingénieurs du monde ».
L'idée
de soutenir la vocation de l'université pour la recherche est soutenue
par le 'Mouvement national pour le
développement scientifique' (MNDS). Le souci de Longchambon de ne pas laisser la formation des
ingénieurs aux seules grandes écoles se concrétise ainsi avec la création de
l’’Institut national des sciences appliquées’ (INSA) (25). L'INSA est implanté dans le quartier de la Doua à
Lyon grâce à l’intervention du Crédit lyonnais et une première promotion de trois cent
élèves est accueillie en novembre 1957. Dans le conseil
d’administration qu’il préside, Henri Longchambon accueille l’Ingénieur général Roger Schwob du ministère de
l'Industrie, Francis Closon (INSEE) et
Pierre Massé, le président
d’EDF et futur haut-commissaire au Plan.
En matière nucléaire, Longchambon a le même rôle de facilitateur que
celui qui fut sien aux débuts du CNRS. En tant que sénateur de la
République, avec le député Félix Gaillard il rapporte le budget de
développement du CEA en 1952. En parallèles avec
les recherches de bases menées au Commissariat, il se préoccupe d'équiper l’université d'accélérateurs de particules
et œuvre pour doter l’université d’Orsay d’un synchrocyclotron.
Également soucieux d’associer les industriels au développement de
l’énergie nucléaire, il organise en 1957 des journées d’études au
Conservatoire national des Arts et Métiers
auxquelles sont conviés les
représentants de Saint-Gobain et de l’Alsacienne de constructions
mécaniques (SACM), de Penhoët-Loire pour
la propulsion navale, de Péchiney et de Kuhlmann pour le traitement du
minerai d’uranium. A la demande d'EDF, la pile G1 du centre CEA
de Marcoule vient d'être dotée d'une installation de récupèration
d'énergie, un prototype de centrale électro-nucléaire (25b). Quelle a
été la position de Longchambon concernant l’arme atomique? Le dernier
dimanche de l’année 1954, en tant que secrétaire d'État à la
recherche, il a assisté au conseil
interministériel consacré à l'utilisation militaire de l'énergie atomique réuni par le président
Mendès-France (26). A la suite des décisions alors prises,
la première bombe
atomique explosera au Sahara six ans plus tard suscitant le «
Hourra pour la France ! »
du général de Gaulle (26 bis). En cette occasion Longchambon rappellera les
circonstances de ce conseil interministériel : «
en
1954, le gouvernement dont je faisais partie a délibérément orienté les
travaux de nos ingénieurs et de nos chercheurs vers la réalisation, par
des moyens français, de la bombe atomique, réalisation qui paraissait
devoir aboutir vers la fin des années cinquante. Il l'a fait
silencieusement, son désir étant que la situation internationale évolue
vers la suppression de cette arme et rende inutiles nos propres efforts
en ce sens. Mais son devoir était aussi de ne pas laisser notre pays
indéfiniment désarmé dans cette compétition où se complaisaient alors
trois autres pays » (27).
En 1957, dans le dernier rapport d’activité du Conseil supérieur de la
recherche scientifique et du progrès technique,
Henri Longchambon
annonce ce que devrait être une politique scientifique adaptée aux évolutions qu'il entrevoit : «
je suis
convaincu que la possibilité de découvrir des choses intéressantes ne
se rencontre plus du côté du chercheur isolé agissant seul. Elle est du
côté d’équipes suffisamment nombreuses pour combiner, grâce aux
caractéristiques individuelles de chacun, les diverses spécialités, les
diverses disciplines, les diverses techniques qui s’interpénètrent et
qui doivent collaborer pour multiplier les découvertes …/ Ce travail en
équipes demande que nous abattions les cloisons étanches qui existent
encore entre les diverses disciplines, entre la science fondamentale,
la science appliquée et la réalisation industrielle» (28). Malgré de réelles tensions budgétaires, l
e bilan de la IVème République est donc loin d'être négligeable en matière scientifique.
Nouvelle donne sous la V° République
Avec son installation, la V° République met
un terme aux fonctions d'Henri Longchambon, un personnage politiquement lié au
régime
précédent, mais dont l'influence demeure cruciale dans l'organisation
de la recherche comme en témoigne le physicien
Pierre Aigrain, l'un de ses nouveaux acteurs. Revenu aux affaires en 1958, le général de Gaulle a affirmé le souci de redonner
au pays les moyens de son indépendance, ce qui implique la relance
d’une politique scientifique plus dirigiste afin de répondre à l'"
ardente obligation"
inscrite au Vème Plan confié à
Pierre Massé.
L'un des premiers objectifs de la nouvelle République est la constitution d’une force
de frappe nucléaire avec ses appendices (conception des vecteurs, de
l'arme, de l'électronique nécessaire, etc.), lequel nécessite un gigantesque
effort pris en main par une ‘
Direction
de la recherche et des moyens d'essais’ (DRME)
en relation avec
le CEA. Pendant plusieurs décennies, l'effort budgétaire consenti au
profit du complexe militaro-industriel français reste l'équivalent de
celui consacré à la recherche
civile. Pour autant, celle-ci est loin d'être négligée, tant la recherche-développement apparait comme l'élément
incontournable du développement économique et du progrès social dans une pédiode qualifiée ultérieurement de
'trente glorieuses'. Solennellement réuni par le général de Gaulle au début de 1959, un
Comité des Sages
est est chargé de préparer la programmation d'un
dispositif public de la recherche. Présidé par Maurice Letort le directeur de la recherche aux
Charbonnages de France,
Pierre Aigrain y côtoie Maurice
Ponte, Pierre
Taranger du CEA, l'hématologue
Jean Bernard, le mathématicien
Paul Germain de
l’Académie des sciences, André Lichnérowicz du Collège de France,
Raymond Latarjet de l’Institut du radium, Charles Sadron et Felix
Trombe du CNRS ainsi que l’historien Louis Chevalier et le
géographe
René Dumont. En novembre, un décret officialise le comité des sages sous le nom de
‘Comité consultatif de la recherche
scientifique et technique’ (CCRST) (28b).
Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST)
Les moyens budgétaires nécessaires à cette politique
sont confiés à la
DGRST à
la tête de laquelle est nommé
Pierre Piganiol. A la suite d’une
manœuvre à la hussarde qui ne manque pas de surprendre Longchambon, Piganiol fait inscrire à la loi de Finances 1961
le budget civil de
recherche et de développement pour un montant d’un demi-milliard de
nouveaux francs, un effort sans précédent au profit de
la recherche scientifique relève
l’historien Antoine Prost
en évoquant un passe-passe administratif qui retire le budget de la recherche des mains de
l'enseignement supérieur (28c). Ainsi, la politique scientifique de la V° République vise le double
objectif pour lequel le CNRS a révélé ses insuffisances. Il s'agit de
désenclaver le dispositif de la recherche enserré dans sa relation avec
l'Enseignement supérieur, d'une part en développant des programmes
interdisciplinaires dans les secteurs émergeants comme le préconisait
André Mayer, d'autre part en privilégiant les relations de la recherche
avec l'industrie et plus généralement avec le monde économique comme le
prônait Henri Lonchambon. Pour ce faire, le CCRST et son
bras séculier, la
DGRST, disposent d’une
‘enveloppe-recherche’ conséquente (près de 0,5 MdF) destinée au
lancement d'‘actions concertées’. Sur les douze premières actions
lancées en 1959, cinq relèvent
des sciences de la vie :
'neurophysiologie et psycho-pharmacodynamie', 'nutrition',
'applications de la génétique', 'cancers et leucémies' et surtout
'
biologie moléculaire' dont le pilotage est
confié au pasteurien
Jacques Monod, lauréat du Nobel de médecine 1965 avec André Lwoff et François Jacob. En rapprochant la biologie et la chimie de la physique,
la DGRST joue ici un rôle crucial dans l'essor de la biologie moléculaire. Concernant l'autre volet de cette politique, en 1967
Alain Peyrefitte, le ministre chargé de la recherche évoque l’installation de nouveaux
organismes et la réorganisation de certains établissements historiques. Le
Centre national d'études spatiales (CNES) a été créé en
1961 pour participer à la conquête spatiale marquée
par lancement du ‘spoutnik’ russe quatre ans plus tôt. A la suite des
mécomptes d’un
'Plan calcul', l’informatique
bénéficie d’un '
Institut de recherche en informatique et automatique'
(INRIA) chargé de soutenir le développement d’une industrie française
du hardware (CII-Honeywell-Bull). Afin de regrouper l’ensemble des
activités halieutiques dispersées jusque-là entre différents organismes, dont le CNRS, est prise en charge par un
‘Centre national pour l'exploitation des océans’ (CNEXO) devenu ensuite '
Ifremer'. Des réorientations significatives sont demandées
aux organismes historiques. Ainsi, la réforme hospitalo-universitaire de 1958
n’ayant pas dégagé les moyens nécessaires à la recherche médicale,
la refonte de l’INH en ‘Institut national de la santé et de
la recherche médicale' s'opère en 1964 afin de soutenir l'essor de la
médecine moléculaire. Mais l
'interrogation se porte sur la place du CNRS dans cette recomposition du paysage scientifique français.
VI – Les années 1960, œcuménisme
scientifique au CNRS
Au printemps 1959 dès la mise
en place de cette politique scientifique, la question
s'est posée au CNRS : faut-il en faire un opérateur de recherche chargé
de définir ses propres objectifs scientifiques ou maintenir sa vocation
d'agence de moyens, de caisse des sciences en
relations avec l'Université? Pour son
nouveau directeur,
le
géophysicien Jean Coulomb, la réponse relève de la seconde option : «
indiscutablement,
les créations du CCRST et de la DGRST représentaient un tournant dans
l'idée qu'on pouvait se faire du rôle du CNRS. Il est clair que selon
la mission qui lui avait été confiée en 1939, l'organisme faisait
désormais double emploi avec la DGRST.... / Simultanément, l'idée du
président du comité des Sages était de créer un office des instituts
nationaux, c'est à dire rassembler toutes les recherches au sein d'un
organisme unique comme on l'avait fait pour la physique nucléaire avec
le CEA. Or, ce projet faisait peser des graves menaces sur le CNRS et
je m'y suis opposé
» (28d). Fort de l’appui des représentants
des chercheurs, en s'appuyant sur la vocation omnidisciplinaire du CNRS
et en misant sur des rivalités inter administratives, son nouveau directeur pare
à ce qu'il estime être une
menace de démantèlement. Pour ce faire, il peut s’appuyer sur André
Boulloche le
ministre de l’Education nationale qui ne souhaite pas se séparer de
l’organisme chargé de la recherche, d'ailleurs, le directeur des
Enseignements
supérieurs (L. Capdecomme) refuse de discuter de ses projets
d'équipement avec le CCRST. Le Premier ministre tranche en leur
faveur,
l'Education nationale vient de sauver le CNRS commente Antoine Prost. En contrepartie du soutien apporté à l'opération, le
Syndicat
national de la recherche scientifique (SNCS) obtient la satisfaction de
sa principale revendication, à savoir un
statut de la fonction publique pour les chercheurs. En
décembre 1959, six décrets portant sur la réorganisation du CNRS
stipule que les attachés et les chargés de recherche relèvent désormais
d’un régime contractuel de droit public, tandis que les maîtres et les
directeurs de recherche sont dotés d’un statut de fonctionnaire.
Ces dispositions confortent les pouvoirs du comité national où les
représentants du personnel obtiennent progressivement que la promotion
d’un attaché de recherche dans le corps des chargés soit quasi automatique, lors des débats en commission, il s'agira
de ".
..donner la priorité au personnel en n'émettant aucun vote qui puisse aller dans le sens d'un licenciement"
(29). En conséquence, les départs d’attachés de recherche, c'est-à-dire de boursiers en
fin de thèse qui représentaient
un flux de 10% dans les années 1950, décroissent pour se stabiliser aux
environs de 2% au début des années 1970. Soutenu par une forte hausse
des
moyens affectés au CNRS, les effectifs de chercheurs, ingénieurs,
techniciens et personnel administratif (ITA) triplent en l’espace de
dix ans, passant de 6000 en 1960 à 15000 agents en 1970. Essentiellement chargé de gérer les carrières scientifiques, son comité
national devient l'élément incontournable du fonctionnement du
CNRS en témoignent ses administrateurs,
Lucienne Plin,
Geneviève Niéva et
Charles Gabriel.
Le quant à soi universitaire
Paradoxalement, malgré une tutelle commune relevant
de l'Education nationale, les relations
restent tendues entre les universités et le CNRS, considéré
au mieux comme un prestataire de services par l'enseignement supérieur, au pire dénoncé pour sa volonté «...
de domestiquer les élites» (28b). De fait, l'organisme n'a pu se départir de l'ambiguité de sa
double mission de caisse des sciences censée soutenir la recherche
universitaire et d'opérateur de
recherche soucieux de développer ses propres laboratoires. En outre, l'installation
du
couple CCRST-DGRST ne fait que souligner la situation d'un organisme
qui a
"
perdu la rente de situation que lui offrait l’absence de concurrence
en matière de coordination de la recherche" et s'avère inapte à opérer le rapprochement voulu entre la recherche
fondamentale et la recherche-développement. Au début des années 1960, à la
question de
décider si les facultés des sciences doivent former des techniciens
pour l'industrie, l’assemblée des doyens fait savoir que "
la recherche
fondamentale ne saurait être sacrifiée au profit de la recherche
spatiale et de l’armement nucléaire"
(30). Lorsque
le
CCRST suggère de confier au comité national
le soin d’analyser la conjoncture scientifique, chaque section prend
soint de présenter
ses propres perspectives de développement, moyennant quoi
l'hétérogénéité du premier rapport de conjoncture publié en 1959 rend
problématique toute vélléité de redécoupage et le CNRS se voit contraint de saupoudrer ses crédits
entre la quarantaine de
commissions de son comité national. Reste que cette manière d’équipartition est conforté par les chercheurs, tel le Nobel Alfred
Kastler qui évoque «
…la nécessité de faire
avancer simultanément tous les fronts de la science"
(31). Cette pratique est soutenue sans réserve par le syndicat de
chercheurs, mais tandis que le SNCS appuie sa présence au Comité
national sur la primauté de la recherche fondamentale, du côté de
l'enseignement supérieur le SNES'up fustige le CNRS
qualifié «
de cancer qui finira par dévorer l'université"
(31 bis). En
février 1962,
les
pouvoirs publics soucieux de réduire cette antinomie lancent un audit
confié à un inspecteur général des Finances,
Jacques de Chalendar. Il s'agit
d’étudier les moyens de redonner du dynamisme à l'organisme historique,
tout en confirmant sa vocation à soutenir les
laboratoires de l'enseignement supérieur, quitte à en revoir les
modalités.
Départements scientifiques et laboratoires associés, la réforme de 1966
Le CNRS est ainsi convié à s'occuper
de toutes les disciplines, au moins de celles absentes dans les autres
organismes. En 1966 inspiré par ce rapport de l'inspection des
Finances, son directeur,
le physicien Pierre Jacquinot, l'engage dans les réformes requises. Une première mesure
consiste à renforcer l’administration en introduisant auprès du
directeur général l’assistance de directeurs administratifs issus du Conseil d’Etat, Claude Lasry puis
Pierre Creyssel. Une seconde mesure concerne
l’installation de six départements scientifiques censés épauler le direction générale. Celui de physique est
confiée à
Hubert Curien, celui des
sciences de la terre et de l’espace à Georges Jobert, la chimie à
Fernand Gallais, les sciences de la vie à
Claude Lévi et les sciences humaines et sociales au géographe
Pierre Monbeig et à l’économiste
Pierre Bauchet. Surtout, une importante mesure vise à réduire le nombre des
laboratoires propres (LP) du CNRS, dont certains devenus obsolescents, et à harmoniser la gestion de ceux
qui dépendent de l’Enseignement supérieur. Désormais, il est prévu que tous les
laboratoires soutenus par le CNRS seront soumis aux procédures
d’évaluation du comité national, les équipes relevant de l’Enseignement supérieur
devenant des ‘Laboratoires associés’ (LA), bientôt rejoints par des
‘Équipes de recherche associées’. Ce dispositif appelé à se généraliser donnera les 'unités
mixtes de recherche' (UMR) d'aujourd’hui. Mais en réalité remarque le physicien
Hubert Curien, ces dispositions se sont révélées plus profitable au CNRS qu’à
l’Université : «
si le système d'évaluation (du Comité national)
fonctionne bien en ce qui concerne les hommes, il est moins
satisfaisant pour les sujets de recherches ou le contenu des
programmes. Moyennant quoi les responsables du CNRS se sont de plus en
plus sentis les patrons des laboratoires universitaires. Dans les
conseils de laboratoire, quel était celui vers lequel on se tournait?
Ce n'était pas le représentant du président d'université, mais le
directeur scientifique du CNRS. Si le système a été profitable à la
recherche française, je n'en disconviens pas, il n'a certainement pas
aidé chaque université à prendre conscience qu'elle pourrait avoir une
politique scientifique ».
Excellences mathématiquesDomaine d'excellence traditionnel de la recherche française,
les mathématiques ont bénéficié en plein
d'un CNRS caisse des sciences. Au cours de l'entre-deux-guerres, l'Ecole normale supérieur et le
Groupe Bourbaki (J.
Delsarte, H.
Cartan, J. Dieudonné,...) ont constitué la première section
du Conseil supérieur de la recherche scientifique à l'initiative du
mathématicien
Emile Borel, puis des sections du comité national, au moins jusqu'en
1982 avec l'installation de l'Institut de physique 'IN2P3'.
A l'inverse
du modèle physicien gourmand en infrastructures lourdes et couteuses,
les moyens nécessaires à la recherche en mathématiques ne relèvent que de la
feuille et du
crayon. Jusque dans les années 1970, les mathématiciens
sont souvent des attachés de
recherche auxquels le CNRS a permis de soutenir une thèse, la
discipline ne représentant alors que 1% de ses effectifs et d'ailleurs
pas organisée en
laboratoires. A partir de 1975, l'organisme
entame une politique de rééquilibrage au profit des
mathématiques appliquées pour aboutir à une sédentarisation croissante
des mathématiciens au sein d'organismes tels l''Institut des hautes
études scientifiques' de Bures s/ Yvette créé en 1958 ou plus récemment
de l
''Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions' (INSMI). Signe du maintien au premier rang des mathématiques, le nombre de
médaillés Fields français place notre pays au deuxième
rang de ce palmarès, juste derrière les
Etats-Unis,
le dixième et dernier étant récompensé en 2022.
La physique et ses instituts
En revanche, alors que le CNRS avait été créé comme - et soit largement resté - une
entreprise de physiciens, la discipline a rapidement cherché à
s’affranchir de l’emprise du comité national pour installer ses nouveaux
instituts. Couvrant un ensemble de
recherches gourmandes en moyens lourds, la physique avait créé ses
premiers laboratoires propres, l'
Institut
d'astrophysique de Paris (IAP) ou
l'Observatoire de haute Provence
(OHP) ayant ouvert la marche dès l’avant-guerre. Dans les années 1950, le
développement de la radioastronomie suscite la construction
de la
station de Nançay. Au milieu des années 1960, le rapprochement entre
l’astrophysique et la géophysique conduit
l'astronome Jean-François Denisse à
installer un premier
'Institut national d'astrophysique et de
géophysique' (INAG), mais face aux craintes du comité national de
se trouver dépossédé de ses responsabilité, Denisse propose que les
sections
concernées forment le conseil scientifique de ce nouvel organisme.
L’INAG ultérieurement rebaptisé
‘Institut national des sciences de
l'univers’ (INSU) a pu développer ainsi des coopérations
internationales qui donneront par exemples le télescope franco-canadien de Hawaii et
plus tard l’’European Southern Laboratory’ au Chili (31 ter).
Réalisation exemplaire évoquée plus haut, à partir du ‘Laboratoire d'électrostatique et
de physique du métal’
(LEPM) qu’il avait installé pendant la guerre, le souci de disposer des
moyens nécessaires à la physique des solides a conduit Louis Néel
(nobélisé en 1970) à développer de manière autonome le
‘Centre d'études nucléaires de
Grenoble’ (CEN-G),
«
c'est l'époque où l'on commençait à parler de réacteurs
universitaires dédiés à la recherche et, en 1953-54 dit-il
, en
coopération avec le CEA on a construit la pile Mélusine pour étudier le
moment magnétique des atomes dans un réseau cristallin». Puis
en association avec la ‘Max Planck Gesellschaft’, l’université de
Grenoble et les industries électrotechniques locales, le ‘CEN-G’
accueille le réacteur à haut flux au sein de
l’Institut Laüe-Langevin,
une
première en matière de coopération franco-allemande,
appelée à intéresser les biologistes de l’'European Molecular
Biology Organization' (EMBO). Dans sa relation assez lâche avec le
CNRS, Néel s’est rapidement affranchi des contraintes statutaires posées par le
comité national. Au milieu des années 1960, il demande dans la
commission où il siège, si en guise d'orientation scientifique, ".
..il ne
suffirait pas simplement de donner la priorité aux sections où il y a
déjà les hommes" (32). En physique nucléaire enfin, le CNRS qui avait eu un rôle pionnier que l'on a dit, passe la
main en matière de recherche fondamentale au CEA et au
Centre européen de
recherches nucléaires’ (CERN), tandis qu'au début des années 1970, sous
l’impulsion
du CEA, les projets d'installations d’accélérateurs de
particules dans les campus universitaires (Grenoble, Orsay, Caen...)
suscite la mise en place de
l’
Institut national de physique nucléaire et de physique des
particules’ (IN2P3) (32b)
Les sciences pour l’ingénieur
Dans les années 1970, à la suite du
premier choc pétrolier l’’
Organisation de coopération et de
développement économique’ (OCDE) encourage le développement des
politiques scientifiques. A la direction du CNRS, le physicien
Robert Chabbal,
introduit le concept de
‘pilotage par l’aval’, autrement dit le développement d'axes de recherche suscités par le besoin de
progrès technique
. Chabbal lance des programmes
interdisciplinaires dont
le premier est consacré à l'énergie solaire
(PIRDES). Le CNRS réorganise son département de la physique en le
divisant en trois entités,
‘maths-physique’, ‘physique des particules’ et ‘sciences pour
l’ingénieur’ (SPI). Ce dernier département a vocation de rapprocher
la
recherche fondamentale des applications industrielles. Contrairement
aux programmes interdisciplinaires lancés par le CNRS dans ce domaine et qui n’ont eu qu’un succès
limité,
les ‘SPI’ marquent la réussite la plus notable du rapprochement entre les chercheurs et
l'industrie. Sous la direction
de
Jean Lagasse, le directeur du ‘laboratoire des automatismes et des
applications spatiales’ de Toulouse, les ‘SPI’ regroupent quatre
sections du comité national, ‘informatique’, ‘génie électrique’,
‘mécanique’ et ‘thermique’, pour féconder d’autres domaines de recherche, notamment dans les sciences de la vie (33).
Les sciences de la vie entre holisme et réductionnisme
Dans les sciences de la vie (SDV), les rapprochements
interdisciplinaires que permet le comité national peuvent s’apprécier
en termes quantitatifs. Ils sont illustrés par un transfert du centre de gravité
de la chimie vers la biologie, la proportion de chercheurs en SDV passe de 18 % en 1950 à plus de 30% en 1980,
corrélativement à la décroissance du nombre de chimistes de 26 à 18 %.
Il s'agit d’ailleurs souvent de chercheuses, puisque le département SDV
représente le secteur le plus féminisé du CNRS avec 50% de femmes à la fin des
1970, contre une moyenne de 20 % dans les autres (34). Sur un plan
qualitatif, l’évolution est plus nuancée entre une
approche holiste qui considére le vivant comme un ensemble divisé en espèces et le
réductionnisme qui s'appuie sur l'étude de ses molécules constitutives. Confronté aux pesanteurs
universitaires et au conservatisme du
Museum d'histoire naturelle,
le CNRS a manqué en partie le tournant de la biologie moléculaire, ne
réussissant
qu’imparfaitement à réduire les tensions entre les naturalistes et les
molécularistes désormais investis dans les arcanes d'une nouvelle
discipline, la biologie moléculaire. Au lendemain de la guerre,
il a
fallu l'influence du pasteurien André Lwoff pour obtenir l'ouverture
d'une section de biologie cellulaire au sein du comité national,
initialement refusée par les
naturalistes du Museum qui redoutaient la perte des moyens consacrés à
la botanique (35).
En réalité, la biologie moléculaire a
surtout bénéficié du soutien apporté par les actions concertées de la
DGRST.
L'Institut de biologie physico-chimique (cf. supra) a certes fini par
être intégré au CNRS, mais l'organisme dédié à la nouvelle
discipline est implanté à la faculté des sciences sous le nom
d’‘
Institut Jacques
Monod’ (U. Paris VI – VII). En revanche, le CNRS peut revendiquer des avancées réalisées en génétique.
A
l‘Institut de génétique’ installé sur le campus de Gif s/Yvette,
inspiré par les pasteuriens, dans les années 1950, le généticien Boris Ephrussi a
développé la génétique des micro-organismes à partir de mutations
réalisées sur la levure de boulangerie. La génétique de la levure
permet à son élève
Piotr Slonimski
de mettre en évidence les caractéristiques
d’une génétique cytoplasmique. Cette forme particulière de la génétique
est à l’origine d’un ensemble de laboratoires installés à partir de
1967 au
‘Centre de génétique moléculaire’ de Gif s/Yvette (34b).
Pour
autant, dans les années 1980, le développement des biotechnologies, génie génétique,
protéomique, se heurte aux réticences de Piotr Slonimski son directeur, hostile par principe aux applications de la génétique moléculaire.
La recherche bio-médicale
Pourtant, dès 1938 le CNRS avait participé au développement de la
recherche médicale et pharmacologique avec une section de
‘médecine expérimentale’ introduite au Conseil supérieur de
la recherche par
le doyen Gustave Roussy.
L’après-guerre a vu s'installer les laboratoires de cliniciens soucieux
de développer la recherche médicale qui s’adressent au CNRS plutôt qu’à
l’Institut national d'hygiène, un organisme alors dépourvu de moyens.
C'est le cas de l’hématologue
Jean Bernard qui ouvre le
Centre Hayem de l’hôpital Saint-Louis, Dans
les années 1960, la recherche pharmacodynamique est introduite sur le
campus de Gif s/Yvette par le biochimiste
Edgar Lederer avec l’
’Institut de chimie des substances
naturelles’ (ICSN). Son successeur Pierre
Potier y découvre une molécule anti-cancéreuse particulièrement
efficace. Malgré les réticences de certains biologistes comme
Pierre Chambon qui estime que "
la biologie a plus fait pour la médecine que la médecine elle-même" (36),
Le développement de l’internat scientifique suscite le doublement
des effectifs de médecins chercheurs au CNRS, provoquant le dédoublement
de le section médicale du comité national (pathologie et
thérapeutique expérimentale). Inspiré par le modèle de l'IBPC, le CNRS participe en
partenariat avec d'autres à la construction de grands établissements comme le
Centre d’immunologie de
Marseille-Luminy (CIML) où
François Kourilsky lance ‘Immunotech’,
l’une des premières ‘startups’ destinée à la fabrication d’antigènes
monoclonaux,
l'Institut Cochin de génétique moléculaire (ICGM) de Jean-Paul Lévy, voire
l’'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC)' de Pierre Chambon à Strasbourg. Mais dans les années 1980, cette
politique se heurte au
souci de
Philippe Lazar, le directeur de l'Inserm, de
s'assurer l'exclusivité de la recherche médicale et en santé publique en les appelant à voler de leurs propres ailes.
Les 'SHS' entre recherche et université
Les humanités ont été introduites au CNRS dès sa création, par exemple la philologie avec
le ‘Trésor de la langue française’,
non sans soulever par ailleurs certains sarcasmes du côté des sciences expérimentales. Tandis que
Jean Perrin s'interrogeait sur la scientificité des études juridiques dès l'avant-guerre,
A la Libération, Joliot demande à son comité directeur "
…si le CNRS n’en viendra pas à subventionner des romans" (37).
Dans les années 1950, le mathématicien Laurent Schwartz s'étonne de
voir seulement 150 bourses proposées en mathématiques et en astronomie,
contre 70 en paléontologie, 40 en anthropologie et 80 en philosophie.
Il reste que le CNRS a permis l'institutionnalisation d'un certain
nombre de disciplines, pas ou peu représentées à l'université. Depuis
1942,
l'archéologie dispose de deux sections ouvertes par
Jérôme
Carcopino ou la sociologie qui bénéficie de l’installation en 1946 du
‘Centre d'études sociologiques’ (CES),
avant que les sociologues
n’émigrent une vingtaine d’années plus tard vers l'École des hautes
études en sciences sociales (EHESS).
Néanmoins, le CNRS n'a pas
réussi à gommer certaines rivalités académiques, par exemple
dans le
cas de la 'philologie - linguistique' représentées par une unique
section en 1945 et par pas moins de quatre sections différentes dix ans
plus tard. Au début des années 1980, les demandes des pouvoirs publics conduisent le CNRS à regrouper l'ensemble des sections
concernées au sein d'un
département des
sciences humaines et sociales (SHS).
Inspirées des actions concertées
de la DGRST, les 'actions thématiques programmées' (ATP) des années
1970 voient se multiplier les équipes de recherche associées (ERA),
par exemple pour développer la sociologie urbaine ou la
socio-économie de la santé.
Le département des SHS a également profité de son rapprochement avec
son
homologue des sciences pour l'ingénieur (SPI) pour développer des
systèmes d’informatique documentaire
ou des techniques de traduction
automatique. Dans les années 1970, le secteur des SHS représente ainsi
environ un quart des effectifs du CNRS. La sociologie fortifiée par
l’intégration d'un
personnel hors-statut,
essaime dans quatre sections du comité national (34, 35, 38 et 45),
moins semble-t-il parfois en fonction d'une méthodologie bien
établie que de l'imprégnation idéologique de la discipline. De
fait, le
secteur des SHS est
probablement resté plus vulnérable que d'autres dans un organisme
partagé entre sa double vocation de caisse et d'institut. Le
regroupement des sciences sociales et des sciences
humaines, ne s'est par exemple jamais opéré dans
l'Enseignement supérieur comme le montre l'autonomisation
de la VIème section de l'Ecole pratique des hautes études (EFHE) pour
aboutir en 1975 à l'installation de
l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). En fait,
le département SHS du CNRS n'a cessé d'osciller entre une présence justifiée par la vocation multidisciplinaire de
l'organisme tutélaire et les pratiques de recherches individuelles
propres à la thèse
universitaire (37b).
VII - Le CNRS fin de siècle, le Comité national sur la
sellette
Dans les années 1970, le souci de muscler
la direction du CNRS se
heurte aux réticences du Comité national. A l'automne 1968, si
Pierre Jacquinot peut se
targuer d’avoir fait échapper le CNRS aux dispositions de la loi Edgar
Faure en rappelant que l’organisme n’a
pas de fonctions d’enseignement, les relations deviennent houleuses
entre les directions scientifiques soucieuses de piloter la recherche
et le comité national
devenu un solide bastion du pouvoir syndical.
Raymond
Dedonder l’un des fondateurs du Syndicat national des chercheurs
scientifiques déplore cette évolution corporatiste : «
les
gens qui ont créé le SNCS se sont battus au départ, non seulement pour
améliorer les conditions de carrière, mais aussi pour promouvoir le
CNRS en tant qu'institution scientifique à part entière. Après 1968,
quand il a été pris en main par une nouvelle tendance que l'on pourrait
qualifier de gauchiste, il a été décidé de donner la priorité à la
défense des chercheurs et non à celle du CNRS».
Agence d'objectifs ou de moyens?
Cette dérive est fustigée par le conseil d'Etat. En
1972, le rapport Antoine Bernard révèle comment «
…l'usage s'étant
établi d'entériner la quasi-totalité de ses avis en matière de
recrutement, c'est un tiers du budget CNRS qui échappe, de fait, à
toute politique scientifique
» (38). De fait, le comité national a la main
sur une masse salariale qui ne descendra jamais au-dessous des deux
tiers de son budget de fonctionnement pour atteindre les neuf
dixièmes au début des années 1980. D’autre part, la multiplication du
nombre de sections souvent liées à des chaires universitaires provoque
la balkanisation du comité national avec les risques que celle-ci fait
peser sur l’interdisciplinarité. A cet égard, la
disparition des programmes interdisciplinaires (PIR), comme le déclin
des actions thématiques programmées (ATP) est symptomatique.
Dénoncées par la communauté scientifique, ces dernières ont subi un déclassement par rapport aux
fonctions qui leur avaient été dévolues; la section de biologie
cellulaire évoque le fait que "…
toute forme de programmation n'aboutisse à la ‘médiocratisation’ de la recherche"
(automne 1978). Deux ans après leur lancement, le contrôleur financier du
CNRS déplore que les ‘ATP’ soient utilisées comme une soudure
financière, servant surtout à compléter la dotation régulière des
laboratoires; " (
elles) n’ont jamais vraiment fait souche au CNRS regrette
Robert Chabbal.
Alors
que l'ambition initiale était de leur confier la moitié du budget
d'équipement du CNRS, les ATP n'en ont au mieux mobilisé que le dixième".
En fait, s'il a contribué à stabiliser une profession, le statut des
chercheurs a fini par confronter le
CNRS à une contradiction majeure. Leur évaluation
par les sections du comité national, le jugement par les pairs, est
coincé entre les nécessités du suivi de carrières dans la fontion
publique, l'avancement à l'ancienneté, et les rigueurs d’une
évaluation indispensable à la dynamique de la recherche scientifique.
En réalité, le souci d'interdisiplinarité préconisé en son temps par
André Mayer n'a pu s'affranchir du carcan des chaires universitaires
représentées au comité national. Autrement dit, les efforts réalisés
dans les années 1970 en vue de renforcer les capacités de pilotage
scientifique du CNRS se sont heurtés à la vocation de caisse des
sciences qui avait prévalu à son origine. En matière de gestion,
les archives révèlent la multiplication des débats
entre des élus
syndicaux qui défendant "…
des chercheurs qui n'ont pas démérité" et des
responsables d'unités qui déplorent de passer plus de temps "…
à
résoudre le cas de chercheurs à problèmes"
qu'à évaluer la performance des plus inventifs (36). De même, en
matière de recrutement, l’instauration d’un fléchage des postes censé
couper court aux laborieuses discussions entre les départements du CNRS
et le comité
national, est dénoncé comme un viol de ses prérogatives
par la commission de biologie des interactions cellulaires, tandis que le pasteurien
François Gros fustige une pratique qui "
stérilise l'humus (sic)
indispensable à la recherche
fondamentale"
(39). Mais ces dysfonctionnements expliquent le vieillissement de la
pyramide des âges au CNRS. La moyenne qui voisinait la trentaine
au début des années 1960 dépasse la cinquantaine une vingtaine d’années
plus tard, moyennant quoi dans les capacités de recrutement pâtissent
de
l'indisponibilité de postes frais nécessaires à la bonne marche d'un
organisme scientifique. Pour remédier à cette situation, un
programme destiné à réformer le CNRS est soumis au conseil d'Etat en 1979, mais l'arrivée de la Gauche aux affaires modifie le contexte politique.
Le chant du cygne du Comité national
Avec l’élection de François
Mitterrand en 1981, l’arrivée aux responsabilités d’une génération de
chercheurs actifs dans le mouvement de soixante-huit avivent la
mémoire du Front populaire qui avait vu naitre le CNRS. Au comité
national les représentants syndicaux se présentent en garants des mânes
de Jean Perrin : "
les membres du syndicat national des chercheurs
sont tous des scientifiques qui luttent pour la recherche, parce que
précisément l'excellence ne peut en être assurée que dans le respect de
ceux qui la font, des lois propres au développement scientifique et des
besoins de la nation entière". Moyennant quoi, le SNCS réclame et
obtient la tête des directeurs du CNRS,
Jacques Ducuing, et de
l'Inserm,
Philippe Laudat, qu’il tient pour responsables d'avoir pliés
les organismes publics au cours de la décennie précédente ".
..aux
objectifs du gouvernement Giscard-Barre, c'est-à-dire aux intérêts des
grands trusts privés et aux impératifs idéologiques du conservatisme" (40).
Jean-Pierre Chevénement nommé ministre de la Recherche et de la
Technologie obtient la tutelle du CNRS qui se retrouve ipso facto
détaché de l'Education nationale. A l'écoute des
revendications syndicales, le ministre confie à François Gros et à
Philippe Lazar de l'Inserm
le soin d’organiser des assises
de la recherche au cours desquelles ce dernier évoque les
«
…trois dissociations des métiers de la recherche entre formation
initiale et fonction, entre fonction et carrière /.../ enfin entre la
carrière et les responsabilités vis-à-vis de la Société » (41).
Le comité national est remanié, grâce à une dotation en forte hausse de 17%
(20 MdF), la loi d’orientation du 15 juillet 1982 donne au CNRS le
statut d’Établissements publics scientifiques et techniques (EPST) et
parachève la fonctionnarisation de son personnel. Rendant
compte de ces événements, le chroniqueur scientifique du journal
‘Le Monde’, Maurice Avonny, s'étonne de la contradiction inhérente à la
volonté ministérielle de rapprocher la recherche de préoccupations
économiques du souci affiché de défendre le statut des chercheurs soi-disant attachés à
la défense de la recherche fondamentale : "
...de la
priorité donnée à la question des besoins des chercheurs (plutôt que)
de ceux auxquels ils doivent répondre, davantage de leurs droits que de
leurs devoirs et surtout de l'accent mis sur la recherche fondamentale,
(qui) ni en volume, ni en nombre d'hommes, ni en utilité pratique, ni
peut-être en valeur culturelle, n'est supérieure aux autres.../ (Mais
qui) reste la référence par rapport à laquelle on raisonne (et qui) est
un peu trop l'arbre qui cache la forêt, (tant) le mythe du chercheur,
individualiste, spécialisé dans un étroit domaine où il est candidat au
prix Nobel reste enfoui dans bien des subconscients"
(42). Or la conjoncture s'inverse en 1986 et un changement de
majorité ramène la droite au pouvoir, provoquant le
chant du cygne d'un comité national incapable d'harmoniser les
relations de la recherche et de
l'enseignement supérieur. Dans le gouvernement Chirac,
l'historien Yves Durand
part en
guerre contre l’emprise du syndicalisme de gauche en reprenant la dénonciation de
"
l'impérialisme du CNRS vis-à-vis de la recherche universitaire".
L’’Union
nationale inter universitaire' (UNI) réclame la suppression du CNRS et
le versement des moyens qui lui sont attribués à l'enseignement
supérieur.
A la suite d'une saisine du conseil d'Etat, les élections du
comité
national sont annulées. Mais,
défendue
par le ministre de la Recherche Alain
Devaquet la direction du CNRS sort renforcée de cette crise; un comité exécutif renforce les
directions scientifiques et le nombre des sections du comité national est réduit, tandis que les
représentants syndicaux sont désormais exclus de son organisation
électorale.
Evolution de la conjoncture scientifique
En cette fin de vingtième siècle les
activités scientifiques ont profondément changé de nature par rapport
aux grandes heures du CNRS, un demi-siècle plus tôt. Ainsi, le clivage entre la recherche
fondamentale et ses applications sur lequel le comité national avait
bâti sa légitimité n’a guère facilité l’adaptation à l'espace
technico-scientifique dans
lequel l'organisme doit maintenant évoluer. Des économistes y voient
le principal défi posé aux sociétés postindustrielles. Désormais "
...il est peu de
découvertes scientifiques qui ne se monnaient presque aussitôt en
spectaculaires retombées technologiques écrit
l’épistémologue
Jean-Pierre Séris,
peu de découvertes scientifiques qui n’empruntent à une technologie
leurs conditions mêmes de possibilité. L’opposition grecque entre une
'épistémè' contemplative, désintéressée et une 'technè' utilitaire,
active, débrouillarde et pratique ne nous parle plus; seule la nature
de cette liaison pose aujourd'hui problème.../ La science ne se
contente plus d'observer le réel, elle l'utilise, le modifie,
l'enrichit et la technique produit des outils qui permettent de savoir
plus et mieux"
(43). Selon les disciplines, le CNRS subit cette évolution avec plus ou
moins de bonheur. A la suite de la physique et de la chimie, les
sciences de la
vie ont ainsi vu la recherche glisser
vers des
applications sans
cesse plus immédiates, en médecine, en agronomie, etc., ce qui ne manque pas de provoquer des tensions auprès de
chercheurs arcboutés sur une vision
philosophique de la scien
ce. En l'occurrence, le cas du programme
génome humain est exemplaire. Le CNRS n'a pu rapprocher la biologie
moléculaire de la recherche médicale comme l'atteste son absence au
sein du 'Human Genome Program' (HGP) lancé
aux Etats-Unis. Suite à
l'initiative d'une
association de malades (AFM) et d'une fondation de droit privé, le CEPH du pr. Dausset, le ministre
de la recherche Hubert Curien a lancé au début des années 1990 un
‘Groupement de recherches et d'étude des génomes’ (GREG) dont la
responsabilité est confiée à
Piotr Slonimski. Or, l'ancien directeur du Centre de génétique moléculaire du CNRS
n'a
jamais caché son hostilité à toute forme de
recherche finalisée.
Aussi, a-t'il refusé de collaborer avec Jim Watson venu solliciter sa participation
au ‘HGP’. Le GREG a donc saupoudré ses crédits
pour le
séquençage de micro-organismes (levures, E. Coli, Bacillus subtilis) refusant de donner une priorité quelconque à la recherche
médicale, génotypage à la recherche de l'origine des maladies rares, vecteurs pour génothérapies,
etc. En conséquence,
après deux ans d'existence ce groupement de labos doit céder la place au Génopole
d’Évry, un incubateur de 'start'ups' dirigé par
Pierre Tambourin, lequel avait d'ailleurs quitté la direction des SDV après que son directeur-général, le physicien
Guy
Aubert, lui ait signifié "..
.que les biotechnologies n'étaient pas
l'affaire du CNRS", signifiant ainsi l'impasse de relations industrielles pré
conisées par Long
chambon quelques décennies plus tôt.
VIII - Les années 2000,
recherche et enseignement supérieur
Le début du nouveau siècle
voit le
décalage s'accentuer entre l'évolution de la conjoncture scientifique
et l'intangibilité revandiquée des métiers de la recherche.
En
2002, Olivier
Postel-Vinay rédacteur en chef de la revue 'La Recherche' provoque des remous dans la communauté scientifique lorsqu'il explique le manque de productivité scientifique de l'hexagone par
des procédures de
recrutement qui rendent problématique l'évaluation de chercheurs fonctionnaires (44). Laurence Esterle,
la directrice de l'Observatoire
des sciences et des techniques (OST) note que la thèse semble plutot
sanctionner l'obtention d'un statut professionnel que comme la reconnaissance
d'un travail original : "en SDV et en SHS, le
Graal des thésards reste la recherche publique, mais en ajoutant que
pour une place d'enseignant-chercheur en biologie moléculaire ou en
biochimie, c'est un raz de marée de 56 candidats".
Incidemment on note que les métiers de la recherche attirent moins
qu'auparavant dans les sciences dures, un rapport de l’Education nationale pointe la
décroissance du nombre de thèses en sciences exactes soutenues en cinq
ans, moins 20 % en chimie et en physique et moins 12 % en mathématiques
(45)
'Sauvons la recherche'
En mars 2003 l
e mouvement ‘Sauvons la recherche’ (SLR)
relayé par une partie de la communauté scientifique suscite une mobilisation de grande ampleur. Plus
d’un millier de responsables de laboratoire veulent démissionner, le comité national se réunit en
session extraordinaire en vue de débattre des problèmes de l'emploi
scientifique. ‘SLR’ annonce la préparation d’états-généraux pour l’année suivante annonce un
leader du mouvement, Alain Trautmann (CNRS-ICGM), pour lequel la défense du statut des
chercheurs implique l’intangibilité d’un service public de la recherche. « La
connaissance scientifique est un bien public dont l'Etat est le
principal promoteur et le seul garant, (contre) ceux qui
souhaitent l'asservissement de la recherche aux besoins de l'économie,
ceux qui pensent que souplesse rime avec précarité (et) restent sourds
aux appels des jeunes chercheurs». Concernant l’éventualité
du rapprochement souhaité de la recherche et de l’université voire du secteur privé, 'SLR' suggère «la
création de pôles de recherche et d'enseignement supérieur qui
associeraient universités, recherche publique et recherche privée avec
l’adoption d’un plan pluriannuel pour l'emploi scientifique permettant
de recruter de jeunes doctorants sur des poste stable .../ En effet dit Trautmann, "il existe des pans entiers de la recherche qui ne sont
absolument pas programmables,
en 1970 le président Nixon a lancé un plan cancer qui a coûté plus cher
que la conquête de la Lune et qui n'a évidemment pas résolu le
problème. Pour illustrer le fait qu'un certain type de programmation
est stupide, je dirais que ce n'est pas en voulant améliorer la bougie
qu'on a inventé l'électricité". Selon 'SLR', deux secteurs se retrouvent
particulièrement menacés : « si la révolte des chercheurs est partie du
secteur de la biologie, ce n'est pas un hasard.
La différence entre les moyens de ce secteur et ceux dont disposent nos
collègues américains est énorme. Le budget des National Institute of
Health est actuellement cinquante fois celui de l'Inserm. Cela dit, la
biologie n'est pas la seule à souffrir et le secteur des sciences de
l'homme et de la société est également très mal en point » (46).
Le cas des enseignants-chercheurs
En contrepoint, quatre personnalités
scientifiques de premier rang, les Nobel François Jacob et Jean-Marie
Lehn, le mathématicien Pierre-Louis Lions
dressent le constat sans complaisance de l'échec du statut d’enseignant-chercheur
tel qu'inscrit dans la loi de 1984 (cf. supra). «En
dépit d'énormes efforts, toutes les universités françaises n'ont pas
absorbé le choc de la massification de l'Enseignement supérieur. (...)
Trop souvent, les conditions de travail des enseignants, surchargés non
seulement de cours, mais de tâches ancillaires de tous ordres, sont
pénibles et dissuasives vis-à-vis des jeunes qui voudraient entrer dans
la carrière scientifique.../ A
l'évidence, il ne sera pas possible d'augmenter significativement les
salaires sans maintenir constant, voire diminuer transitoirement, le
nombre des chercheurs. La question est déplaisante, mais ne peut être
éludée. Voulons-vous un système diffus constitué d'une pléiade de
chercheurs mal payés, ou un dispositif plus concentré, forcément plus
élitaire, dans lequel les chercheurs sont mieux payés et plus
performants?»(47). A l’Académie des sciences où l'on ne manque pas de relever la perte
d’influence du comité national, on plaide pour un rapprochement entre
universitaires et chercheurs qui pourrait déboucher sur un statut
unique à la condition «qu’il soit porté remède à
l'hétérogénéité du monde universitaire où 75 % des crédits abondés par
le CNRS ne concernent que 15 % des universités». L’Académie
souligne que sur les quatre vingt huit universités installées par la
loi Edgar
Faure en 1968, seule une douzaine sont
réellement performantes en matière de recherche. Reprenant une
suggestion du mouvement 'SLR', elle préconise l’installation de campus scientifiques
centrés "si possible"
(sic) sur les universités, sur les grandes écoles
et les
établissements publics" (48). Nonobstant, lors
de la conclusion des états-généraux de la recherche fin 2004, les propositions
de 'SLR' présentées par Alain Trautmann et Edouard Brézin, un
ancien président du CNRS, reçoivent le soutien de la classe
politique,
de Nicolas Sarkozy à l’UMP à Marie-Georges Buffet pour le PCF en
passant par François Hollande chez les socialistes.
Malentendu au CNRS
A
l'occasion d'une valse de dirigeants, le CNRS est le théâtre d'un véritable quiproquo. Passée les
tentatives de réformes universitaires envisagées par
Claude Allègre, en 2003 le directeur de cabinet de la
ministre de la Recherche
Claudie Haigneré,
Bernard Bigot procéde au remplacement de
Geneviève
Berger par
Bernard Larrouturou à la tête du CNRS. X-Ponts et docteur en
mathématique, venu de de
l'Institut national de recherche en informatique et en automatique
(INRIA), assuré du soutien de Gérard Mégie
le président du Centre, Larrouturou semble apporter toutes les
garanties pour lui insuffler une dynamique nouvelle. Il a l'intention
d’amener le CNRS qui cumulait les fonctions d'agence de
moyens et d'opérateur de recherche à se recentrer sur cette dernière.
Ce faisant, il exprime ses réticences vis-à-vis d'un éventuel
rapprochement avec
l’enseignement supérieur : "
j'ai
la conviction que l'avenir de la recherche française passe par le
développement des universités dit-il,
mais la plupart d'entre elles ne
sont pas en mesure de mener une politique scientifique affirmée pour se
hisser au meilleur niveau international"
(49). Afin de
remédier aux faiblesses d’un comité national excessivement
cloisonné, il envisage de créer à la direction du CNRS quatre
départements thématiques,
deux départements transversaux, ainsi que de cinq directions
interrégionales, tout en disposant en plus d'une
direction de la stratégie scientifique. Trois ans plus tard, sa démission signe l’échec de cette tentative de
réorganisation : "
la
réticulation administrative excessive ne semble pas la meilleure
manière de répondre aux défis scientifiques qui attendent
l’établissement" relève le nouveau président du CNRS, Bernard Meunier. A l'inverse, surpris par l'événement, Larrouturou dénonce un
putsch provoqué par la
volonté de l’éliminer afin de laisser place nette à une future agen
ce
nationale de la recherche : "
on
m'a expliqué en haut lieu que le CNRS est le bateau-amiral de la
recherche française et qu'il est donc placé sous les ordres de l'Élysée
dès qu'il quitte le port. Je m'inscris en faux avec cette
vision dit-il.
L'autonomie des établissements et la responsabilisation de
leurs dirigeants sont des éléments-clés de leur dynamisme" (50).
Rapprocher la recherche et l'enseignement supérieur
Au début du nouveau siècle, la question du rapprochement de la recherche et de l'enseignement supérieur reste donc en suspens. En 2004, le
gouvernement Raffarin présente aux représentants des
états-généraux et des
milieux académiques les grandes lignes d'une nouvelle loi d'orientation portant notamment sur les perspectives de l'emploi scientifique. "Mais on ne peut pas
balayer l'histoire d'un revers de manche explique François D'aubert, le ministre chargé de la recherche. En
France, les grands
organismes comme le CNRS jouent un rôle prépondérant dans la recherche
et nous n'allons pas bouleverser cette architecture. Quant à un statut
unique pour les chercheurs des organismes et les enseignants-chercheurs
universitaires, le système n'est pas mûr aujourd'hui ".
En revanche, le ministre insiste sur le rôle à venir d'une agence nationale de la
recherche qui couvrirait l’ensemble
des activités scientifiques menées dans les établissements publics et
dans l'enseignement supérieur. Mais lorsqu'il annonçe le lancement d'un appel
d'offres pour l'installation de 'pôles de recherche et d'Enseignement
supérieur'
(PRES) destinés à fédérer les laboratoires des organismes avec ceux des universités et des grandes écoles, il suscite quelque émoi dans la communauté scientifique. "Je
ne suis pas favorable à une obligation systématique d'enseignement
pour les chercheurs des organismes dit Edouard Brézin, "il est parfois nécessaire de se
consacrer entièrement à une recherche pour la mener à bien. En
revanche, des carrières au cours desquelles un chercheur ne se
retrouverait jamais face à des étudiants doivent rester l'exception,
dans l'intérêt même de la recherche.../ Ceux qui pensent sauver
l'Université en tuant le CNRS ont une
méconnaissance profonde des qualités et des défauts de notre système.
Que l'on y prenne garde ! On n'aboutirait ainsi qu'à un champ de
ruines, sans espoir de rien voir refleurir pendant des décennies" (51).
Confrontés aux projets du gouvernement, les chercheurs s’estiment
"roulés dans la farine" et demandent aux pouvoirs publics de revoir la copie. Axel Kahn le directeur de l’Institut Cochin, signe
une tribune collective dans 'Le Monde' où il évoque "...le magnifique élan d'une
collectivité fière et blessée (sic), égarée par la fausse route où
l’engage le gouvernement". Du côté de 'SLR', tout en
reconnaissant certaines avancées dues à la mobilisation des chercheurs,
plus réaliste Alain Trautmann prend acte en 2006 de l’essoufflement du
mouvement et peut-être aussi de certaines limites de la démocratie scientifique. "Le temps a joué contre
nous et a en tout cas a abouti à démobiliser partiellement les
chercheurs…/ Certains, au sein de SLR, considèrent que nous aurions dû
rechercher l'épreuve de force avec le pouvoir plutôt que la discussion.
Je crois, pour ma part, que nous n'avions ni les forces, ni l'élan
nécessaires pour en sortir victorieusement " (52).
L’Agence nationale et la contractualisation de la recherche
En fait, les modalités de cette loi d'orientation ont été élaborées au ministère de la
Recherche en toute
discrétion par Bernard Bigot et Gilles Bloch du Commissariat à
l'énergie atomique (CEA). Cet organisme dispose en effet d'une
pratique établie des relations science - industrie et présente de ce fait
un modèle pour réorganiser la recherche publique. Outre la disposition d’une chaine de décision efficace, le pr. André Syrota, l'ancien responsable du département des sciences du vivant au CEA,
avance que « l’un
des gages des succès du Commissariat s'inscrit dans une perspective qui
permettait de rapprocher les aspects technologiques des ingénieurs des
approches plus fondamentales des chercheurs"; autrement dit, de réduire
le clivage entre la recherche de base et ses applications qui a pénalisé le fonctionnement du CNRS. Le
ministère de la Recherche confie à Gille Bloch le soin d’installer l’Agence nationale de la
recherche (ANR). Dotée d’un budget de plus d'un demi milliard d'euros inscrit dans la loi de
Finances 2006, l’ANR a fait une entrée en force dans le paysage scientifique
français titre 'Le Monde'.
L’Etat y est majoritaire (52 %) au côté des EPST, chacun à
auteur de 6%, CEA, CNRS, INRA (agronomie), INRIA (informatique),
Inserm, ACPUR (banques, assurances), ANRT et ANVAR pour la valorisation
et la recherche technique. Trois thématiques
prioritaires y sont fixées dans une perspective multi-disciplinaire
de partenariat public - privé : la recherche biomédicale et les
sciences
du vivant, les sciences et technologies de l'information et de la
communication, l'énergie et le développement durable. L'Agence dispose
en outre de 80 M€ pour soutenir des projets non finalisés touchant à
des
sujets émergents et de 10 M€ pour les SHS. La
contractualisation devient le maitre mot de la de la
recherche publique. En soutenant l'usage de contrats à durée
indéterminèe, l’ANR prend le contre-pied de la
fonctionnarisation des chercheurs revendiquée par les
syndicats et marginalise le rôle du CNRS. L'Agence soutient
des projets de recherche à l’issue d’une évaluation effectuée a priori
et affecte ses dotations en fonction de labels
de qualité (LaBex, Idex). Dans le
cadre des programme d'investissement d'avenir (PIA) confiés à l'ANR,
les PRES cèdent la place à des ‘Communautés d'universités et
d’établissements de recherche’ (COMUE) dont une première mouture en
2010 concerne le campus de Paris-Saclay.
Evolution de l'évaluation
Contronté au déclin du comité national évoqué ci-dessus,
le besoin d'évaluation inhérent à toute politique scientifique
nécessite une réforme en profondeur. Dès les années 1990, la
'Direction de la recherche et de l'enseignement doctoral' (DRED) envisageait de coupler la recherche et l'enseignement supérieur ce qui aboutit à l'installation d'un
‘Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur’ (HCERES).
Les modalités de l'évaluation scientifique se sont d'ailleurs déplacées
du
niveau individuel
des chercheurs, tel que la pratiquait essentiellement le comité
national évoqué ci-dessus, à celui d'entités collectives, laboratoires,
instituts, voire d'ensembles
universitaires, d'autant que la multiplication des programmes de
recherche internationaux a engendré une
prolifération de signatures collectives dans les publication. Les
sciences de la vie offrent un excellent exemple de la mondialisation de
l'activité scientifique. Ainsi, la
carte du génome humain
publiée dans la revue américaine ‘Science’ ne comptait pas
moins d'une centaine de signataires, dont celui de Jean Weissenbach,
le directeur du Centre national de séquençage d'Evry qui en fut l'artisan
principal (53). En fait, dans ce contexte de mondialisation,
l'évaluation s'opère désormais
par le biais d'organismes tels ‘Thomson Reuters’ ou l'‘Academic
Ranking of World
Universities’ (ARWU) de Shanghaï, tandis que toute publication requiert désormais l'usage de l'anglais dont
l'usage s'est d'ailleurs
plus facilement imposé aux sciences naturelles que dans les sciences
humaines et sociales. La recherche française a du s'adapter à cette
situation, non sans de bons résultats. L'une des conséquences de ce réagencement peut
s’apprécier avec la quatorzième position obtenue dans le classement
‘ARWU 2020'
par le groupe 'U. Paris-Saclay' (ex-U.-Paris-Orsay,
ENS-Cachan, I. Gustave Roussy, CHU Kremlin-Bicêtre, avec des instituts
comme Neurospin (CEA), des UR de l’Inserm et du CNRS), entre les
universités américaines de Californie (UCLA) et Johns Hopkins (54).
Quant au CNRS, essentiellement resté une agence de moyens, il s'inscrit dans des perspectives scientifiques tracées en dehors de ses murs (55). L'évaluation des
chercheurs demeure certes l'apanage de son comité
national, mais
celle-ci concerne surtout son personnel statutaire, ce qui
n’était pas le cas des boursiers contractuels de la caisse des sciences, «...ces
cerveaux si fâcheusement pourvus d'estomacs
» aimait à dire Jean Perrin (56).
Notes
*
'La République des savants. La Recherche
française et le CNRS' (Flammarion, 1990) est
le titre d'un ouvrage publié par Jean-François Picard avec Gérard
Darmon et Elisabeth
Pradoura, préfacé par Antoine Prost, à l'occasion du cinquantenaire du
CNRS. Le texte présenté ici propose une mise à jour tenant compte des
événements survenus au cours des trois dernières décennies, de la
disposition de sources d'archives et d'entretiens réalisés depuis,
ainsi que de publications plus récentes comme le livre de Denis
Guthleben publié par le comité pour l'histoire du CNRS, 'Histoire du CNRS de 1939 à nos jours' (Armand Colin, 2013)
.
(1) Mayer A., 'Allocution pour le 25ème anniversaire de l'IBPC',
Hermann, 1952 et P. Girard, Allocution de Pierre Girard in memoriam J.
Perrin, 10 nov. 1948 (arch. IBPC)
(1b) Fosdick, R. B., ‘A Philosophy for a Foundation. On the Fiftieth
Anniversary of the Rockefeller Foundation 1913 - 1963'. New-York, 1963.
(2) Picard J-F, Op. cit, p. 36 et sq.
(3) Ibid. et Perrin, J. ' L'organisation de la recherche scientifique en France', Hermann et Cie éditeurs, 1938
(4) Note J. Cavalier au ministre, janvier 1935 (AN 80284, liasse 1)
(5) Zay, J., 'Souvenirs et solitude', Le talus d'approche, 1987
(6) Conseil supérieur de la recherche scientifique, 2-5 mars 1938, Melun, imp. administrative, 1938
(7) Mayer A., 'Rapport présenté à la commission chargée de préparer le
réglement intérieur de la caisse nationale des sciences' (AN 80284)
(7) Mayer J., 'André Mayer, a biographical sketch (1875 - 1956)', The journal of Nutrition, 99, 1 - 8
(8) Picard, Op. cit, p. 100
(8 bis) En 1948, des funérailles nationales seront organisées au Panthéon pour Jean Perrin et Paul Langevin
(9)
Nye M-J., 'Science in the Provinces: Scientific Communities and
Provincial Leadership in France, 1860-1930', University of California
Press, 1986
(10) Charle C., 'La République des universitaires', Seuil, 1994
(11) Picard J-F. Op. cit, p. 61 et sq.
(12) Idid. p. 58
(13) Paris-Midi, 26 nov. 1939
(14) Pestre D., ''Raoul Dautry, la naissance d'une pensée technique
1880 - 1951', Institut français d'architecture, sept. 1987 et Weart S.,
'Scientists in Power', Harvard U. Press, 1979.
(15) Kropfinger, G. 'Henri Longchambon (1896 - 1969)', mémoire de maitrise Paris IV, juin 1997
(16) Guthleben, D., Op. cit., p. 45 et sq.
(17) Goudsmit, S. A., 'L'Allemagne et le secret atomique (la mission Alsos)', Arthème Fayard, 1948
(18) PIcard J-F, Op. cit. p. 98. (P.V. du comité directeur du CNRS en 1944 in AN 80284, 114, 183 et 205)
(18b) A ces réalisations il convient d'ajouter les services de
recherches installés dans les entreprises nationalisées à l'époque, par
exemple à la SNCF pour l'électrification ferroviaire (Picard J-F, Technique universelle et filières nationales, le cas de l'électrification des chemins de fer européens, STP,
vol 1, 1997) ou un département de R&D à EDF (Picard J-F, Recherche
et Industrie, témoignages sur quarante dans d'études et de recherches à
Electricité de France, Eyrolles, 1987)
(19) Teissier G., 'Une politique française de la science', conférence à
l'Union Française Universitaire, 21 juin 1946. En 1950, pour des
raisons politiques Joliot et Teissier seront démis de leurs fonctions
l'un au CEA l'autre au CNRS, sans que l'événement ne semble avoir eu de
conséquences majeures dans l'histoire des deux organismes.
(20) Ibid. , 'L'avenir de la
science' , 3ème congrès de l'UFU, 1 avril 1947. Sur les circonstances
du renvoi de Teissier du CNRS en 1950, cf. Guthleben D. Op. cit. p. 138 et sur
celle de Joliot du CEA, Pinault M., 'Frédéric Joliot-Curie', Paris, O. Jacob,
2000
(21) Prenant M., 'Problèmes actuels du progrès scientifique en France', La Pensée, 77, 1-2 1958
(22) Le Monde, 6 oct. 1954
(23) Duclert V., 'Le colloque de Caen, second temps de l'engagement
mendésiste', in Recherche (Le gouvernement de la recherche) 2006
(24) Colloque 'enseignement et recherche scientifique', Les cahiers de la République, janv. 1957
(25) L’entreprise est
menée avec le soutien de René Billières le ministre de l’Education
nationale et du directeur de l’Enseignement supérieur, le philosophe
Gaston Berger. L'INSA devrait démocratiser la formation des ingénieurs. « Passé
le baccalauréat on voit les (élèves) les plus vaillants s'épuiser dans
la course folle aux concours des grandes écoles, cependant que près des
deux tiers des candidats se voient ajourner à la propédeutique
scientifique dit Longchambon. Ainsi, le pays qui manque le plus
gravement de cadres techniciens s'offre le luxe d'écarter chaque année
mille cinq cents des deux mille trois cents étudiants attirés par la
licence de sciences! Pour donner à ces réprouvés une formation à
la mesure de leurs aptitudes et accueillir les enfants d'ouvriers, il
faut accroître les possibilités d'accueil de notre enseignement
scientifique en créant des écoles nouvelles…/ Sans concours d'entrée,
(l’INSA) accueillera chaque année un millier de bacheliers de
mathématiques : les meilleurs en sortiraient ingénieurs après cinq ans
d'études et les autres deviendraient, au bout de trois ans, les
techniciens supérieurs dont le besoin n'est pas moins pressant…/ La
sélection des élites telle que la pratiquent les grandes écoles doit
être poursuivie, mais elle ne doit pas exclure l'éducation de masse,
(car) la formule des barrages successifs par concours ne suffit plus ". Le Monde, 17 oct. 1956
(25b) Picard J-F, 'Recherche et Industrie, témoignages sur quarante ans
d'études et de recherches à Electricité de France', Eyrolles, 1987
(26) Le Monde, 29 déc. 1954 et sq.
(26 bis) Vichney N., 'La bombe française aura exigé dis ans d'études et d'efforts', LM, 31 déc. 1959
(27) Le Monde, 29, déc. 1954.
(28) Longchambon H., 'La France face aux conséquences du progrès scientifique et technique', Cahiers laïcs, 1957
(28b) En l'absence de Longchambon, le CCRST tient sa première réunion, N. Vichney, LM, 13 déc. 1958
(28c) Aust
J., Picard E., 'Gouverner par la proximité. Allouer des fonds à des
projets de recherche dans les années 1960', Genèse, 2014-1, n° 94, pp.
7 - 31.
Voir aussi Le Monde, 13 déc. 1958 et janv. 1959
(28d) Pour préciser sa position, Jean Coulomb sa plaisait à citer un
article du physicien Léon Brillouin intitulé 'Solitaire ou embrigadé", La Revue de la NRF, 2 nov. 1956 : "jusqu'où
irons nous dans cette voie ? Les savants dirigés et contrôlés cesseront
peut être de s'intéresser à leurs recherches, deviendront des
fonctionnaires plus ou moins zélés. La circulation des idées une fois
étranglée, l'émulation tombera, la curiosité s'émoussera, la
spécialisation technique survivra seul sous ce régime bureaucratique
et, peu à peu, nous nous acheminerons vers une société de fourmis, une
ruche bien organisée assez semblable au 'brave new world' prédit par
Huxley."
(29) Bénilan A-L et R., Notes d'archives extraites des PV des sessions 1971 -1979 du comité national (AN 830008, boites 119 - 183)
(30) Le Monde, 7 juin 1962
(31) Interventions de A. Kastler intervention au directoire du CNRS, juin 1965 (AN 94-0035)
(31 bis) Le Monde, 18 juin 1962
(31 ter) Sur l'astrophysique et la géophysique, on consultera les entretiens réalisés avec Jean Delhaye (1986), Jean-François Denisse (1986), Pierre Drach (1986), Louis Lliboutry (1986), Maurice Mattauer (1988), Evry Schatzman (1987) et Haroun Tazieff (1986)
(32) Néel, intervention au directoire du CNRS, juin 1965 (AN 94-0035)
(32b) Sur la physique des particules on consulera des entretiens avec Pierre Auger (1986), André Blanc-Lapierre (1989), Jeanne Laberrigue (1986, 1989), Pierre Lehmann (1988), Jean Teillac (1987)
(33) Barrier J., 'Aux frontières de l'industrie. Travail de démarcation
et émergence d'un champ de recherche universitaire sur la
microélectronique en France (1978 - 1986)' in Le gouvernement des
disciplines acédémiques (J. P. Leresche dir.), Paris, E.A.C. 2017. Voir
aussi Ramunni G., Les sciences pour l'ingénieur. Histoire du
rendez-vous des sciences et de la société, Numilog.com, 1996 et Guthleben, Op. cit., p. 321 et sq.
(34) Picard J-F., 'Les femmes dans les laboratoires de biologie',
in Les Femmes dans l'histoire du CNRS, G. Hatet-Najar ed., Paris, CNRS,
2004.
(35) Heim R., intervention du directeur du Museum, au C. A. du CNRS, 9 mars 1945 (AN 80-0284, 55)
(36) Bénilan A-L et R., Ibid.
(37) Joliot, F., conférence donnée au CNRS, 7 juin 1945 (P.V. du comité
directeur du CNRS en 1944 in AN 80284, 205).
(37b) Sur les SHS eu CNRS, on consultera une série d'entretiens avec le géographe Roger Brunet (1986), l'économiste Martine Bungener (2016), les ethnologues Pierre-Henri Chombart de Lauwe (1986) et Sylvie Fainzang (2012), la sociologue Michèle Ferrand (2019), le philologue Jean Glénisson (1986), les sociologues Claudine Herzlich (2000, 2006), Viviane Isembert-Jamati (1987), Jacques Lautman (1987) et Bernard P. Lécuyer (1986), le linguiste Michel Lejeune (1986), le géographe Pierre Monbeig (1986), le psycho-sociologue Pierre Naville (1987), l'archéologue Jean Pouilloux (1987) et le sociologue Jean Stoetzel (1986)
(38) Bernard A. et al., 'Groupe d'étude sur le fonctionnement du
comité national', CNRS, 1973; Lemaine G., Darmon G. et al.,
'Noopolis, les laboratoires de recherche fondamentale, de l'atelier à
l'usine', Ed. du CNRS, 1982. Voir aussi Guthleben, D., p. 308 et sq.
(39) Gros F., intervention au directoire du 5-6 juillet 1977 (AN 94-0035)
(40) Le Monde, 9 juillet 1981; Gilbert Dagron du Collège de France n'hésite pas à évoquer un abus du pouvoir (LM, 31 oct. 1981)
(41) Lazar P., 'La science doit rester au contact de la société', Le Monde, 20 janv. 1982
(42) Avonny M., 'Questions', Ibid., 13 janv. 1982
(42 bis) Avonny M. 'Les scientifiques prennent leur plume', LM, 5 juil. 1986
(43) Séris J-P, 'La Technique', coll. quadrige, Paris, PUF, 1994. Voir
aussi 'Histoire des sciences et des savoirs', t. III Le siècle des
technosciences, coll. sous la dir. de D. Pestre, Seuil, 2019
(44) Postel-Vinay, O., 'Le grand gachis', Eyrolles, 2002
(45) Le Hir, P.., 'La recherche française dans la spirale du déclin', Le Monde, 11 mars 2003
(46) 'Discussion avec Alain Trautmann qui réclame un plan Marshall pour la recherche', Ibid., 15 janv. 2004
(47) 'La contribution de Nobel français au débat sur la recherche.
La crise de la recherche académique, une opportunité de changement', Ibid. , 9 mars 2004; Le gouvernement et plusieurs experts plaident pour une réforme en profondeur du CNRS', Ibid., 10 mars 2004
(48) Bronner L., L'Académie des sciences dénonce l'inadaptation
du modèle français de recherche et prône une refonte totale', Le Monde,
13 avril 2004. Ce constat rejoint celui des anciens
directeurs du CNRS qui prennent la plume dans le 'Monde' pour affirmer
: "...que
la principale raison de cette situation préoccupante n'est pas
seulement budgétaire, mais qu'elle doit aussi être recherchée dans le
faible intérêt des gouvernements successifs pour la recherche.../
(Aussi) convient-il de dénoncer le poids excessif qu'ont pris les
appareils syndicaux dans cette gestion, grâce aux convergences
objectives et anciennes avec une part importante du mandarinat
universitaire et de celui des grands organismes de recherche ; grâce
aussi au laisser-faire, sinon à la connivence de l'Etat, quand il s'est
agi de fonctionnariser les personnels de recherche, Aubert G., Bréchignac C., Chabbal R., Ducuing J., Feneuille
S., Payan J-J., 'Pour sauver la recherche, se garder aussi bien
de l'égalitarisme que du consensus mou', Ibid, 2 juin 2004
(49) Le Hir P., 'Réforme de la recherche, un nouveau pacte avec la société', LM,
28 oct. 2004
(50) Le Monde, 17 janv. 2006; L'Humanité, 18 janv. 2006
(51) Entretien avec E. Brézin, président de l'Académie des sciences, Le Monde, 11 fev., 10 mai 2005
(52) 'Alain Trautmann : Les chercheurs veilleront au respect des engagements', ent. avec P. Le Hir, Ibid., 16 mars 2006, Ibid., 11 fév. et 10 mai 2005
(53) 'A gene map of the human genome', Science, vol. 274, 25 oct. 1996
(54) L'Université Paris-Sud (ou Paris Saclay) est
classée onzième par le Center for World University Rankings 2021 entre
Cambridge et le M.I.T. On notera que ce classement reste pratiquement stable depuis quelques années (LM, 16 aout 2023)
(55) D. Larousserie, H. Morin, ' Macron veut sortir la recherche de l'ornière' (LM, 8 déc. 2023)
(5§) Perrin J., 'La science française' in Les Cahiers de Radio-Paris, 10 janv. 1939